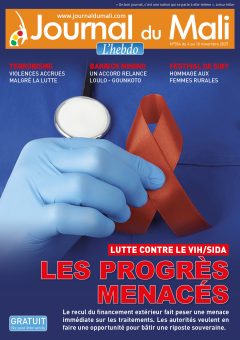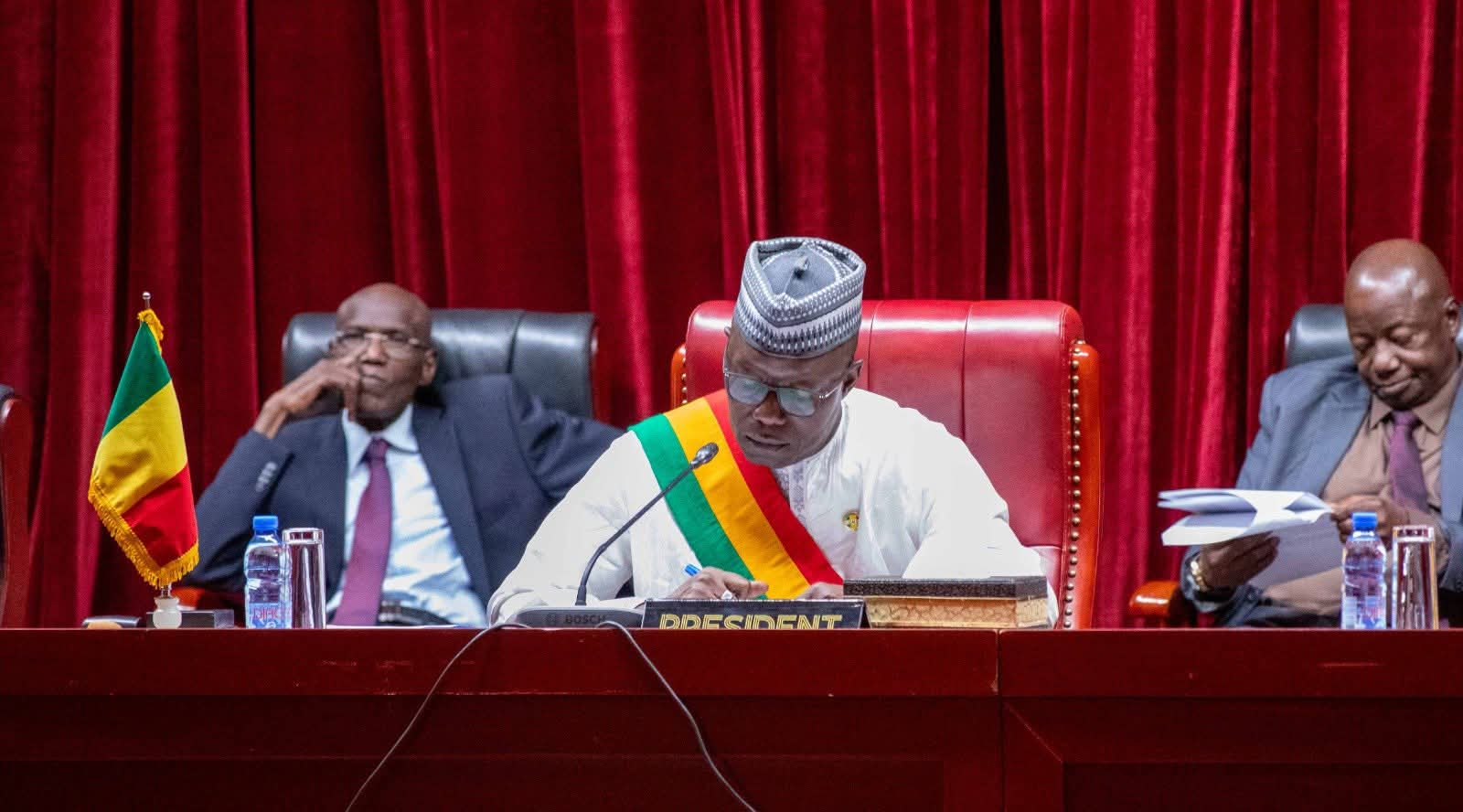Signé à Washington fin juin 2025, l’accord de paix entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda marque une avancée diplomatique majeure. Mais, derrière l’engagement affiché, les cicatrices des conflits passés, la méfiance mutuelle et les intérêts croisés rendent l’avenir incertain. Selon le HCR, plus de 118 500 personnes ont fui l’est de la RDC depuis janvier 2025, s’ajoutant aux 6,7 millions de déplacés internes recensés dans le pays.
Le texte prévoit le respect mutuel de l’intégrité territoriale, la neutralisation du FDLR par Kinshasa et le désengagement militaire rwandais de l’est congolais. Le FDLR compterait encore entre 1 000 et 1 500 combattants actifs dans les Kivu, selon une estimation de l’ONU datant de décembre 2024, ce qui complique toute neutralisation effective. Pour autant, ce texte institue un Mécanisme conjoint de sécurité incluant les États-Unis, le Qatar et l’Union africaine, pour superviser les engagements sous 90 jours. Le plan d’action, issu du « CONOPS » d’octobre 2024, fixe quatre phases, à savoir le désengagement, la démobilisation, l’évaluation et la stabilisation. Le retour volontaire des réfugiés et un cadre économique régional complètent l’ensemble.
Mais l’accord n’aborde pas directement le cas du M23, groupe rebelle au cœur des violences actuelles. Kigali nie tout lien avec lui, malgré des preuves documentées par l’ONU. Pour Kinshasa, ce silence est une faille majeure. « On ne peut pas traiter un abcès en contournant la plaie », glisse un diplomate congolais. Faute de dialogue direct avec les groupes armés, le risque de reprise des hostilités demeure élevé.
LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ
Ce n’est pas le premier accord entre les deux pays. De Pretoria (2002) à Addis-Abeba (2013), plusieurs engagements ont échoué faute d’application réelle. Le contexte sécuritaire a certes changé, mais la méfiance est tenace. « La paix ne se décrète pas, elle se construit avec du courage politique », rappelle un responsable de l’Union africaine.
Les États-Unis, très présents dans la négociation, ne cachent pas leurs intérêts. Ils cherchent à contenir le FDLR, classé comme groupe d’extrême dangerosité, et sécuriser l’accès aux minerais critiques dont regorge le sous-sol congolais. Le cobalt, le coltan et le lithium sont devenus des ressources stratégiques pour les industries occidentales.
Cet accord fait écho aux tensions entre États voisins au Sahel : Mali et Algérie, Niger et Bénin, Burkina Faso et Côte d’Ivoire. Le même syndrome de défiance bilatérale menace la stabilité régionale.