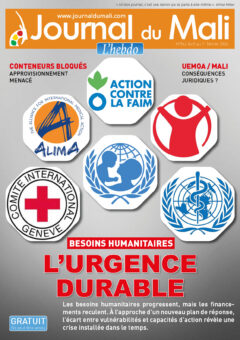Dans cet entretien, l’écrivain et expert en gouvernance Alassane Maïga livre une analyse lucide des causes profondes des crises sahéliennes. Il appelle à repenser la gouvernance, le développement et la justice pour construire une paix durable fondée sur les dynamiques locales.
1. Qu’entendez-vous par « regard détourné » dans votre analyse des conflits sahéliens ?
L’analyse propose une déconstruction des grilles de lecture sécuritaires dominantes, centrées sur la lutte contre le terrorisme, en offrant un regard dépassant la seule menace terroriste. Au Sahel, on évoque souvent le « terrorisme » et les réponses militaires associées. Cette analyse révèle que la concentration exclusive sur la « lutte contre le terrorisme » a laissé dans l’ombre des facteurs historiques majeurs comme des pratiques de gouvernance défaillantes, une centralisation excessive du pouvoir, des inégalités sociales profondes, des manipulations politiques et identitaires, la corruption endémique ainsi que les conséquences des aléas climatiques. Elle invite donc à considérer la complexité sociale, politique et environnementale, plutôt que de se restreindre à des réponses militaires, lesquelles négligent les causes profondes des conflits et risquent souvent d’en aggraver les effets en alimentant des cycles de violence et de méfiance.
2. Quels facteurs profonds expliquent, selon vous, la persistance de l’instabilité dans la région ?
La persistance de l’instabilité dans la région du Sahel ne se limite pas à une simple faiblesse des États ; elle reflète une crise profonde du pacte social, exacerbée par des politiques de développement mal adaptées aux contextes locaux et une marginalisation socio-économique excessive. Cette situation a favorisé l’implantation durable des groupes extrémistes violents ainsi que la diffusion de leurs idéologies radicales. L’échec des approches militaires tient justement à leur incapacité à restaurer une légitimité crédible. En effet, sans une présence étatique soutenue et un accompagnement social solide, les zones temporairement sécurisées retournent rapidement sous le contrôle des groupes armés extrémistes.
3. Comment percevez-vous l’impact de l’AES et du recentrage stratégique vers la Russie, la Chine ou la Turquie ?
L’influence croissante d’acteurs extérieurs tels que la Russie, la Chine ou la Turquie traduit une compétition géopolitique intense qui complique encore davantage la crise au Sahel. La région est aujourd’hui le théâtre d’une lutte féroce où les agendas des puissances étrangères se superposent et s’affrontent, souvent au détriment des populations locales. Un pivot géopolitique vers la Russie semble illustrer une redéfinition des alliances stratégiques dans la région, offrant un appui militaire au risque d’accentuer la violence structurelle. Cette reconfiguration géopolitique fragmente davantage l’espace sahélien et intensifie les tensions régionales, rendant illusoire toute solution strictement locale ou nationale isolée.
4. Quelles pistes concrètes proposez-vous pour construire une paix durable au Sahel ?
Face à ces enjeux, une paix durable au Sahel nécessite de privilégier les mécanismes locaux de résolution des conflits, reconnus comme un capital social essentiel. Plus encore, elle exige une transformation radicale des modèles de gouvernance, bien au-delà de simples ajustements techniques. Elle passera également par la réinvention d’un développement offrant de réelles perspectives, ainsi que par la promotion d’une justice réparatrice et réconciliatrice.
Le chemin vers cette paix sera long et semé d’embûches. Il faut impérativement offrir aux jeunes des perspectives économiques et politiques, protéger les droits des communautés périphériques et promouvoir une décentralisation effective accompagnée d’un transfert réel de pouvoirs aux collectivités locales.
La gouvernance doit s’appuyer sur une articulation harmonieuse entre autorités traditionnelles et institutions modernes, afin de bâtir un système plus légitime et résilient. En résumé, dépasser la réponse militaire pour s’engager résolument dans une reconstruction politique, sociale et économique constitue la seule voie viable vers une paix durable.