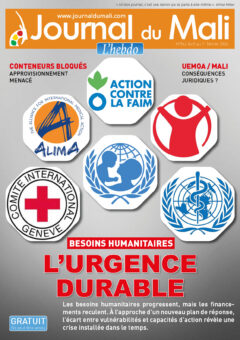Annoncée comme un texte de référence, la Charte nationale pour la paix et la réconciliation est en voie d’achèvement. Mais certains sujets majeurs, comme le sort des partis politiques, ont été exclus de ses discussions. Ce choix interroge sur sa portée réelle dans un contexte politique toujours tendu.
Selon Zeïni Moulaye, ancien ministre et membre de la Commission, la Charte vise à « unir tous les fils du Mali autour de l’essentiel » et doit servir de socle aux politiques de sécurité, de paix et de réconciliation. C’est ainsi qu’elle intègre cinq grands thèmes – Paix, Sécurité, Réconciliation nationale, Cohésion sociale et Vivre ensemble – et valorise plus de vingt mécanismes de règlement locaux issus des différentes cultures du pays. Le texte n’a pas vocation à être un document partisan, a précisé Zeïni Moulaye, mais plutôt un outil transversal à portée nationale.
Le volet Sécurité, piloté par le Général à la retraite Yamoussa Camara, insiste sur la nécessité d’un maillage sécuritaire complet du territoire en s’appuyant sur une collaboration active entre forces armées et populations civiles. Trois fonctions stratégiques sont retenues, la protection, l’anticipation et l’intervention. Le Général Camara a rappelé que les mesures d’autodéfense communautaire doivent être encadrées et intégrées à une stratégie nationale afin d’éviter les dérives constatées ces dernières années.
LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ
Sur le plan judiciaire, le Dr Marie-Thérèse Dansoko a souligné que la Charte aborde les questions de justice de manière globale, en intégrant la lutte contre l’impunité, la corruption, la délinquance financière et l’enrichissement illicite. La justice transitionnelle est également traitée, avec une reconnaissance du rôle des autorités traditionnelles dans la résolution des conflits mineurs, sans exclure les voies judiciaires classiques. Pour elle, « la réconciliation ne peut se faire au détriment de la justice ».
Suspens autour de l’ancrage juridique
Mais, au-delà du contenu, des zones d’ombre persistent. Le document est « pratiquement achevé », selon la Commission, mais son ancrage juridique n’est pas encore défini. Ce sera à la Présidence, avec l’avis de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle, de déterminer son statut légal. Ce flou soulève des inquiétudes sur la portée réelle de la Charte à court et moyen terme.
Autre interrogation de fond : nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi la question du sort des partis politiques, et notamment leur dissolution, n’a pas été confiée à cette Commission, déjà mandatée pour traiter de la paix et de la cohésion nationale ? Le Dialogue Inter-Maliens d’avril 2024, à l’origine de la création de cette Charte, avait pourtant abordé des sujets éminemment politiques. C’est cette même instance qui avait proposé l’élévation du Colonel Assimi Goïta et de 5 autres officiers supérieurs au grade de Général, décision entérinée depuis. Et, selon plusieurs sources, l’avant-projet de la Charte avait également recommandé la libération, en décembre 2024, de onze personnalités politiques arrêtées en juin de la même année. Ces éléments démontrent que la Commission a déjà traité de dossiers politiques sensibles.
Dès lors, pourquoi avoir choisi d’écarter cette même Commission de la gestion du dossier explosif des partis politiques et de leur avenir, en lui préférant un nouveau cadre – les Concertations nationales du 16 au 29 avril – annoncé tardivement et préparé dans l’urgence ? Une meilleure articulation entre les deux cadres aurait peut-être permis une sortie de crise plus apaisée, dans un climat de confiance renforcée.
Publication retardée
De plus, le retard dans la publication officielle de la Charte interroge. Annoncée comme prioritaire dès 2024, sa remise au chef de l’État n’interviendra qu’à la fin du premier semestre 2025. Entre-temps, le pays a connu des bouleversements majeurs, tant sur le plan sécuritaire que politique, sans que ce texte ait pu jouer son rôle d’outil d’apaisement et de cohésion.
Autre aspect non négligeable, le Programme d’action gouvernementale 2025-2026 évoque bien la paix et la réconciliation dans l’un de ses huit axes, mais sans lien direct explicite avec le document en cours. Il reste donc à espérer que cette Charte, une fois remise, ne devienne pas un texte de plus, mais bien un guide concret d’action accepté par tous, y compris par ceux qui, jusqu’ici, n’ont pas été associés à son élaboration.
MD