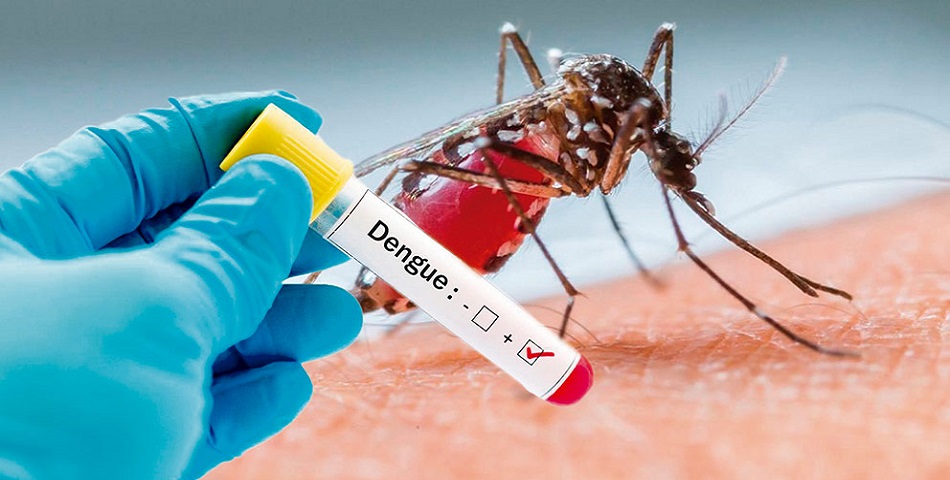Le Burkina Faso, le Mali et le Niger viennent de franchir une nouvelle étape dans la mise en place de l’architecture de la Confédération regroupant les trois États. Réunis à Niamey le 17 mai 2024, les ministres des Affaires étrangères des trois pays ont adopté les textes de création de la future entité. En attendant la validation des textes par le sommet des chefs d’État, les défis et les attentes sont déjà grands pour cette future alliance.
« Nous pouvons considérer très clairement que la Confédération des États de l’Alliance des États du Sahel (AES) est née », s’est réjouit le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, à l’issue d’une rencontre avec le chef de l’État du Niger. En effet, le ministre Diop et ses homologues du Burkina Faso et du Niger ont été reçus par le Président de la Transition au Niger après la réunion ministérielle qui a adopté les textes de création de la Confédération de l’AES, le 17 mai dans la capitale nigérienne. Quatrième du genre, cette rencontre des ministres des Affaires étrangères était une étape supplémentaire vers la concrétisation de la Confédération. « La phase d’organisation de la nouvelle entité confédérale se déroule bien », assure un spécialiste.
LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ
L’alliance stratégique incarnée par l’AES prendra bientôt forme et la préparation des « documents-cadres donne satisfaction », poursuit notre interlocuteur. Il ne reste plus aux chefs d’État que de « valider leur volonté politique de mettre en place cette Confédération, qui porte les espoirs de la renaissance africaine ». Ainsi, plus qu’une entité politique destinée à répondre à des défis communs, cette Confédération est aussi, pour certains analystes, le début d’une nouvelle ère.
Opportunités
L’Alliance des États du Sahel est le point de départ d’une nouvelle Union africaine, estime pour sa part Ousmane Bamba, modérateur du « Forum du Kénédougou », et invité du plateau du Débat du dimanche sur la chaîne de télévision Africable. Selon lui, quand la Confédération aura démontré ses avantages, elle pourra devenir une fédération. Il suggère ainsi que le traité fondateur de la Confédération soit assez « contraignant », afin de diminuer l’impact des droits de réserve des États, qui pourraient dépouiller l’alliance de son essence. Il doit aussi rester « ouvert » afin de permettre des adhésions futures.
Face aux défis communs, notamment sur le plan sécuritaire, les États de l’AES ont vite envisagé une synergie d’action, concrétisée par l’adoption de la Charte du Liptako Gourma le 16 septembre 2023. Une dynamique poursuivie lors de la 1ère réunion des ministres des Affaires étrangères des trois pays à Bamako, le 30 novembre et le 1er décembre 2023. Elle s’est traduite par la « mise en place de la synergie d’action pour prendre en compte les aspirations profondes des 3 peuples », a expliqué le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré, dans le communiqué sanctionnant la réunion ministérielle. Le but de la Confédération est de mutualiser les forces afin de résoudre les problèmes communs, auxquels les États pris individuellement ne peuvent faire face. Une réalité que les États de l’AES ont déjà expérimenté sur le plan sécuritaire avec des résultats probants, admettent les observateurs. Appelés à aller au-delà de cette « architecture de défense collective et d’assistance mutuelle », les États de l’AES veulent désormais bâtir une « unité militaire et économique plus poussée ».
Conditions de la réussite
Condamnés à réussir la prise en main de leur destin commun, les États de l’Alliance ont l’obligation de financer leurs propres projets pour ne pas finir comme le G5 Sahel, avertissent les observateurs. L’un des avantages de la future Confédération, comme pour toute intégration, est la mutualisation d’un certain nombre de moyens et l’élaboration de certaines politiques communes », note le Professeur Abdoul Karim Diamouténé, enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences économiques et de gestion (FSEG). Ces politiques peuvent permettre l’élimination de certaines contraintes, dans le cadre par exemple de la libre circulation des biens et des personnes. Et, à ce titre, les entraves à la libre circulation dans le cadre de la CEDEAO sont des expériences à capitaliser, ajoute-t-il.
Sur le plan de l’énergie, la décision du Niger de fournir les pays membres de l’AES en carburant est un atout qui n’existait pas forcément entre les pays de la CEDEAO. Ces facilités pourraient aussi permettre la mutualisation de certains investissements, conséquence d’une prise de conscience qui se concrétisera dès que le processus actuellement en cours sera formalisé.
Suite logique du départ des pays de l’AES de l’organisation commune, la CEDEAO, la création de la Banque de l’AES, qui se chargera de certains investissements, est aussi une étape à envisager pour consolider la future alliance. Elle sera en tout cas différente de celle qui existe déjà. Parce que, dans l’ancien espace, la politique et les conditions administratives « nous échappaient ».
La nouvelle Banque de développement devrait donc faciliter la prise de décisions au niveau des pays, avec une prise en compte réelle des critères, ce qui représenterait « une belle perspective » par rapport à ce qui existait auparavant. Les États de l’AES constituent donc un marché pour les pays côtiers qui en dépendent, et non le contraire, soutient M. Diamoutènè. Les résultats dépendront donc de l’efficacité des actions à mener.
Après les menaces et les sanctions suite au départ des pays de l’AES de la CEDEAO, les leaders de l’organisation tentent une médiation pour le retour en son sein des trois États du Sahel. Un retour qui n’est pas souhaitable et qui serait même une régression, estime l’économiste.
Désormais, il faut envisager l’existence de deux entités qui seront donc contraintes à négocier de nouveaux accords. Disposant de ressources naturelles et d’un marché intérieur de 70 millions d’habitants, les pays de l’Alliance peuvent envisager l’introduction de barrières tarifaires à leurs frontières pour développer leur capacité industrielle, en deçà de celle de la zone, et de protéger leurs marchés. Une opportunité qui amènerait plutôt certains pays de la CEDEAO à rejoindre l’AES. Une « autre CEDEAO, qui prendrait mieux en compte les aspirations des pays de l’AES et même de certains de la CEDEAO ».
La panacée ?
La réunion de Niamey a permis la validation des textes du Cadre d’intégration politique, économique et social, à savoir le Traité portant création de la Confédération de l’AES et le Règlement intérieur du Collège des chefs d’État, et constitue la dernière ligne droite vers la tenue de la première session du Collège des chefs d’Etat. Mais le chemin vers la réalisation des ambitions de l’organisation reste semé d’embûches. La principale condition au succès de l’Alliance « est la réalisation de la souveraineté, qui inclut la sécurisation intégrale », note notre analyste. Les autres sont relatives à la définition de politiques adaptées aux problèmes existants déjà dans les pays qui ont créé l’AES, la rigueur dans la mise en œuvre de ces politiques, grâce à des acteurs très engagés, et la garantie du temps long des transformations, ce qui suppose une continuité dans le processus. Parce que, même si l’essentiel est disponible, une volonté politique et un leadership affirmé qui ont permis de franchir des étapes importantes, le chemin vers la prospérité sera long.
Pour le ministre Diop, « le travail principal aujourd’hui est d’avancer pour finaliser et formaliser les actes nécessaires pour permettre à cette Confédération de fonctionner ». Il faut surtout « prendre la juste mesure des défis », suggère un observateur.
La Confédération ne doit pas être une réponse ponctuelle à des défis existentiels mais une solution pérenne aux aspirations de populations déjà intégrées, grâce à des mécanismes de gestion adaptés. Une dynamique des peuples qu’il faut désormais respecter, selon Boubacar Bocoum, analyste politique.