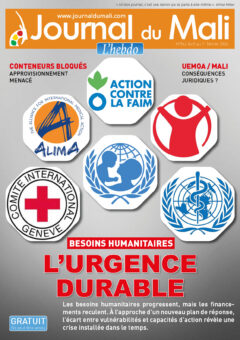L’année scolaire 2025 – 2026 s’annonce sous haute tension pour plusieurs écoles catholiques. Depuis la relecture en juin 2024 de la convention qui lie l’enseignement catholique et l’État, la scolarisation de plusieurs milliers d’élèves est menacée, ainsi que les emplois de dizaines d’enseignants. Cette situation risque d’accentuer la crise que traverse l’Éducation depuis plus d’une décennie.
« Les écoles catholiques ne vont pas fermer, les activités pédagogiques de quelques établissements seront suspendues pour une année ou deux. Le reste des écoles va ouvrir », assure l’Abbé Edmond Dembélé, Directeur National de l’Enseignement Catholique (DNEC) au Mali. Après une année scolaire marquée par des mouvements récurrents relatifs à des retards de salaires, le secteur de l’enseignement catholique amorce une année scolaire 2025 – 2026 pleine de défis.
L’histoire de l’enseignement catholique est intimement liée à celle de l’évangélisation du pays, avec la création de la première école à Kita en mai 1889. Depuis, l’enseignement catholique a connu une évolution importante et joué un rôle majeur dans le système éducatif national. Aujourd’hui, après 136 ans d’existence, le secteur représente 138 établissements scolaires, 1 416 enseignants et 36 345 élèves et étudiants. L’enseignement catholique, qui revendique des milliers de cadres maliens formés, a connu de multiples soubresauts. De la séparation de l’Église et de l’État à la période des conventions, les relations entre lui et l’administration n’ont pas toujours été au beau fixe.
LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ
Au Mali, l’ère des conventions se situe lors de la période postcoloniale et débute en 1968. La première convention, du 2 février 1969 et relue en septembre 2008, détermine les rapports entre la Conférence épiscopale et le personnel enseignant dans les écoles privées catholiques. La deuxième, du 8 août 1972, révisée en 1978, permettait à l’État de prendre en charge 80% de la masse salariale du personnel enseignant. La fin de cette subvention en juin 2024 a plongé les écoles catholiques dans une situation inédite.
Nouvelle donne
L’application rigoureuse du principe de laïcité consacré par la Constitution de juillet 2023 et la situation sécuritaire et économique difficile du pays justifient la mesure de suspension de la subvention de l’État. Ce dernier ne pouvant faire face à d’autres demandes de ce genre, émanant notamment d’associations religieuses musulmanes pour les écoles coraniques. Pour les observateurs, c’est surtout l’argument de la rationalisation des dépenses publiques qui peut justifier cette mesure, car l’enseignement dispensé dans les écoles catholiques l’était au profit de tous les enfants du Mali, sans distinction de religion, et était conforme au programme national.
L’une des conséquences de cette nouvelle donne est le risque de fermeture de certaines écoles et la fin de la possibilité d’être scolarisés pour de nombreux enfants dans les zones rurales, où sont situées plusieurs de ces écoles. Une dizaine d’écoles seront concernées par la suspension des activités pédagogiques dans l’Archidiocèse de Bamako, comprenant Bamako et quelques zones périphériques, trois dans le diocèse de Sikasso, trois dans le diocèse de San et deux à Mopti.
Impacts négatifs
La fermeture éventuelle de plusieurs écoles catholiques pourrait signifier que des milliers d’enfants n’auront plus d’instruction, surtout dans les zones rurales ou enclavées où les écoles catholiques sont souvent les seules structures éducatives disponibles, s’inquiète un enseignant. Ils seront au total 7 000 à être privés de scolarité, selon les estimations de la Direction de l’Enseignement catholique. Si aucune solution de remplacement n’est trouvée, beaucoup d’enfants seront contraints d’abandonner les classes, avec des conséquences à long terme sur leur avenir, poursuit-il. Plus de 1 600 enseignants travaillaient dans ces écoles. Parmi eux, 230 seront sans emploi, toujours selon les prévisions de la Direction de l’Enseignement catholique.
Pour continuer à exister sans la subvention de l’État, les écoles ont consenti une hausse des frais de scolarité, passant du simple à plus du double dans certaines écoles de la capitale. Par exemple, pour le second cycle de l’enseignement fondamental, les frais de scolarité passeront de 120 000 à 250 000 francs CFA. Des frais que beaucoup de familles pauvres ou modestes ne peuvent pas supporter.
Entre transfert dans des écoles publiques ou des écoles privées moins chères, M. Tall, père de deux enfants élèves au collège, s’adapte. « L’augmentation est vraiment importante et je n’ai pas encore fait un choix définitif ». D’autant que les transferts massifs vers les écoles publiques risquent de créer une pléthore dans les effectifs et une baisse de la qualité de l’enseignement à cause des classes surchargées et de manque de matériel, redoutent les spécialistes.
Les écoles catholiques accueillent des élèves de toutes confessions (chrétiens, musulmans, animistes) et sont reconnues pour leur discipline, leur rigueur et leur qualité pédagogique. Même si elles n’avaient pas été épargnées par la baisse des niveaux, ces écoles, qui revendiquent 80% de réussite aux différents examens nationaux, pourront-elles avoir la même « performance », avec la nouvelle situation ? Leur fermeture réduit en tout cas la diversité de l’offre scolaire au Mali. Au-delà, la fermeture de ces écoles pourrait conduire à un déséquilibre régional. Dans certaines régions (Au centre et au sud du Mali notamment), les écoles catholiques complètent ou remplacent l’offre publique. La fin de ce partenariat de 53 ans entre l’État et les écoles catholiques serait en outre un mauvais signal pour d’autres partenaires éducatifs privés. Un partenariat indispensable pour aider l’État à relancer l’éducation mise à mal depuis le début de la crise, avec environ 1 600 écoles fermées.
Alternatives
Le sursis accordé à la mise en œuvre de la mesure de suspension de la subvention de l’État ne semble pas avoir été suffisant pour apporter les solutions durables à l’enseignement catholique. Malgré l’existence d’une Commission de réflexion et de négociation sur l’avenir de l’enseignement catholique, des solutions à long terme ne sont pas attendues avant une année ou deux. En effet, faute d’alternatives, plusieurs écoles devront rester fermées d’ici deux ans, pour permettre à la majorité de continuer à travailler, assurent les responsables de la DNEC.
Désormais, pour compenser la suspension de la subvention de l’État, l’Église envisage deux mesures-phares qui consistent principalement en l’augmentation des frais de scolarité et la révision des contrats avec les enseignants. Dans les zones rurales, les frais de scolarité étaient autour de 25 000 et 30 000 francs CFA pour les premiers cycles et 40 000 à 50 000 francs CFA pour les seconds cycles. Des frais qui correspondent au double en ville et seront désormais augmentés de 30 à 50%.
La deuxième mesure envisagée par la DNEC est la révision des contrats des enseignants. Une décision qui a conduit le Syndicat National des Travailleurs de l’Enseignement Privé Catholique (SYNTEC) à porter plainte contre son employeur pour licenciement abusif. Une décision du tribunal à ce sujet est attendue le 29 septembre 2025.
Combler le vide
L’État devrait aider à trouver une solution progressive face au nouveau défi que constitue l’arrêt de la subvention, suggère un acteur. Reporter ou étaler la fin des subventions sur plusieurs années au lieu d’une suppression immédiate. Ceci permettrait aux écoles concernées de s’adapter progressivement, à travers la recherche de financements et la restructuration de l’enseignement catholique. Parallèlement, les autorités doivent étoffer les capacités d’accueil de l’école publique en construisant de nouvelles classes, surtout dans les zones les plus reculées. Le recrutement et la formation de davantage d’enseignants, pour tenir compte des élèves transférés, ainsi que la fourniture de matériel pédagogique seront nécessaires pour maintenir la qualité de l’enseignement. Parmi les solutions à long terme que pourrait envisager l’État, une subvention indirecte aux familles, à travers la mise en place d’une aide financière ciblée (bourses scolaires), pour les enfants issus des écoles catholiques, afin qu’ils puissent s’inscrire ailleurs sans rupture. Et, enfin, il faut ouvrir le dialogue entre l’État, l’Église, les syndicats d’enseignants et les parents d’élèves afin d’explorer des formes de partenariat alternatives basées sur des objectifs éducatifs partagés (et non religieux).