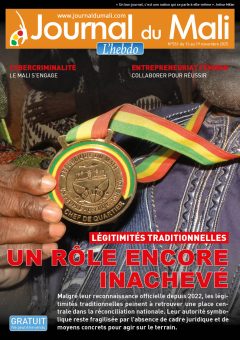Le tribunal correctionnel du Havre a rendu son jugement le 13 novembre 2025 dans une affaire d’exportation illégale de déchets dangereux. Cette procédure met en évidence l’ampleur des flux de matériels usagés à destination de l’Afrique de l’Ouest, en particulier du Mali, où les capacités de contrôle et de traitement sont très limitées.
Le justice française a condamné sept prévenus et deux sociétés impliqués dans un système d’exportation de déchets dangereux depuis le port du Havre. Les cargaisons, déclarées sous de faux motifs, contenaient des pièces automobiles non dépolluées, des réfrigérateurs hors d’usage, des batteries usées et divers appareils électroménagers irrécupérables. Elles prenaient la direction du Mali, de la Côte d’Ivoire ou du Nigeria. Les douanes avaient intercepté près de cinquante tonnes de vieux réfrigérateurs, compresseurs et batteries lors des contrôles. Entre 2023 et 2025, environ 1 300 tonnes de déchets dangereux ont été bloquées avant leur expédition vers l’Afrique et l’Asie.
L’enquête a mis au jour un système organisé reposant sur des factures falsifiées de dépollution destinées à faire passer des pièces automobiles encore chargées en huiles usagées et fluides toxiques pour des éléments traités. Pour l’électroménager, l’une des sociétés déclarait les conteneurs comme des « effets personnels », une pratique déjà documentée par Europol et Interpol dans d’autres dossiers similaires. Ces méthodes témoignent des difficultés persistantes à distinguer les équipements d’occasion encore utilisables des déchets destinés au recyclage, alors même que les ports européens constituent l’un des premiers maillons du contrôle.
LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ
Au Mali, destination régulière de ces flux, les institutions internationales dressent un constat préoccupant. Selon le Global E-Waste Monitor 2024, le pays ne recycle formellement moins de 1 % de ses déchets électroniques. Plus de 95 % du traitement se déroule dans l’informel, principalement à Bamako, où adultes et adolescents démontent les appareils sans protection. Les équipements classés comme « seconde main » arrivent fréquemment en réalité en fin de vie, et le Mali ne dispose d’aucune installation publique de dépollution pour absorber ces volumes. Les substances manipulées – plomb, mercure, huiles usées, retardateurs de flamme – figurent parmi les plus dangereuses identifiées par l’Organisation mondiale de la santé.
La situation est aggravée par la structure du parc automobile. L’ONU-Environnement souligne que plus de 60 % des véhicules ajoutés chaque année en Afrique de l’Ouest proviennent d’importations d’occasion, une proportion qui atteint parfois 90 % dans plusieurs pays de la région. Pays enclavé, le Mali dépend entièrement des ports voisins pour ses approvisionnements et suit la même dynamique. Une part importante des véhicules qui y sont introduits arrive en fin de cycle, générant un flux continu de batteries usées, pièces non dépolluées et huiles moteur difficilement gérables par les structures locales.
Ces flux sont pourtant théoriquement interdits. Le Mali est signataire de la Convention de Bamako, adoptée le 30 janvier 1991 et entrée en vigueur le 22 avril 1998, qui proscrit l’importation de déchets dangereux sur le continent africain. Mais le manque de moyens de contrôle aux frontières et l’arrivée de conteneurs accompagnés de documents falsifiés rendent l’application de cette convention particulièrement complexe. Les interceptions menées au Havre montrent que la lutte la plus efficace contre ces trafics se joue souvent dès les ports d’origine, bien avant que les cargaisons n’atteignent les États destinataires.
La décision du 13 novembre 2025 ne met pas fin au phénomène, mais elle rappelle la responsabilité des pays exportateurs dans la prévention de ces trafics et souligne la vulnérabilité des États destinataires. Sans infrastructures adaptées, ni véritables capacités de dépollution, le Mali continuera de recevoir des flux de matériels dont le traitement dépasse largement ses ressources, exposant la population aux risques sanitaires et environnementaux d’un commerce international dont le coût réel reste largement occulté.