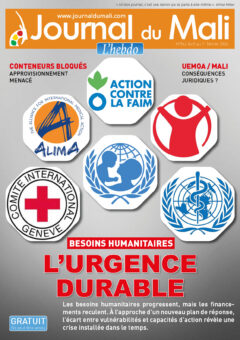En tant que jeune chercheuse, quels sont selon vous les principaux obstacles que rencontrent les femmes dans la recherche au Mali ?
Dr Kadia Cissé : Les freins sont multiples et s’entremêlent. D’abord, il y a le poids des attentes sociales et familiales : la pression pour remplir des rôles domestiques rend très difficile la conciliation entre recherche et responsabilités personnelles. Ensuite, l’accès aux financements et aux opportunités — telles que les bourses, conférences, collaborations internationales — est souvent limité, soit par manque d’information, soit à cause de réseaux dominés par les hommes. Pourtant, mener des projets de recherche exige des ressources financières conséquentes.
L’un des enjeux techniques majeurs réside dans l’accès aux données. Que celles-ci soient qualitatives ou quantitatives, leur inaccessibilité, combinée parfois à une maîtrise insuffisante des outils d’analyse, freine fortement l’avancée scientifique, surtout chez les jeunes chercheures sans formation ciblée ni mentorat.
Enfin, les stéréotypes sur la compétence des femmes — notamment dans les disciplines quantitatives ou techniques — nuisent à leur crédibilité professionnelle. Ces préjugés peuvent ralentir leur progression, réduire leur visibilité dans les publications ou les conférences, et amener certains enseignants à refuser de les encadrer, particulièrement si elles sont mariées ou mères.
Existe-t-il des différences selon les générations, entre jeunes chercheuses et doyennes ?
Dr Kadia Cissé : En réalité, les obstacles sont les mêmes, génération après génération. Les difficultés ne disparaissent pas avec l’expérience : qu’il s’agisse d’accès à la reconnaissance, aux financements ou de faire face aux préjugés, les freins structurels persistent.
Comment parvenez-vous à concilier vos responsabilités académiques et vos engagements personnels ?
Dr Kadia Cissé : J’adopte une organisation rigoureuse et réaliste. Je hiérarchise constamment mes tâches en distinguant l’urgent de l’important, et je planifie mes activités selon les priorités. Je m’efforce de maintenir un équilibre entre les attentes sociales et mes projets personnels. Lorsqu’une opportunité de mobilité ou de bourse se présente, j’ose solliciter le soutien de mes proches, consciente que tout ne sera pas parfait, mais que chacune de mes réussites peut servir d’exemple pour d’autres femmes.
Quels conseils pratiques donneriez-vous aux jeunes femmes souhaitant se lancer dans la recherche scientifique ?
Dr Kadia Cissé : Apprenez à organiser efficacement votre temps et à trouver un équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Croyez en votre légitimité, refusez d’être intimidée ou influencée, et n’hésitez pas à demander de l’aide, qu’elle soit académique ou familiale. Postulez activement à des appels à candidatures, des séminaires, des colloques, des bourses. Intégrez des groupes de doctorantes, des réseaux de chercheurs — car la recherche n’aime pas l’isolement ; c’est en cultivant la collaboration, l’échange et la solidarité que l’on avance plus loin et plus loin.