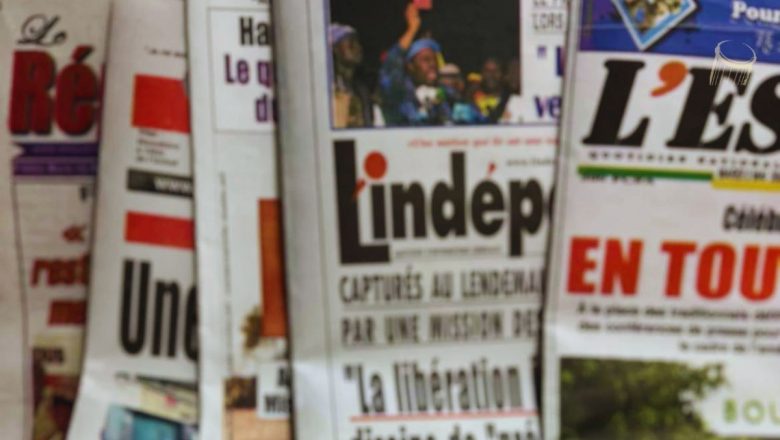Depuis 2021, la situation de la liberté de la presse au Mali régresse de manière alarmante. La situation des médias et des journalistes n’a cessé de se détériorer dans le pays ces dernières années, au point d’inquiéter tant les acteurs nationaux qu’internationaux.
Le rapport 2025 sur la situation de la liberté de la presse dans le monde de Reporters Sans Frontières (RSF), publié le 2 mai 2025, est sans équivoque et dresse un constat préoccupant au Mali. Le pays chute au 119e rang mondial sur 180 en matière de liberté de la presse, perdant 5 places par rapport à l’année précédente. À titre de comparaison avec ses alliés de la Confédération des États du Sahel (AES), le Mali se classe derrière le Niger (83ème) et le Burkina Faso (105ème).
Globalement, sur les 4 dernières années, le Mali a perdu 20 places dans le classement, passant de la 99ème place en 2021 à la 119ème place en 2025. Cette dégradation continue de la liberté de la presse dans le pays est provoquée, selon certains analystes, par l’instabilité politique, les pressions exercées sur les médias, les enlèvements de journalistes et les restrictions imposées à certains médias internationaux.
LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ
« En principe, les journalistes et les médias sont libres de couvrir l’administration, et les médias privés sont relativement indépendants. Cependant, les journalistes sont particulièrement fragilisés par la situation politique et le durcissement du régime militaire au pouvoir », souligne le rapport de RSF, qui alerte également sur les pressions pour un « traitement patriotique » de l’information, qui se multiplient, et sur les correspondants des médias étrangers, devenus persona non grata.
Une situation aux causes multiples
Le recul continu de la liberté de la presse au Mali résulte d’un enchaînement de facteurs politiques, sécuritaires et institutionnels qui se sont cristallisés au fil des années, particulièrement depuis 2012, mais qui se sont intensifiés après le renversement du régime de l’ancien président Ibrahim Boubacar Keita en 2020.
À en croire certains rapports d’organismes internationaux, à l’instar de Freedom House, les signalements de censure, d’autocensure et de menaces contre les journalistes ont considérablement augmenté depuis lors, entraînant une fermeture progressive de l’espace civique, notamment médiatique.
Le cadre législatif de la presse au Mali est également problématique. Bien que la liberté de la presse soit consacrée par la Constitution, plusieurs lois continuent de permettre des poursuites judiciaires contre les journalistes pour des délits d’opinion. La loi sur la cybercriminalité, notamment, est parfois utilisée pour poursuivre des blogueurs ou des journalistes qui s’expriment sur les réseaux sociaux. Le 9 avril dernier, Alhousseiny Togo, directeur de publication du *Canard de la Venise*, a été placé sous mandat de dépôt pour un article jugé critique envers le ministre de la Justice.
Pour l’avocat Maître Cheick Oumar Konaré, « tant que ces lois ne seront pas réformées, la liberté d’expression restera précaire au Mali. Il faut dépénaliser les délits de presse, garantir un accès réel à l’information publique et protéger juridiquement les journalistes. »
Selon les observateurs, l’hostilité ouverte envers certains médias internationaux, perçus comme « hostiles » au régime militaire, constitue un autre facteur important du recul de la liberté de la presse dans le pays.
« La suspension de RFI et France 24 continue de contribuer à la dégringolade du Mali au classement RSF, car ce sont des chaînes qui étaient des sources majeures d’information pour de nombreux Maliens, en l’occurrence RFI, particulièrement en zone rurale », explique un professionnel des médias qui a requis l’anonymat.
Quels impacts ?
Le recul de la liberté de la presse au Mali ne constitue pas seulement une atteinte aux droits fondamentaux des journalistes et des médias, mais il engendre également des conséquences sur l’ensemble du tissu social, économique et politique du pays.
Si les journalistes ne sont pas libres ou sont soumis à une menace continue de censure, voire d’autocensure, la qualité de l’information accessible au citoyen est affectée. La conséquence directe est la montée des récits partisans, qui circulent de plus en plus sur les réseaux sociaux, où les avis critiques sont étouffés.
Par ailleurs, le recul de la liberté de la presse nuit à la transparence et à la redevabilité des gouvernants, comme l’indique un rédacteur en chef d’un journal de la place. « Dans un contexte où les journalistes n’ont plus toute la liberté d’enquêter, de questionner ou de dénoncer les abus, les dérives du pouvoir peuvent se multiplier à huis clos. La corruption, le népotisme ou encore les violations des droits humains peuvent ainsi prospérer dans l’ombre, sans que les citoyens n’en soient informés ni que les responsables soient tenus pour compte », glisse cet interlocuteur.
Les impacts de la situation sont tout aussi alarmants sur le plan économique. Du point de vue de l’analyste politique et économique Amadou Sidibé, le recul de la liberté de la presse envoie un signal négatif aux investisseurs, notamment étrangers, qui voient dans un environnement médiatique restreint un indicateur d’instabilité ou d’opacité.
« Pour les bailleurs de fonds comme pour les entreprises privées, la liberté d’informer est un gage de transparence institutionnelle, de climat des affaires sain et de prévisibilité. En réduisant cette liberté, le Mali se prive d’un facteur important d’attractivité économique, au moment même où il tente de relancer son développement dans un contexte sécuritaire et politique déjà fragilisé », insiste-t-il.
Une amélioration indispensable
Pour inverser la tendance au recul de la situation de la liberté de la presse au Mali depuis plusieurs années, des mesures concrètes et complémentaires peuvent être mises en œuvre.
Pour plusieurs observateurs, notamment internationaux, il est d’abord important de renforcer l’indépendance des institutions de régulation des médias, à commencer par la Haute Autorité de la Communication (HAC), qui doit être dotée de garanties structurelles et juridiques lui permettant d’agir sans pression politique.
Ensuite, une réforme en profondeur du cadre juridique qui régit le travail de la presse pourrait contribuer à améliorer la liberté des journalistes et des médias dans l’exercice du métier.
« La dépénalisation des délits de presse, notamment la diffamation, permettrait d’éviter les peines d’emprisonnement qui dissuadent le travail d’investigation », affirme un journaliste ayant requis l’anonymat.
« Par ailleurs, l’adoption d’une loi sur l’accès à l’information publique faciliterait le travail des journalistes et renforcerait la transparence dans la gestion des affaires de l’État », ajoute-t-il.
Pour ce dernier, le gouvernement devrait également garantir une meilleure protection des journalistes, en particulier dans les zones de conflit, en mettant en place un mécanisme national de veille, de protection et de réponse rapide en cas de menace.
Si les autorités du pays sont appelées à mettre en œuvre diverses mesures, les organes de presse et les journalistes eux-mêmes pourraient également contribuer à une nette amélioration de la liberté de la presse au Mali.
Une meilleure formation des journalistes et le renforcement de l’éthique professionnelle dans les médias peuvent concourir à élever le niveau du débat public, car, estime un analyste, en encourageant l’autorégulation via des conseils de presse ou des chartes de déontologie, les médias maliens peuvent renforcer leur crédibilité auprès du public.
« L’amélioration de la liberté de la presse au Mali ne se résume pas à lever des restrictions. Cela passe par une volonté politique réelle, un soutien institutionnel renforcé et un engagement de tous les acteurs à défendre un journalisme libre, responsable et au service du citoyen », conclut Amadou Sidibé.
Mohamed Kenouvi