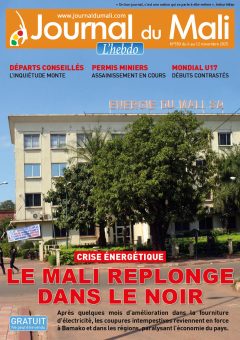La tension diplomatique entre Bamako et Alger ne faiblit pas depuis l’incident survenu dans la nuit du 31 mars au 1ᵉʳ avril 2025, lorsqu’un drone de reconnaissance malien a été abattu par les forces algériennes près de Tinzaouaten, une zone frontalière stratégique. Le différend est désormais bloqué par le refus de l’Algérie d’accepter la compétence de la Cour internationale de Justice (CIJ).
Selon Bamako, le drone Bayraktar Akıncı menait une mission de surveillance contre des groupes armés près de la frontière et n’a jamais quitté l’espace aérien malien. Les autorités affirment que les débris ont été retrouvés à 9,5 kilomètres à l’intérieur du pays et que les données de trajectoire confirment cette version. Alger soutient de son côté que l’appareil a violé son espace aérien et que son interception relevait de la défense de son territoire.
Le différend a pris une dimension juridique le 4 septembre, lorsque Bamako a annoncé son intention de saisir la Cour internationale de Justice pour violation de sa souveraineté. La CIJ a confirmé avoir reçu la requête introductive d’instance le 16 septembre 2025 et rappelé, dans un communiqué publié le 19, qu’elle ne pouvait se prononcer sur le fond qu’avec l’accord des deux États, condition qu’Alger refuse pour l’instant, laissant la procédure suspendue.
LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ
Le 26 septembre, à la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a dénoncé ce qu’il qualifie « d’ingérences répétées » de l’Algérie dans les affaires internes du Mali. Dans son intervention, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a pour sa part critiqué la conduite des autorités de transition maliennes, mettant en cause leurs choix politiques et leur attitude vis-à-vis des partenaires régionaux. En réaction à ces propos, la Mission permanente du Mali a réaffirmé que le drone abattu n’avait jamais quitté son espace aérien, soulignant que les données de vol et la localisation de l’épave, retrouvée à 9,5 kilomètres à l’intérieur du pays, contredisent les affirmations algériennes. Le gouvernement indique également avoir réclamé des preuves à Alger, sans obtenir de réponse satisfaisante, estimant que ce silence, combiné au refus d’accepter la compétence de la CIJ, reflète un embarras évident. L’Algérie maintient pour sa part que l’appareil a violé son espace aérien et justifie son interception par la défense de sa souveraineté.
Leviers diplomatiques
Face au blocage juridique, Bamako mise désormais sur la diplomatie pour faire avancer son dossier. Il peut mobiliser ses alliés stratégiques, notamment la Russie, dont les relations économiques et sécuritaires étroites avec Alger – ainsi que son statut de membre permanent du Conseil de sécurité – pourraient lui permettre de peser sur les négociations ou de favoriser un dialogue indirect. Le Mali peut aussi s’appuyer sur la Confédération des États du Sahel (AES), qui réunit Bamako, Niamey et Ouagadougou, afin d’exercer une pression collective sur Alger, au-delà de leur coopération sécuritaire.
Parallèlement, Bamako peut saisir des instances régionales telles que l’Union africaine et ses organes, notamment le Conseil de paix et de sécurité ou la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, afin de favoriser une médiation ou d’examiner la situation sous l’angle de la protection des droits garantis par la Charte africaine.
D’autres exemples
L’histoire récente montre d’ailleurs que des refus initiaux d’accepter la compétence de la CIJ n’ont pas toujours mis fin aux procédures. Dans les années 1980, les États-Unis avaient rejeté la compétence de la Cour dans leur différend avec le Nicaragua, mais celle-ci a tout de même rendu un jugement en leur absence. Dans l’affaire de la bande d’Aouzou, la Libye avait d’abord refusé de comparaître, avant de conclure un compromis avec le Tchad, permettant une décision en 1994. De même, le différend frontalier entre le Qatar et Bahreïn s’est soldé par un accord en 1997, après des discussions bilatérales.
Au-delà du cadre africain, d’autres mécanismes pacifiques restent envisageables, comme la médiation ou la conciliation sous l’égide des Nations unies, pour tenter d’aboutir à un règlement sans recourir à une procédure judiciaire classique.
Pour l’heure, le dossier est bloqué puisque, sans l’accord de l’Algérie, la CIJ ne peut se prononcer sur le fond. Bamako devra désormais miser sur la mobilisation de ses alliés et les canaux multilatéraux pour faire avancer le différend et défendre sa position.
MD