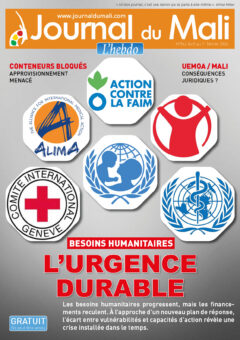Un rapport d’Oxfam révèle la réalité vécue par les civils du Mali et du Sahel face à la violence persistante. Derrière les bilans diplomatiques, une parole s’élève pour réclamer une paix adaptée aux réalités locales, plus humaine et plus inclusive.
Les civils du Mali, comme ceux du Sahel en général, vivent au cœur d’une insécurité chronique où les armes dictent souvent la loi. Le rapport Seen but Not Heard, publié par Oxfam en octobre 2025, plonge dans leur quotidien. Il s’appuie sur les témoignages de 1 601 personnes réparties entre le Mali, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud, dont 765 femmes et 836 hommes. L’enquête, menée entre juillet 2024 et mars 2025, restitue leurs expériences face aux acteurs censés les protéger.
Au Mali, les récits recueillis montrent à quel point la population reste prise entre plusieurs forces. Toutes jouent un rôle, mais la confiance qu’on leur accorde varie d’un village à l’autre. Beaucoup de Maliens disent avoir perdu foi dans un système qui promet la paix sans la livrer.
LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ
L’exemple de la MINUSMA, déployée de 2013 à 2023, illustre cette ambivalence. Dans le nord, notamment à Gao, plusieurs habitants reconnaissent que la mission a contribué à stabiliser certaines zones et à créer de l’emploi. Plus au centre, dans les régions de Mopti et de Ségou, la perception est tout autre : les habitants se disent déçus d’une présence jugée distante et trop bureaucratique. Certains estiment que les casques bleus n’ont pas su écouter les besoins des populations ni s’adapter à leurs priorités.
Depuis son départ, les Maliens oscillent entre fierté et inquiétude. Fierté, parce que la fin de la mission est perçue par une partie de l’opinion comme un acte de souveraineté retrouvée. Inquiétude, parce que l’État reste fragile et que la protection des civils repose souvent sur des initiatives locales. Dans plusieurs localités, Oxfam a observé la montée de comités de veille, de groupes de médiation et de collectifs de femmes qui préviennent les tensions ou réparent les liens entre communautés. Ces structures, parfois soutenues par des ONG, s’imposent comme des relais essentiels de la cohésion sociale.
Le rapport situe ce phénomène dans un contexte régional plus large. À travers tout le Sahel, la confiance envers les forces internationales s’est érodée. Les missions onusiennes, tout en ayant contribué à contenir la violence, ont fini par se heurter aux attentes de populations qui veulent désormais construire leur propre sécurité. Dans le même temps, les États revendiquent un contrôle total de leurs territoires, préférant miser sur des partenariats bilatéraux ou sur des forces régionales.
Oxfam conclut que le modèle actuel du maintien de la paix est à bout de souffle. Les populations ne rejettent pas l’idée d’une présence internationale, mais elles réclament d’être entendues. Pour beaucoup de Maliens, la paix ne viendra pas d’un mandat ni d’une base militaire, mais d’une écoute plus attentive et d’un soutien réel aux initiatives communautaires.
Au-delà des institutions, ce sont donc les habitants du Sahel qui, malgré la fatigue et les blessures, réinventent la paix à leur manière — avec les moyens du bord, et la volonté farouche de continuer à vivre.