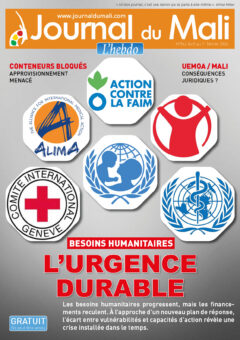Alors que le Mali consacre le mois d’octobre à la solidarité et à l’inclusion, Mme Rokiatou Diakité, Présidente du Réseau des Femmes Leaders d’Afrique Francophone, appelle à un engagement renouvelé pour les droits des filles. Trente ans après Beijing, elle estime que les promesses doivent enfin se traduire en actions concrètes.
Quel regard portez-vous sur la situation des filles au Mali aujourd’hui ?
Les filles du Mali continuent de faire face à de multiples obstacles pour accéder à leurs droits fondamentaux. L’abandon scolaire, les mariages précoces, les violences basées sur le genre et le manque d’accès à la santé reproductive limitent encore leur plein épanouissement. Près d’une fille sur deux quitte l’école avant le secondaire et dans les zones rurales beaucoup restent enfermées dans des traditions qui freinent leur autonomie. Pourtant, je rencontre chaque jour des filles déterminées, créatives et ambitieuses, qui prouvent que le changement est possible.
LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ
Où se situent selon vous les principaux manquements dans la protection de leurs droits ?
Les inégalités persistent, malgré les cadres légaux existants. Le manque de ressources, la faible application des lois et l’insuffisance de données freinent les avancées. Trop souvent, les politiques publiques ne tiennent pas compte de la réalité des filles sur le terrain. L’éducation est la clé : lorsqu’une fille a accès à l’école et à la formation, elle gagne en indépendance et contribue au développement de toute sa communauté. L’enjeu aujourd’hui, c’est de rendre ces droits effectifs et accessibles à toutes.
Vous venez de participer au Sommet des Filles d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Qu’en retenez-vous ?
C’était un moment fort. Ce sommet a donné la parole aux filles de la région, leur permettant de partager leurs expériences et leurs aspirations. Elles ont parlé de pauvreté, de violences, mais aussi d’espoir et de leadership. J’ai vu une jeunesse déterminée à ne plus subir, mais à agir. Cette énergie, il faut l’accompagner. Les gouvernements et les partenaires doivent écouter ces voix, intégrer leurs priorités et soutenir leurs initiatives locales.
Trente ans après la Déclaration de Beijing, les progrès sont jugés lents. Pourquoi selon vous ?
Les promesses de Beijing ont inspiré toute une génération, mais les résultats sont fragiles faute de volonté politique et de moyens suffisants. Il est temps de renforcer les budgets consacrés à l’éducation des filles, à la santé reproductive et à la lutte contre les violences. Et, surtout, de garantir leur place dans les espaces de décision. Donner à chaque fille la possibilité d’apprendre, de s’exprimer et de diriger, c’est construire un avenir plus juste et plus fort pour notre pays et pour l’Afrique.