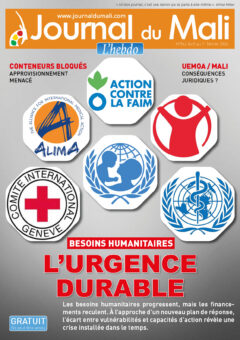La 4ème édition de la Semaine Nationale de la Réconciliation se déroule du 15 au 21 septembre 2025 à Bamako. Trois ans après sa création, ce rendez-vous, voulu comme un temps fort pour panser les plaies du Mali, peine encore à traduire ses promesses en résultats concrets.
Instituée par la Loi d’Entente Nationale de 2019, la SENARE a été lancée pour la première fois en 2022. Elle devait servir de cadre symbolique et pédagogique pour sensibiliser les citoyens aux valeurs de paix, de cohésion et de vivre-ensemble. Chaque année, la semaine est marquée par des conférences, des débats, des émissions en langues nationales, des expositions artistiques, des prières collectives, des campagnes de reboisement et des panels sur le rôle des femmes. L’édition 2025, ouverte au Centre international de conférences de Bamako, a pour thème « Héritage culturel : facteur de paix et de cohésion sociale dans l’espace AES », dans une volonté affichée de puiser dans les ressources culturelles pour renforcer l’unité.
Au fil des quatre éditions, les organisateurs ont multiplié les activités de sensibilisation et les symboles de rassemblement. Pourtant, les résultats tangibles restent limités. Aucun élément ne montre que la SENARE ait permis de renouer un dialogue direct avec les groupes armés hostiles à l’État. Ni le Front de libération de l’Azawad, ni les organisations jihadistes comme le Groupe de soutien à l’Islam et aux Musulmans (JNIM), lié à Al-Qaïda, ou la branche sahélienne de l’État islamique n’ont pris part au processus. Tous, qui se combattaient parfois entre eux, semblent désormais considérer l’État comme leur adversaire commun. Le dialogue reste donc rompu et les lignes de fracture demeurent inchangées.
LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ
L’insécurité monte en flèche
La situation sécuritaire illustre cette impasse. Plusieurs axes stratégiques restent sous la menace de blocus imposés par les groupes armés. La route Bamako – Diéma – Kayes, celle de Nioro, la RN16 reliant Sévaré à Gao, la RN17 menant vers le Niger ou encore la RN20 en direction de Koutiala, Sikasso et Bougouni, sont régulièrement citées parmi les corridors les plus exposés. Les opérations militaires menées par l’armée, appuyées par des couvre-feux locaux, témoignent de la gravité des menaces. Mais la violence n’a pas été circonscrite et la libre circulation reste compromise dans plusieurs régions.
Tensions politiques
Le contexte politique ajoute à la complexité. La dissolution de tous les partis, la détention de figures politiques et l’exil de leaders d’opinion pèsent sur le climat national. Dans ces conditions, la réconciliation prônée pendant la SENARE peine à trouver un écho concret. D’ailleurs, la remise en juillet 2025 de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation, texte de 16 titres, 39 chapitres et 106 articles, devait offrir un cadre de référence. Mais une interrogation demeure : combien d’opposants ou de groupes hostiles à l’État se reconnaissent dans ce document ? À ce jour, aucun indicateur ne permet de confirmer son appropriation réelle.
La SENARE a donc mis en avant des initiatives de sensibilisation, des activités culturelles et des gestes symboliques, mais elle n’a pas encore permis de réduire les violences ni de poser les bases d’un dialogue politique inclusif. Elle a surtout fonctionné comme un instrument de communication nationale, sans créer l’espace attendu de médiation entre l’État et les groupes armés.
Des succès
Des comparaisons internationales offrent des points de repère. En Côte d’Ivoire, après la crise de 2010 – 2011, le Dialogue politique avait intégré des représentants d’anciens groupes armés et abouti à des libérations conditionnelles. Au Rwanda, les juridictions communautaires Gacaca ont été instaurées après le génocide pour favoriser une justice de proximité et une réconciliation enracinée dans les communautés. Ces expériences montrent que la réconciliation durable exige des mécanismes inclusifs, continus et institutionnalisés, allant au-delà d’une simple semaine commémorative.
Après quatre éditions, la SENARE demeure un espace de sensibilisation utile, mais elle n’a pas encore produit les résultats attendus en termes de paix et de cohésion nationale. Le risque est que cette initiative devienne une cérémonie parmi d’autres, sans la portée particulière qu’elle mérite. L’urgence, pour l’État comme pour les acteurs de la société, est de transformer cette semaine en un véritable levier de dialogue et d’actions concrètes afin qu’elle s’inscrive dans le quotidien des Maliens bien au-delà de ses dates officielles.
MD