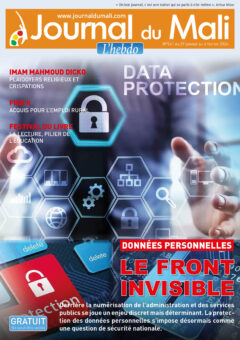À l’École de la citoyenneté, le programme prépare sa 4ème cohorte. Les jeunes de 18 à 35 ans peuvent postuler jusqu’au 30 juin et les formations se dérouleront du 10 au 24 juillet 2025 au Palais des Pionniers pour Bamako et du 11 au 21 juillet 2025 pour les régions. Sidi Dicko, Président du Comité d’exécution du programme à l’École de la citoyenneté (ECI), revient pour nous sur les objectifs, les résultats déjà atteints et les perspectives. Propos recueillis par Fatoumata Maguiraga
Pourquoi une École de la citoyenneté et qu’est-ce qu’elle vise ?
L’École de la citoyenneté est un programme du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, qui vise à inculquer aux jeunes l’esprit patriotique en vue d’en faire des bâtisseurs et des défenseurs de la Nation, prêts à répondre à l’appel et à devenir des citoyens engagés et dévoués. L’école prépare sa 4ème cohorte. Les 1ère et 2ème ont formé 200 jeunes chacune à Bamako, regroupant les régions. La 3ème était une cohorte spéciale organisée à l’intention des Présidents élus des bureaux du Conseil national de la jeunesse (CNJ). Elle a réuni 700 jeunes.
Nous préparons la cohorte de Bamako et de sept régions ciblées (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao). À Bamako, 400 jeunes seront formés, 300 pour Bamako et ses environs et 100 de la diaspora et des pays de l’AES, durant 15 jours (Du 10 au 24 juillet). La vision est de former toute la jeunesse, mais nous y allons par étape.
De la 1ère édition à maintenant, quels résultats avez-vous atteints ?
Nous avons commencé par 200 jeunes. Cette année, on prévoit 400 jeunes à Bamako et 200 par région, soit un total de 1 800 jeunes. En plus, le réseau de communication est large, car les panels sont diffusés sur les réseaux sociaux. Une des sessions a même enregistré 500 000 vues.
Que deviennent les jeunes formés ?
La plupart des jeunes formés deviennent très actifs. Ils participent aux activités d’assainissement dans leurs communautés, à la sensibilisation sur la circulation routière. En outre, il leur est demandé de restituer la formation reçue auprès d’autres jeunes et des autorités dans les régions. Ils sont aussi sollicités dans le cadre d’activités de volontariat, par exemple dans les brigades citoyennes. Ils deviennent des acteurs engagés, ce qui incite d’autres jeunes à les suivre. Depuis l’ouverture des candidatures le 15 juin, plus de 1 330 jeunes ont déjà postulé en ligne. Il y a beaucoup d’engouement car les jeunes ont besoin de cette formation.
Certains critères de sélection, comme l’appartenance à un mouvement associatif, ne risquent-ils pas d’exclure beaucoup de jeunes ?
Un jeune qui n’a jamais été à l’école a évoqué le critère du niveau d’études. Il peut postuler, car nous avons besoin de former toute la jeunesse, y compris ceux qui n’ont jamais été à l’école ou appartenu à une association. Il y a des critères que nous ne pouvons pas changer, mais qui ne sont pas obligatoires. Le programme est inclusif et s’adapte. Les formateurs s’expriment aussi en langues nationales.
Sept régions sont pour le moment concernées, et les autres ?
Lors des cohortes passées, les jeunes de toutes les régions ont participé, avec des représentants envoyés à Bamako. Des régions vont rejoindre chaque région ciblée. Par exemple, Sikasso regroupera les jeunes de Bougouni et Koutiala, Mopti, ceux de Bandiagara et Douentza pour la cohorte prévue du 11 au 21 juillet 2025.
Quelles leçons avez-vous tirées des précédentes éditions ? Quelles améliorations allez-vous apporter ?
Beaucoup de leçons ont été tirées, notamment le constat de l’amour que les jeunes ont pour la vie en groupe. Ils apprennent des choses qu’ils n’ont pas eu la chance d’apprendre à l’école. Ce sont aussi des jeunes qui partagent, ce qui attire les autres. Ils bénéficient d’un accompagnement et deviennent volontaires dans plusieurs domaines. Le programme prévoit des innovations et chaque cohorte bénéficie d’améliorations dans les modules. Au-delà du civisme, ils reçoivent aussi des formations en entrepreneuriat, etc.
Quels sont les modules enseignés ?
Introduction au civisme et à la citoyenneté, connaissances traditionnelles sur la société malienne, soirées éducatives « Danbé ni Maaya », culture de la conscience patriotique, connaissance du Mali, diplomatie culturelle, usage des médias sociaux, éducation aux valeurs, etc. Autrefois, les jeunes apprenaient des choses en dehors de l’école, auprès des grands-parents. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. C’est cette opportunité que nous voulons leur redonner.