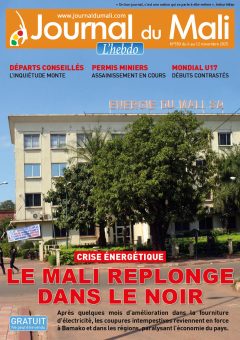Depuis le coup d’État du 18 août 2020, le Mali vit une transition charnière, marquée par des bouleversements politiques, des choix stratégiques majeurs et des mutations profondes dans les domaines sécuritaire, économique, socio-politique et de gouvernance. Cinq ans après, le bilan reste contrasté, entre acquis indéniables et insuffisances persistantes.
Débutée officiellement en septembre 2020, avec l’investiture du Colonel-major à la retraite Bah Ndaw à la Présidence, la première phase de la Transition s’est étendue jusqu’au coup de force de mai 2021, qui a porté le Colonel Assimi Goïta, alors Vice-président chargé des questions de Défense et de Sécurité, à la tête de l’État.
Ces huit premiers mois n’ont pas connu de réalisations majeures, si ce n’est la mise en place des organes institutionnels de la Transition. Depuis mai 2021, une nouvelle dynamique a été engagée, avec un recentrage des priorités sur la Défense, la souveraineté économique et la refondation politique.
LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ
Reconquête territoriale et montée en puissance des FAMa
Dès sa prise de fonction, le Président de la Transition, Assimi Goïta, a donné pour instruction de « remettre l’armée sur pied ». La priorité accordée à la Défense s’est traduite par le recrutement de 9 500 personnels supplémentaires, toutes catégories confondues, afin de répondre aux engagements opérationnels et de stabiliser les zones autrefois contrôlées par les groupes armés terroristes.
Selon le ministre de la Défense, Sadio Camara, la situation sécuritaire du pays est « totalement sous contrôle ». « Le Mali est capable de contrôler son ciel, ses frontières et d’assumer ses choix. »
Pour sa part, le Premier ministre Abdoulaye Maïga affirme : « en 2012, nous avons perdu plus de 70% de notre territoire au profit des groupes terroristes. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Peu de pays peuvent se targuer d’une telle inversion de tendance en deux ou trois ans ».
Des efforts ont été portés sur la modernisation des infrastructures militaires, l’implantation stratégique sur le territoire et l’acquisition d’équipements militaires : avions de combat, drones, véhicules tactiques blindés, engins logistiques et ambulances.
Malgré ces avancées, les attaques persistent le long des axes routiers et dans certaines zones urbaines. Les autorités reconnaissent ces incursions, tout en estimant qu’elles ne sont que « des tentatives de marquer une présence » de groupes terroristes « presque en fin de vie », selon les mots de Sadio Camara. L’amélioration de la sécurité reste toutefois un objectif prioritaire du Plan d’action gouvernemental.
Réformes et controverses
Sur le plan institutionnel, la Transition a vu, entre autres réformes, l’adoption d’une nouvelle Constitution, la création de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) et une nouvelle Loi électorale.
En mai 2025, la dissolution de tous les partis politiques a provoqué une vive controverse, suivie de la saisie des juridictions nationales par certains responsables des formations dissoutes, dont les jugements sont prochainement attendus.
Le Premier ministre Abdoulaye Maïga s’en défend : « il n’y a aucune volonté de porter un coup au multipartisme, qui est consacré par la Constitution. Il s’agit de mieux encadrer le monde politique ».
Parallèlement, des organisations de défense des droits humains dénoncent un rétrécissement de l’espace démocratique, évoquant des arrestations extrajudiciaires et des détentions d’opinion.
Par ailleurs, la lutte contre la corruption a été érigée en priorité. Des procès sur les questions de détournement et de corruption ont été tenus, parmi lesquels l’affaire de l’achat de l’avion présidentiel et des équipements militaires, où les principaux accusés ont été condamnés.
Une Stratégie nationale, avec son Plan d’actions 2023-2027 met l’accent sur la prévention et la sensibilisation, mais aussi sur la répression. Les rapports d’audit sont désormais transmis systématiquement au Pôle économique et financier et une Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis a été créée.
Résilience économique et réformes structurelles
Selon le ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, « l’économie du Mali se porte bien », avec un taux d’inflation de 3,2%, le deuxième taux le plus bas de la sous-région. A l’en croire, le chômage est passé de 6,5% en 2020 à 3,5% en 2024. L’institut national de la statistique (INSTAT) explique que ce taux bas est le « reflet d’une économie dominée par le secteur informel et l’agriculture de subsistance, qui absorbe une grande partie de la main-d’œuvre, même si les emplois générés sont souvent précaires et peu rémunérés »
L’État a maintenu un effort massif de subventions, notamment à l’Énergie du Mali (461 milliards de francs CFA entre 2021 et 2024), aux sociétés de production de ciment, à la transformation du blé et aux produits pétroliers.
La relance de la filière coton a constitué un levier majeur. En réglant les impayés de 69 milliards de francs CFA et en fixant un prix incitatif (De 290 à 300 francs CFA/kg), le gouvernement a permis à la Compagnie malienne pour le développement du textile (CMDT) d’atteindre une production record de 795 000 tonnes en 2021-2022. Quatre millions de Maliens vivent directement de cette filière, qui a retrouvé son rôle moteur dans l’économie nationale. Toutefois la campagne cotonnière 2025-2026 est minée par des retards de paiements, des livraisons d’intrants insuffisantes et une nouvelle invasion de jassides.
D’autres entreprises en difficulté ont été relancées, comme la COMATEX et l’UMPP, avec des injections financières ciblées. Le Fonds de garantie pour le secteur privé est passé de 20 à 28 milliards de francs CFA, permettant de générer 150 milliards de crédits et de créer 17 000 emplois.
En dépit des indicateurs économiques au vert, une grande partie de la population malienne reste confrontée à des difficultés au quotidien. Selon un ancien responsable politique, les maux dont se plaignaient les Maliens sous le régime d’IBK sont toujours d’actualité. « Les Maliens se plaignaient de la cherté de la vie et d’un pouvoir d’achat insuffisant. Aujourd’hui, ces difficultés persistent et leurs charges ont largement augmenté avec la flambée des prix », déplore-t-il.
Un secteur minier stratégique
Le secteur minier a connu une réforme majeure, avec l’adoption en 2023 d’un nouveau Code minier et d’une loi sur le Contenu local. L’État a désormais la possibilité de détenir jusqu’à 30% des actions dans les nouveaux projets miniers, auxquels s’ajoutent 5% pour le secteur privé national.
Ce changement a permis d’accroître les recettes publiques. « Nous sommes passés de 235,5 milliards à 767,4 milliards de recettes, soit un gain de 531,9 milliards », se félicite Alousseini Sanou. La création en 2022 de la Société de recherche et d’exploitation des ressources minérales du Mali (SOREM) a ouvert la voie à la relance des mines déjà acquises, comme celles de Morila, Yatéla et Tassiga.
Le pays a inauguré en décembre 2024 la mine de lithium de Goulamina, où 85 000 tonnes ont déjà été produites et 35 000 exportées. La mine de Bougouni est en phase finale de préparation. En juin 2025, la première pierre d’une raffinerie nationale d’or d’une capacité de 200 tonnes par an a été posée, l’État y détenant 62% du capital, afin de contrôler la production aurifère et sa traçabilité.
Crise énergétique et efforts de relance
Depuis 2022, le Mali traverse une crise énergétique sans précédent, qui a lourdement pesé sur les entreprises dans plusieurs domaines et sur le secteur informel. Cependant, depuis le mois de mars 2025, une amélioration sensible de la fourniture électrique a été constatée, avec 12 à 19 heures d’électricité par jour contre 6 heures auparavant.
À la base de cette amélioration se trouvent les subventions continues de l’État à Énergie du Mali (EDM-SA), mais aussi, et surtout, l’instauration de taxes pour le Fonds de soutien aux infrastructures de base et de développement social. Trois centrales solaires sont également en construction à Safo, Sanankoroba et Tiakadougou Dialakoro depuis mai 2024, mais accusent du retard. « Les difficultés rencontrées sont indépendantes de notre volonté, mais nos objectifs seront atteints », promet le Premier ministre, qui évoque aussi le développement futur de l’énergie nucléaire.
Bilan contrasté
Au terme de cinq années de transition, le Mali a enregistré des avancées notables, notamment dans la reconquête territoriale, le renforcement de l’armée, la réforme du secteur minier et la relance de filières économiques stratégiques comme le coton. La baisse du chômage et la stabilité relative des indicateurs macroéconomiques témoignent d’une certaine résilience.
Cependant, des défis majeurs subsistent, alors que la Transition a été prolongée de cinq ans, renouvelable autant de fois que nécessaire jusqu’à la pacification du pays. Les attaques terroristes continuent de perturber la vie quotidienne, la crise énergétique n’est pas complètement résolue et les restrictions des libertés inquiètent une partie de la société civile et des partenaires extérieurs.
Mohamed Kenouvi