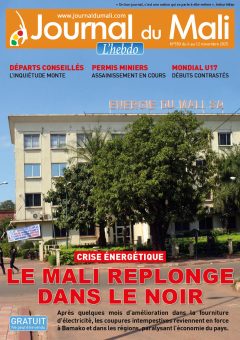Dans cet entretien, le journaliste Alexis Kalambry analyse la dynamique actuelle des groupes armés au Mali et les raisons profondes de leur enracinement. Il estime que seule une réponse combinant sécurité, justice, développement et discours religieux inclusif peut ramener la stabilité durable. Propos recueillis par Mohamed Kenouvi.
Est-ce que l’on comprend clairement aujourd’hui ce que veulent les jihadistes ?
On doit d’abord se poser la question : que veulent-ils ? Parce que, visiblement, ils ont les mêmes attitudes que des terroristes classiques. On ne peut pas dire qu’ils défendent une idéologie précise, puisqu’ils ne conquièrent ni villages ni contrées. Ils viennent, sèment la terreur, puis s’en vont. Ils profitent surtout de la faiblesse et de l’absence de l’État pour s’imposer localement. Ils avancent masqués derrière des causes religieuses, mais leurs motivations réelles sont souvent opportunistes, liées au contrôle social et économique local.
Pourtant, à leurs débuts leurs revendications semblaient plus claires…
Effectivement. En 2012, leur discours portait sur le départ des Occidentaux. Ils disaient : « si la France s’en va, nous n’avons plus de revendication ». Mais aujourd’hui, la France et la MINUSMA sont parties et les jihadistes sont toujours là. Ils continuent de combattre, tout en renouvelant sans cesse leurs prétextes. On ne peut donc plus dire avec certitude ce qu’ils veulent réellement. Aujourd’hui, leurs revendications changent au gré des circonstances. Cela prouve qu’ils s’adaptent plus qu’ils ne défendent une cause fixe.
Comment expliquez-vous alors leur capacité à se maintenir ?
Ils exploitent les divisions communautaires et les différends non résolus par la justice : conflits de terres, oppositions entre éleveurs et sédentaires, rivalités entre villages. Ils s’enracinent en tissant des alliances locales, parfois en se mariant dans les familles de chefs. La crise actuelle, avec son lot de frustrations et de misère, nourrit leur discours. Ils se présentent comme des sauveurs dans un contexte où l’État est absent. Quand la justice n’existe pas ou qu’elle est perçue comme partiale, ces groupes deviennent des arbitres de proximité, ce qui renforce leur ancrage.
Quelle réponse pourrait inverser cette tendance ?
Quelle que soit notre puissance militaire, une guerre ne se gagne pas uniquement par les armes. Il faut le développement, le dialogue et surtout la présence effective de l’État. Mais cela ne suffit pas. Les jihadistes s’appuient sur une idéologie religieuse. Nous devons donc construire un discours religieux alternatif, tolérant et rassembleur. C’est seulement ainsi que nous pourrons espérer une solution durable à cette crise. Il faut une réconciliation locale capable de restaurer la confiance et de combler les vides.