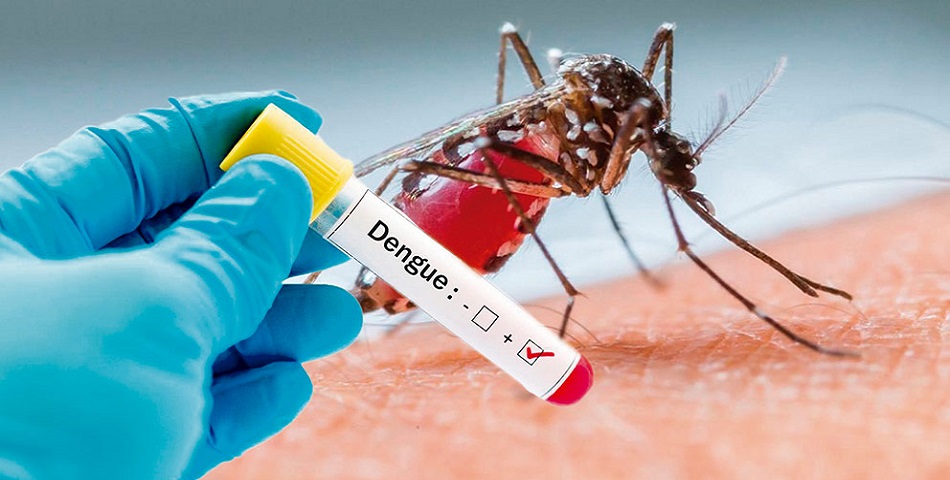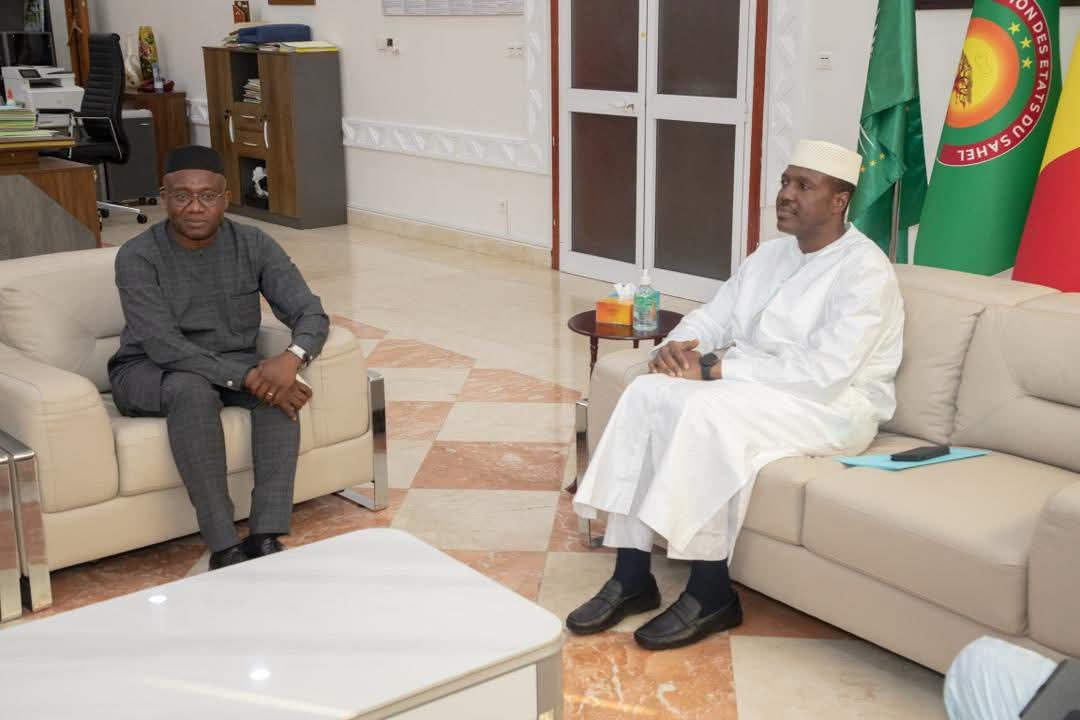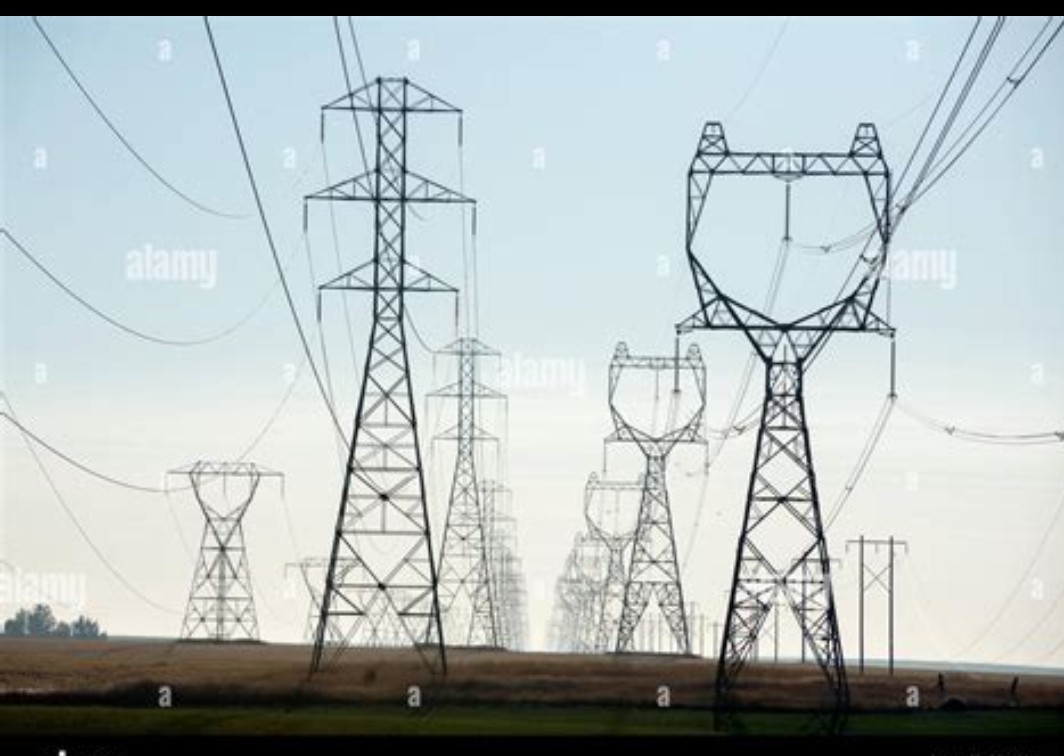Étiquette : Mali
Dengue au Mali : plus de 336 cas confirmés, le président appelle à la vigilance
Le Mali, confronté à une recrudescence inquiétante de la dengue, totalise 336 cas confirmés sur 2 406 suspicions recensées à la mi-avril. Les foyers les plus touchés se trouvent dans les régions de Bamako et Sikasso, d’après le rapport du 16 avril de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Afrique (AFRO‑WHO).
Dans un contexte marqué par la confusion persistante entre dengue et paludisme, le Président de la Transition a prié les citoyens de respecter rigoureusement les mesures de prévention : éliminer les eaux stagnantes, utiliser systématiquement moustiquaires imprégnées et répulsifs, et consulter rapidement un centre de santé en cas de fièvre.
Selon le dernier bulletin hebdomadaire de l’OMS couvrant la période du 1er janvier au 13 avril, 253 cas de dengue ont été confirmés dans quatre districts, avec huit décès, soit un taux de létalité de 3,2 % . Ces données confirment l’urgence de renforcer la surveillance et les soins médicaux spécialisés.
Le malentendu autour des symptômes de la dengue et du paludisme persiste. Les autorités sanitaires rapportent que cette confusion complique la prévention et retarde la prise en charge adaptée des patients. De plus, la circulation de conseils inappropriés sur les réseaux sociaux, incluant l’usage de remèdes traditionnels, accentue ce phénomène.
Dans la lutte contre cette épidémie, la mobilisation communautaire est jugée cruciale. Le ministère de la Santé a intensifié les campagnes publiques, multiplié les messages de sensibilisation sur les ondes et WhatsApp, et organisé des sessions d’information dans les écoles. Les citoyens sont sensibilisés à l’importance d’assainir leur environnement et de solliciter un diagnostic médical en présence de fièvre ou de douleurs inhabituelles .
Comparativement aux données de 2024, où l’Afrique subsaharienne avait enregistré plus de 14 000 cas et 505 décès entre janvier et avril, notamment au Mali (8 709 cas et 39 décès) , la situation de 2025 révèle une dynamique différente, mais reste préoccupante. L’épidémie actuelle s’inscrit dans une évolution globale de la fièvre denguée, particulièrement dans les grandes villes comme Bamako, épicentre de l’épidémie.
Face à cette crise de santé publique, les efforts collectifs sont essentiels. Le Président a rappelé que chaque citoyen a un rôle à jouer : le moindre dépôt d’eau stagnante, la moindre négligence dans l’utilisation des protections individuelles peuvent contribuer à étendre l’épidémie.
Interview de Me Fatoumata Diatigui Diarra, conseil fiscal agréé
Dans un contexte marqué par la recrudescence des saisies de devises à l’aéroport de Bamako, Me Fatoumata Diatigui Diarra, conseil fiscal agréé, décrypte pour nous le cadre juridique encadrant l’exportation physique de devises au Mali. Elle souligne le déficit d’information du public, rappelle les obligations déclaratives prévues par les textes communautaires, et appelle à une meilleure accessibilité des outils bancaires pour freiner les flux illicites.
1. Quel est le cadre juridique malien encadrant l’exportation de devises par voie physique ?
L’exportation de devises par voie physique est encadrée par un corpus de textes communautaires constitué du Règlement n°06/2024/CM/UEMOA relatif aux relations financières extérieures des États membres de l’UEMOA, de l’Ordonnance n°2024-011/PT-RM du 30 août 2024 portant lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (BC/FT/FP), telle que modifiée, ainsi que de ses textes d’application, fixant le seuil pour la déclaration des transports physiques intracommunautaires et internationaux d’espèces et d’instruments négociables au porteur (instructions BCEAO n°231/07/2024 et n°002-02-2025).
Cette réglementation met notamment en place une obligation déclarative à la charge des personnes transportant des espèces ou des instruments négociables au porteur, à partir d’un certain seuil.
L’obligation déclarative est catégorisée parmi les mesures préventives relatives à l’utilisation des espèces. Il s’agit de s’assurer de l’origine et de la destination de ces espèces ou instruments au porteur, et ainsi, de lutter contre le BC/FT/FP.
2. Quels sont les montants soumis à déclaration et quelles sont les sanctions en cas de non-déclaration ?
Aux termes des instructions précitées, toute personne à destination ou en provenance d’un pays tiers de la Zone UEMOA est tenue d’effectuer une déclaration de transport physique d’espèces et d’instruments négociables au porteur auprès de l’Administration des Douanes, à partir d’un seuil de 5 millions de francs CFA.
Le seuil est relevé à 10 millions de francs CFA pour les transports intracommunautaires d’espèces et d’instruments négociables au porteur.
À l’issue de la déclaration, l’Administration des Douanes peut bloquer ou retenir, pour une période n’excédant pas soixante-douze heures, les espèces ou instruments susceptibles d’être liés au BC/FT/FP. Un récépissé est délivré à l’intéressé. Passé ce délai, les fonds sont restitués en l’absence d’infraction constatée.
En cas de non-déclaration, de fausse déclaration, de déclaration incomplète, ou s’il y a suspicion de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de prolifération, l’Administration des Douanes saisit la totalité des espèces retrouvées et dresse un procès-verbal.
Les espèces saisies et une copie du procès-verbal sont transmises au Trésor, à la structure nationale chargée de la gestion des avoirs criminels gelés, saisis ou confisqués, ou à l’organisme en tenant lieu. Le dossier est également envoyé à la Cellule nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), dans un délai de huit jours calendaires.
Il s’agit là de mesures conservatoires, avant toute procédure judiciaire.
3. À votre connaissance, ces règles sont-elles effectivement appliquées sur le terrain, ou souffrent-elles de failles ?
La presse a récemment fait état de saisies à plusieurs reprises, mais n’étant partie à aucune de ces procédures, je ne saurais dire si les dispositions mentionnées ci-dessus ont été rigoureusement suivies.
4. Peut-on considérer que ces flux de cash traduisent un affaiblissement de la fiscalisation et de la confiance dans le système bancaire ?
Ces flux me semblent plutôt refléter nos habitudes culturelles. Les difficultés de mobilisation des recettes fiscales, notamment du fait de l’importance de l’informel dans nos économies, ne sont plus à démontrer. De même, l’inclusion financière, dont un élément essentiel est la bancarisation, demeure au cœur des politiques de la BCEAO, qui consacre chaque année un rapport à ce sujet. C’est dire qu’il s’agit d’une problématique structurelle et toujours d’actualité.
À cela s’ajoute sans doute un déficit de communication autour des réglementations.
5. Quels dispositifs pourraient être renforcés pour lutter efficacement contre les sorties illégales de capitaux et la fraude fiscale transfrontalière ?
À mon avis, l’Administration des Douanes gagnerait à mener une vaste campagne de communication sur ce sujet, compte tenu de notre culture du voyage. Ces sorties illégales de capitaux sont manifestement, d’abord, le résultat de l’ignorance de la réglementation en la matière, et peut-être également du coût élevé des services bancaires.
La mise à disposition de cartes bancaires prépayées constitue une avancée notable, d’ailleurs largement prise en compte par le Règlement UEMOA. Celui-ci précise que les sommes excédant le plafond fixé par la BCEAO peuvent être emportées sous forme de cartes de retrait et de paiement, prépayées ou classiques.
Ces instruments gagneraient à être davantage utilisés, à condition d’être rendus plus accessibles.
Bamako Sénou : Les dessous du trafic silencieux de devises
Des valises remplies d’euros. Des passagers profilés. Des saisies qui se répètent à l’Aéroport international Modibo Keita de Bamako. Ce phénomène discret mais préoccupant traduit une fracture profonde entre l’économie réelle et le système financier formel.
En une semaine, près de 630 000 euros ont tenté de franchir les frontières maliennes, dissimulés non pas dans des circuits financiers, mais dans les bagages de passagers ordinaires. Le 26 mai 2025, les douaniers découvrent 580 150 euros dans les bagages d’un passager en partance pour l’Afrique centrale. Le lendemain, cinq autres voyageurs embarquant pour La Mecque via Istanbul sont interceptés. À eux cinq ils transportent 50 000 euros, répartis pour contourner les limites autorisées. L’argent, remis par un agent de voyage, était destiné à être convoyé discrètement hors du pays. Ces saisies ne sont pas isolées. En novembre 2024, 1,27 million d’euros avaient été confisqués. En août de la même année, 500 000 euros. À cela s’ajoutent plusieurs interpellations sur des vols à destination de Dubaï, du Maghreb ou d’Istanbul. Le montant global des devises interceptées n’est pas officiellement publié, mais les chiffres partiels révèlent un phénomène régulier, étendu et préoccupant.
« L’aéroport de Bamako est devenu un point de sortie stratégique pour des liquidités en espèces », analyse Dr Étienne Fakaba Sissoko, économiste et professeur à l’Université des Sciences sociales et de gestion de Bamako. Selon lui, ces flux ne sont pas anecdotiques mais traduisent un changement profond dans les comportements économiques.
Un cadre légal contourné
En théorie, le transport de devises est strictement encadré par la réglementation malienne et communautaire. Maître Fatoumata Diatigui Diarra, Conseil Fiscal Agréé, précise que le corpus juridique repose notamment sur le Règlement N°06/2024/CM/UEMOA, l’Ordonnance N°2024-011/PT-RM sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, ainsi que sur les instructions BCEAO du 7 juillet 2024 et du 2 février 2025.
Toute personne transportant plus de 5 millions de francs CFA en espèces vers un pays hors de l’UEMOA doit effectuer une déclaration préalable auprès de l’administration des douanes. Ce seuil passe à 10 millions pour les transferts à l’intérieur de la zone communautaire. L’origine des fonds doit être justifiée. En cas de non-déclaration, les espèces peuvent être saisies à titre conservatoire pendant soixante-douze heures, puis transférées au Trésor si une infraction est suspectée. Le dossier est ensuite transmis à la CENTIF.
« Ces mécanismes existent, mais encore faut-il qu’ils soient rigoureusement appliqués », souligne Me Diarra. Elle observe que la presse signale régulièrement des saisies, mais qu’il est difficile de savoir dans quelle mesure les procédures sont suivies à la lettre. Ce flou illustre une autre réalité. En effet, une partie des voyageurs ignore ou feint d’ignorer l’existence même de ces règles.
Le poids du cash
Le recours massif aux espèces n’est pas nouveau, mais de nos jours il s’amplifie. Pour le Dr Sissoko, ce basculement s’explique d’abord par une méfiance envers les banques. « Le taux de bancarisation est faible. En 2022, seule une personne adulte sur quatre disposait d’un compte formel. Cela signifie que la majorité des Maliens n’interagit jamais avec une banque » souligne-t-il.
Les sanctions régionales de 2022 ont également laissé des traces. Durant plusieurs mois, les comptes publics ont été gelés, les transferts suspendus et les paiements internationaux bloqués. Cet épisode a convaincu de nombreux acteurs économiques que la détention physique d’espèces était plus sûre que l’épargne sur un compte bancaire. L’argument de la rapidité revient aussi souvent. Un entrepreneur sous anonymat confie : « pour envoyer 10 000 euros par virement, il faut justifier, attendre, expliquer. En cash, je sors avec et je les remets en mains propres ».
Des scandales impliquant certaines institutions financières ont accentué la suspicion. Plusieurs dirigeants de banques privées ont été poursuivis ces dernières années. Cette instabilité perçue affaiblit la confiance et pousse vers des solutions pensées comme moins risquées, bien qu’illégales.
Une économie parallèle s’installe
Les effets dépassent le simple transport illégal d’argent liquide. Dr Sissoko évoque une dérive plus globale : celle d’une économie qui se recompose en marge des institutions. Le cash devient le support d’une activité économique parallèle, non tracée, souvent transfrontalière. Il cite les transferts informels de type hawala, les achats de biens à l’étranger, les circuits d’or ou de devises et même les transactions foncières.
Cette économie parallèle affaiblit la base fiscale. Elle échappe à la statistique, complique les prévisions, empêche la mobilisation des ressources internes. Le capital ne reste plus dans les banques, mais sort du territoire ou circule en dehors de tout radar. Cette situation entraîne moins de crédits, moins d’investissements locaux et plus de dépendance aux emprunts d’État.
Selon les estimations évoquées par l’économiste, le taux d’investissement privé aurait chuté d’environ 3,7% en 2022. La BCEAO, pour sa part, observe une baisse des réserves de change, passées de 5,8 mois d’importations en 2021 à 4,4 mois en 2022. Ces chiffres traduisent un déséquilibre inquiétant.
Risques sécuritaires
Le départ massif de devises nuit à la stabilité du franc CFA. Il amplifie les pressions sur le taux de change, favorise l’inflation importée et complique la conduite de la politique monétaire. À cela s’ajoutent des inquiétudes d’ordre sécuritaire.
Les fonds qui échappent aux circuits formels peuvent être utilisés à des fins criminelles. Me Diarra rappelle que l’un des objectifs du cadre réglementaire est justement d’empêcher que l’argent liquide ne serve à financer le terrorisme, la contrebande ou le trafic de drogue. Sans traçabilité, il devient impossible de garantir que l’origine et la destination des fonds soient licites.
Un analyste régional interrogé sous anonymat évoque le cas de l’or. Officiellement, le pays produit plus de 70 tonnes par an, mais une partie échappe aux circuits officiels. Certaines filières auraient alimenté des financements occultes, y compris à l’international. Les États-Unis ont imposé des sanctions ciblées en 2023 sur des entités soupçonnées de financer des activités armées via l’or exporté depuis le Mali.
Le Hadj : un pic dans les flux
La période du Hadj est souvent marquée par un pic de transferts. L’économiste observe que des agents de voyages sont parfois mandatés pour transporter de l’argent à la place de leurs clients. Ce système de délégation s’explique par la volonté de contourner les plafonds autorisés. Chaque passager peut transporter une somme limitée. En répartissant les montants entre plusieurs personnes, les convoyeurs espèrent échapper au contrôle.
Ce phénomène reste cependant difficile à quantifier. Les saisies douanières ne représentent que la partie visible de l’iceberg. Personne ne sait combien de devises sortent réellement du territoire chaque semaine sans être interceptées.
Pour Me Diarra, la solution ne réside pas uniquement dans le renforcement des contrôles. « Il y a un déficit de communication. Beaucoup de voyageurs ignorent la réglementation ou la perçoivent comme une contrainte incompréhensible ». Elle appelle à des campagnes d’information ciblées, notamment dans les gares routières, les agences de voyages et les points de change.
Elle souligne aussi les avancées prévues dans les textes communautaires. Le Règlement UEMOA autorise le port de devises excédentaires sous forme de cartes bancaires prépayées. Ces instruments, plus sûrs, pourraient être développés et démocratisés, en particulier pour les voyageurs fréquents. Cela permettrait de réduire l’usage du cash tout en facilitant les transactions.
Malaise
Au final, les valises pleines qui quittent discrètement Bamako racontent plus qu’un simple phénomène illégal. Elles traduisent un malaise, une rupture silencieuse entre l’État et ses citoyens, entre les institutions et la pratique quotidienne.
Comme le résume si bien Dr Sissoko, « ce n’est pas seulement une affaire de billets. C’est le symptôme d’une économie qui se replie, d’une société qui doute et d’un capital qui préfère fuir plutôt que contribuer ».
Tant que cette confiance ne sera pas restaurée, le Mali continuera d’assister, impuissant, à l’érosion invisible de sa richesse.
Le trône des illusions : « Quand le réel est confisqué, la fiction devient une barricade »
Dans son nouveau roman publié chez L’Harmattan, Étienne Fakaba Sissoko mêle littérature, mémoire et critique politique. À travers Sabu, écrivain rebelle en détention, il explore la parole entravée, la résistance intime et les régimes qui organisent l’oubli. Une œuvre dense, enracinée dans l’urgence de dire.
Pourquoi avoir choisi la fiction pour porter un message aussi politique ?
Parce que la fiction est la dernière barricade quand le réel est confisqué. Dans un contexte où la parole libre peut coûter la liberté, voire la vie, le roman devient un acte d’insubordination douce. Le trône des illusions est une œuvre de fiction, mais profondément ancré dans les réalités que vivent tant de peuples sous des régimes d’apparence transitionnelle et de fond autoritaire. La littérature permet de contourner la censure, de déjouer la peur, de parler haut quand on veut nous faire taire. J’ai choisi la fiction pour dire ce qu’on ne peut plus dire autrement.
Sabu refuse le silence. Est-ce aussi votre manière de continuer à parler ?
Absolument. Sabu, c’est cette part d’humanité qu’on tente d’éteindre chez ceux qu’on enferme, qu’on isole ou qu’on intimide. À travers lui, je continue à écrire pour celles et ceux qu’on réduit au silence. Ce personnage est né de la prison, de l’injustice et du silence imposé. Mais il parle. Il écrit et il résiste avec les mots. Et moi, à travers lui, je continue cette bataille que je mène depuis des années : celle de la conscience critique, de la liberté de pensée, de la vérité contre la peur.
Que représente Kassala dans le roman ?
Kassala est la capitale du pays fictif Gayma où se déroule l’action du roman. Ce n’est pas un simple décor, mais une condensation du réel. Une mise en fiction des dérives observées dans plusieurs pays du Sud et notamment en Afrique de l’Ouest : confiscation du pouvoir, instrumentalisation de la justice, culte de la sécurité au détriment des libertés, élites cooptées, oppositions criminalisées. Kassala, c’est un miroir. Déformant parfois, mais parlant. Ceux qui y voient une allusion reconnaîtront les reflets qu’ils renvoient.
Publier Le Carnet de Sabu par épisodes, c’est aussi de la résistance ?
Oui. Dans un pays où la mémoire devient dangereuse, publier par épisodes, c’est semer des fragments d’insoumission. Chaque épisode est une mèche et une veilleuse contre l’obscurité organisée. Cette forme feuilletonesque s’inscrit dans notre tradition orale. Ce n’est pas un choix marketing, c’est un choix politique. Le récit de Sabu doit s’infiltrer, se transmettre. Comme un murmure entêté là où l’on croit que tout le monde s’est tu.
« Mali Ko… » : Quand le Mali parle, chante et se raconte à sa jeunesse
Sous le sceau de l’Année de la Culture proclamée par les autorités maliennes, le lancement du projet « Mali Ko… (Le Mali dit…) » marque un tournant pour la scène culturelle nationale. Cette initiative ambitieuse, portée conjointement par Africa Scène et l’Espace Culturel Blonba, s’appuie sur une dynamique inédite de création, de diffusion et de mobilisation citoyenne.
Du mois de juin à celui de décembre, elle sillonne onze grandes villes du pays, avec pour ambition de réconcilier la jeunesse malienne avec son histoire, sa mémoire musicale et son avenir collectif.
Abdou Guitteye, directeur d’Africa Scène et coordonnateur général du projet, évoque une nécessité sociale autant qu’un devoir culturel. « Ce projet, nous l’avons pensé comme une grande conversation nationale entre les générations. Le Mali est riche d’une mémoire musicale que nos jeunes n’écoutent plus, parce qu’on ne la leur donne pas à entendre dans leur langue, dans leur époque. Il ne s’agit pas de nostalgie mais de transmission. Le Mali a beaucoup à dire, et il doit le dire avec les voix d’aujourd’hui. »
Pendant sept mois, de Tombouctou à Bamako en passant par Ségou, San, Bougouni, Sikasso ou Kita, chaque ville traversée sera symboliquement élevée au rang de capitale culturelle du Mali. Dans les stades, les quartiers, les plateaux de télévision et les réseaux sociaux, la parole musicale se mêlera à l’image, au récit et au débat. Le projet mobilise un budget prévisionnel de 150 millions de francs CFA, avec le soutien du ministère de la Culture et du programme Donko ni Maaya, mis en œuvre par la GIZ.
Au cœur de Mali Ko…, dix-neuf chansons majeures du patrimoine musical national, des années 1960 aux années 2000, ont été sélectionnées. Des titres comme Mali Twist de Boubacar Traoré, Mali ba de Bazoumana Sissoko, Diadjiri de Fanta Damba, Tassidoni du Super Biton, Kulukutu de l’orchestre Kanaga de Mopti, Bi furu d’Oumou Sangaré, Nyama Toutou de Nahawa Doumbia, Chérie d’Ali Farka Touré, Mamaya d’Ami Koïta ou CAN 2002 de Nyeba Solo seront réinterprétés dans une forme nouvelle, à travers la voix de la jeune scène contemporaine.
Six artistes porteront ces relectures : Malakey, Young BG, Dr KEB, Black AD, Maimouna Soumounou et Mamou Fané. Tous ont été choisis pour leur singularité artistique, leur ancrage local et leur capacité à résonner avec les aspirations urbaines de la jeunesse malienne. Ces jeunes voix ne reprennent pas seulement des titres, elles les revisitent, les réécrivent parfois, pour leur donner une nouvelle vie sans trahir leur âme.
Alioune Ifra Ndiaye, metteur en scène du projet et fondateur de l’Espace Blonba, précise l’intention esthétique et politique. « Il ne s’agissait pas de faire un spectacle patrimonial figé, mais un geste vivant, mobile, populaire. Nous avons voulu que chaque chanson redevienne ce qu’elle était à l’origine : un message, une mémoire, un outil de lien. Dans Mali Ko…, on ne chante pas pour plaire, on chante pour transmettre. Et on le fait avec rigueur, passion et exigence. »
Le projet s’exprime aussi à travers l’image. Une série télévisée de quarante épisodes, mêlant création documentaire, journal de bord et immersion dans les villes traversées, accompagnera la tournée. À cela s’ajouteront dix talk-shows de quatre-vingt-dix minutes, conçus comme des espaces de débat, de témoignage et d’expression populaire. La diffusion est prévue à la fois sur les chaînes publiques et via les réseaux sociaux, avec un objectif cumulé de trois millions de téléspectateurs et un million de vues numériques.
Mali Ko… vise une fréquentation directe de 150 000 spectateurs à travers ses spectacles-concerts. Mais au-delà des chiffres, c’est la portée symbolique qui importe : montrer que la culture malienne peut être à la fois savante et populaire, enracinée et innovante, locale et universelle.
Pour Abdou Guitteye, le choix de villes parfois éloignées des circuits habituels est un acte volontaire. « Ce n’est pas Bamako qui exporte son modèle. Ce sont les villes, les quartiers, les communautés qui deviennent les cœurs battants du projet. Chaque ville accueillera une création, une émission, un moment de partage. Nous voulons créer un effet de chaîne, une onde culturelle qui touche toutes les couches. »
Alioune Ifra Ndiaye insiste quant à lui sur la responsabilité des artistes dans le contexte actuel. « Le Mali traverse des moments complexes. Ce que nous disons avec Mali Ko…, c’est que l’art n’est pas un luxe. C’est un acte de souveraineté. Nous ne racontons pas le Mali pour en faire un folklore, mais pour en faire un projet. »
À travers cette initiative, Africa Scène et Blonba affirment une ligne claire : la culture est un levier de transformation, un facteur de cohésion, une force de projection collective. Mali Ko… n’est pas seulement un programme artistique, c’est un manifeste. Une invitation à dire, à écouter et à rêver un Mali debout, multiple et vivant.
Audiovisuel : Canal+ célèbre ses 30 ans de présence au Mali
Canal+ a célébré en grande pompe ses 30 ans de présence au Mali et les 10 ans de sa filiale locale, à travers un dîner gala organisé le 30 mai 2025 à Bamako. L’événement a réuni des personnalités du monde audiovisuel, des représentants du gouvernement, des partenaires et des collaborateurs de la chaîne.
Dans une ambiance conviviale et festive, la soirée a été marquée par plusieurs temps forts, notamment des prestations artistiques et humoristiques, une projection inédite retraçant l’histoire de Canal+ au Mali depuis 1995, ainsi que des remises de distinctions à des collaborateurs ayant marqué de leur empreinte le parcours de la chaîne dans le pays.
Le Directeur général de Canal+ Mali, M. Idrissa Diallo, a exprimé sa « fierté immense et une profonde gratitude » envers tous ceux qui ont contribué à bâtir cette success story. Il a tenu à saluer l’engagement historique de M. Ibrahima Sow, président du Conseil d’administration de Canal+ Mali, pour avoir introduit l’offre Canal+ au Mali il y a trois décennies, ainsi que M. Aziz Diallo, tout premier directeur général de la filiale, aujourd’hui Directeur Afrique francophone du groupe.
« Canal+, ce n’est pas seulement un opérateur audiovisuel. C’est un acteur culturel, social, économique et technologique profondément ancré dans la société malienne », a-t-il déclaré, avant de rappeler que Canal+ Mali, aujourd’hui forte de milliers d’abonnés à travers le territoire, innove constamment avec des outils comme le décodeur connecté et l’application mobile, qui permettent un accès fluide aux contenus, partout et à tout moment.
Fière de son ancrage local, Canal+ a lancé en 2024 les chaînes Mandeka et Puulagu, diffusant en mandingue et en peulh, deux langues majeures du pays. Une façon pour la chaîne de refléter « la richesse culturelle du Mali » et de renforcer la proximité avec son public. Canal+ Mali soutient aussi les industries créatives locales à travers la production et la diffusion de contenus africains, contribuant à l’émergence d’un vivier de talents maliens.
Au-delà de l’audiovisuel, Canal+ Mali s’illustre également par son engagement citoyen. À travers des initiatives comme l’opération Orphée, la chaîne accompagne les orphelinats par des dons de vivres, la rénovation d’infrastructures, ou encore la distribution de centaines de kits scolaires. Sur le plan économique, sa contribution se chiffre à plus de 5 000 emplois directs et indirects dans le pays.
Représentant le ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration, le Chef de Cabinet Mohamed Ag Albachar a, pour sa part, rendu hommage à Canal+ Mali pour sa contribution à la démocratisation de l’accès à l’information, à la culture et au divertissement.
Il a salué la création des chaînes en langues nationales, y voyant un acte fort pour la valorisation de la diversité culturelle malienne, tout en rappelant également les efforts de l’État dans la modernisation des infrastructures numériques et la mise en place d’un cadre réglementaire propice à l’innovation, en phase avec la vision du gouvernement de faire du numérique un levier de transformation économique et sociale.
Pour les prochaines années, Canal+ Mali entend poursuivre sur sa lancée. L’opérateur audiovisuel va renforcer son ancrage local en développant encore plus de contenus africains, en accompagnant les talents locaux et en investissant davantage dans la digitalisation de ses services.
Mohamed Kenouvi
Canal+ a célébré en grande pompe ses 30 ans de présence au Mali et les 10 ans de sa filiale locale, à travers un dîner gala organisé le 30 mai 2025 à Bamako. L’événement a réuni des personnalités du monde audiovisuel, des représentants du gouvernement, des partenaires et des collaborateurs de la chaîne.
Dans une ambiance conviviale et festive, la soirée a été marquée par plusieurs temps forts, notamment des prestations artistiques et humoristiques, une projection inédite retraçant l’histoire de Canal+ au Mali depuis 1995, ainsi que des remises de distinctions à des collaborateurs ayant marqué de leur empreinte le parcours de la chaîne dans le pays.
Le Directeur général de Canal+ Mali, M. Idrissa Diallo, a exprimé sa « fierté immense et une profonde gratitude » envers tous ceux qui ont contribué à bâtir cette success story. Il a tenu à saluer l’engagement historique de M. Ibrahima Sow, président du Conseil d’administration de Canal+ Mali, pour avoir introduit l’offre Canal+ au Mali il y a trois décennies, ainsi que M. Aziz Diallo, tout premier directeur général de la filiale, aujourd’hui Directeur Afrique francophone du groupe.
« Canal+, ce n’est pas seulement un opérateur audiovisuel. C’est un acteur culturel, social, économique et technologique profondément ancré dans la société malienne », a-t-il déclaré, avant de rappeler que Canal+ Mali, aujourd’hui forte de milliers d’abonnés à travers le territoire, innove constamment avec des outils comme le décodeur connecté et l’application mobile, qui permettent un accès fluide aux contenus, partout et à tout moment.
Fière de son ancrage local, Canal+ a lancé en 2024 les chaînes Mandeka et Puulagu, diffusant en mandingue et en peulh, deux langues majeures du pays. Une façon pour la chaîne de refléter « la richesse culturelle du Mali » et de renforcer la proximité avec son public. Canal+ Mali soutient aussi les industries créatives locales à travers la production et la diffusion de contenus africains, contribuant à l’émergence d’un vivier de talents maliens.
Au-delà de l’audiovisuel, Canal+ Mali s’illustre également par son engagement citoyen. À travers des initiatives comme l’opération Orphée, la chaîne accompagne les orphelinats par des dons de vivres, la rénovation d’infrastructures, ou encore la distribution de centaines de kits scolaires. Sur le plan économique, sa contribution se chiffre à plus de 5 000 emplois directs et indirects dans le pays.
Représentant le ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration, le Chef de Cabinet Mohamed Ag Albachar a, pour sa part, rendu hommage à Canal+ Mali pour sa contribution à la démocratisation de l’accès à l’information, à la culture et au divertissement.
Il a salué la création des chaînes en langues nationales, y voyant un acte fort pour la valorisation de la diversité culturelle malienne, tout en rappelant également les efforts de l’État dans la modernisation des infrastructures numériques et la mise en place d’un cadre réglementaire propice à l’innovation, en phase avec la vision du gouvernement de faire du numérique un levier de transformation économique et sociale.
Pour les prochaines années, Canal+ Mali entend poursuivre sur sa lancée. L’opérateur audiovisuel va renforcer son ancrage local en développant encore plus de contenus africains, en accompagnant les talents locaux et en investissant davantage dans la digitalisation de ses services.
Mohamed Kenouvi
Charte pour la paix : La Commission de rédaction fait le point sur ses travaux
La Commission de rédaction du projet de Charte pour la paix et la réconciliation nationale, présidée par l’ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, a animé une conférence de presse le 29 mai 2025 à la Maison de la presse de Bamako.
Cette rencontre avait pour objectif de présenter l’état d’avancement des travaux de la Commission, en prélude à la remise officielle du document au président de la Transition, le général Assimi Goïta, prévue pour la fin du mois de juin.
Le président de la Commission a expliqué que le projet de Charte est structuré en 16 titres, 39 chapitres et 105 articles. Ce texte fondateur repose sur des valeurs fondamentales propres à la société malienne, telles que le respect des parents, l’amour de la patrie, le travail bien fait, le pardon, la solidarité et le vivre-ensemble. Il vise à jeter les bases d’une paix durable, à renforcer la sécurité, à favoriser la cohésion nationale et à reconstruire le tissu social profondément affecté par plus d’une décennie de crise.
Ousmane Issoufi Maïga a insisté sur le caractère inclusif et participatif de l’élaboration de la Charte. Selon lui, la Commission a procédé à de larges consultations avec les forces vives de la nation, les institutions, les anciens chefs d’État, les anciens Premiers ministres, les universitaires, les leaders religieux et traditionnels, ainsi que les Maliens de l’intérieur et de la diaspora. Il a souligné que toutes ces contributions ont enrichi le contenu du texte, le rendant ainsi plus représentatif des attentes profondes du peuple malien.
Répondant aux interrogations de la presse sur la dissolution des partis politiques, Ousmane Issoufi Maïga a été catégorique : « La Commission n’a jamais eu pour mandat de traiter de la question des partis politiques ». Il a précisé que 92 partis ont été consultés au cours du processus et que leurs points de vue ont été intégrés dans la réflexion collective.
Le président de la Commission a lancé un appel solennel à l’unité nationale et au dialogue. Il a exhorté les Maliens à bannir l’individualisme, à combattre l’injustice, l’incivisme et à cultiver les valeurs de respect, de solidarité et de tolérance.
La mission de la Commission s’achèvera officiellement le 30 juin 2025. D’ici là, le document final de la Charte sera remis aux autorités de la Transition. La Maison de la presse, par la voix de son président Bandiougou Danté, a promis de soutenir la vulgarisation du texte auprès de la population, en mettant les médias au service de la paix et de la réconciliation.
Mohamed Kenouvi
Public-Privé au Mali : cap sur l’action concrète
La sixième réunion mensuelle de concertation entre les secteurs public et privé s’est tenue ce jeudi dans la capitale malienne. Lancé en janvier 2025, ce cadre d’échange régulier vise à instaurer un dialogue stratégique entre l’État et les acteurs économiques autour des priorités nationales.
Au cœur des discussions de cette sixième session figuraient trois axes majeurs : la mise en œuvre d’un plan d’action à court terme pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, l’adoption d’un plan de réformes structurelles pour l’économie nationale, et la meilleure prise en compte des doléances exprimées par le secteur privé.
Sur les 14 mesures identifiées dans le plan d’action immédiat en faveur des populations, sept ont déjà été mises en œuvre, quatre sont en cours d’exécution, et trois demeurent en attente. Ce tableau d’avancement, présenté à huis clos lors de la réunion, témoigne d’une volonté affichée de résultats, tout en révélant les marges de progrès à combler.
Les mesures exécutées concernent notamment l’accès aux produits de première nécessité à prix modérés dans plusieurs centres urbains, ainsi que la mise en place de mécanismes de distribution d’intrants agricoles à l’approche de l’hivernage. D’autres chantiers, comme la restructuration des mécanismes de soutien aux PME et la facilitation de la circulation des biens dans la région sahélienne, avancent plus lentement.
Dialogue direct avec les ministères sectoriels
Présidée par le Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga, la rencontre a permis un échange direct entre les ministres en charge des secteurs économiques (commerce, agriculture, transports, finances, etc.) et les représentants du secteur privé national. Ces derniers ont exposé les obstacles rencontrés dans leurs filières respectives, allant de la fiscalité à l’accès au crédit, en passant par les tracasseries administratives et les tensions logistiques internes.
« Aucun développement durable ne peut être envisagé sans une union forte au sein des structures représentatives du secteur privé », a déclaré le chef du gouvernement. Il a également exhorté les organisations patronales à renforcer leur cohésion pour mieux porter la voix des entrepreneurs maliens dans ce dialogue mensuel, qui tend à devenir une référence en matière de gouvernance participative.
AES, marchés, et souveraineté alimentaire
Parmi les dossiers jugés prioritaires : la disponibilité et la qualité des denrées alimentaires essentielles, la distribution efficace des engrais et semences agricoles, et la fluidité des échanges dans l’espace de la Confédération des États du Sahel (AES). Le Premier ministre a demandé que ces sujets fassent l’objet d’un suivi rigoureux, notamment en lien avec la campagne agricole qui s’ouvre.
La réunion a également permis de poser les jalons d’un plan de réformes structurelles attendu dans les prochaines semaines. Ce plan, en cours d’élaboration, ambitionne de moderniser l’économie malienne autour de trois piliers : simplification administrative, attractivité des investissements, et renforcement de la production nationale.
Le cadre mensuel de concertation public-privé s’inscrit dans une logique de co-construction des politiques économiques. Il a pour ambition d’assainir le climat des affaires tout en assurant une meilleure redistribution des fruits de la croissance.
Depuis janvier 2025, ces rencontres ont permis de réconcilier les priorités étatiques et les réalités du terrain. La sixième édition confirme que, malgré les lenteurs ou les divergences, un espace de négociation structuré permet de déboucher sur des solutions opérationnelles, si les engagements sont tenus de part et d’autre.
Participation citoyenne et politique : La jeunesse marginalisée malgré son engagement
Bien qu’elle soit suffisamment engagée et qu’elle ait joué un rôle central dans les grandes révoltes qu’a connues le Mali sur le plan sociopolitique, la jeunesse reste structurellement écartée des sphères du pouvoir institutionnel. C’est ce qui ressort d’une étude publiée dans l’édition de mai – juin 2025 de la Revue africaine des sciences politiques et sociales.
La jeunesse malienne, bien que démographiquement majoritaire (plus de 70% de la population), demeure paradoxalement exclue des sphères formelles de décision. Pourtant, elle est au cœur des mobilisations politiques majeures du pays.
Historiquement, les jeunes Maliens ont été des piliers des luttes sociopolitiques. De l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM) dans les années 1990 jusqu’au rôle central dans le Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP), ils ont souvent été en première ligne de la contestation. Leur engagement s’est manifesté dans les rues, sur les réseaux sociaux et dans les mouvements citoyens, démontrant une volonté forte de transformation démocratique.
Cette étude, menée par le Dr. Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur et Vice-doyen de la Faculté des Sciences politiques et administratives de l’Université Kurukanfuga de Bamako, met en lumière cette contradiction entre engagement citoyen et marginalisation politique.
Les jeunes écartés
Selon le Dr. Abdoul Sogodogo, la mobilisation des jeunes ne trouve que rarement un prolongement institutionnel, leur participation aux organes de décision restant faible. Malgré quelques figures emblématiques, les jeunes sont souvent réduits à des rôles de mobilisation, sans accès réel aux leviers du pouvoir, contrôlés par des élites aînées qui perpétuent une gouvernance gérontocratique.
« La faible présence des jeunes dans les sphères de décision est expliquée par des obstacles structurels tels que le manque de ressources financières et une culture politique dominante qui confie le pouvoir politique aux aînés », explique l’universitaire. « En outre, la culture politique malienne laisse peu de place aux jeunes dans les cercles de décision, car la période de jeunesse est souvent considérée comme une étape d’apprentissage ou une phase charnière de préparation à la gouvernance et à la prise de décisions collectives », poursuit-il.
Le système politique malien semble structuré autour d’une logique de clientélisme dans laquelle les jeunes militants servent de bras d’action aux grands hommes politiques en échange de promesses d’emploi ou de reconnaissance. La précarité socio-économique, avec un taux de chômage élevé chez les jeunes, accentue cette instrumentalisation.
La jeunesse malienne, actrice majeure des bouleversements récents, aspire désormais à plus qu’une simple présence symbolique. La reconnaissance de son rôle passe par une refonte des pratiques politiques et une véritable inclusion dans les mécanismes décisionnels.
Mohamed Kenouvi
Bamako face aux inondations : Sévir ne suffit pas
À Bamako, les autorités ont commencé à détruire plusieurs habitations construites dans les servitudes de marigots. L’objectif est clair : prévenir de nouvelles inondations dramatiques, comme celles de 2024. Pourtant, derrière le bruit des pelleteuses, ce sont aussi des cris étouffés que l’on entend, ceux des familles qui affirment n’avoir reçu ni avertissement, ni accompagnement, ni indemnisation.
Beaucoup découvrent du jour au lendemain que leur maison est devenue illégale. Ils soutiennent n’avoir pas été sensibilisés, encore moins associés à la démarche. Si certaines constructions sont à risque, faut-il pour autant confondre urgence et précipitation ? Démolir sans expliquer, c’est ajouter la douleur à la perte et l’humiliation à la précarité.
Le Mali traverse une période critique. L’insécurité persiste, les services sociaux sont fragilisés, les prix grimpent. Dans ce contexte, chaque décision devrait être pesée à l’aune de son impact humain. Une opération mal préparée, même justifiée, peut déclencher des tensions sociales. À force de frustrations non entendues, c’est la cohésion sociale qui s’érode.
Prévenir les inondations, oui, mais pas à n’importe quel prix. Il faut dialoguer, expliquer, proposer des solutions de relogement dignes. L’État gagnerait en autorité en montrant qu’il sait conjuguer fermeté et compassion. Sinon, ces démolitions risquent d’apparaître comme une punition plutôt qu’une protection.
Rien n’est plus légitime que de vouloir sauver des vies. Mais il faut le faire avec les populations et non contre elles. C’est à cette condition que la prévention deviendra une œuvre de reconstruction et non une source supplémentaire de fractures dont le pays pourrait vraiment se passer.
AES : Vers une union douanière
Le 15 mai 2025, les Directeurs généraux des Douanes des États de l’AES se sont retrouvés à Bamako autour de l’harmonisation des procédures douanières dans l’espace confédéral. Une étape importante destinée à faire le point sur les recommandations antérieures et à progresser vers un espace douanier unifié.
Les États de la Confédération de l’AES (Burkina Faso, Mali, Niger) sont désormais engagés dans un processus d’unification de leurs procédures et de leurs textes douaniers. Si la construction de cette nouvelle architecture juridique comporte des défis, elle s’inscrit dans la continuité logique du processus enclenché par ces États depuis leur retrait de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Pour les futures négociations avec la CEDEAO, l’AES souhaite adopter une position commune, exprimée de manière collective et coordonnée, affirmant ainsi son unité. Une telle orientation ne suscite pas de blocages particuliers à ce stade. « En théorie, le retrait des États de l’AES de la CEDEAO ne devrait pas empêcher les pays de la sous-région de négocier des accords de partenariat dans des domaines stratégiques tels que la sécurité transfrontalière, les tarifs extérieurs communs, ainsi que la libre circulation des personnes et des capitaux », expliquait le Dr Abdoul Sogodogo, dans une étude intitulée « AES, Défis et Perspectives », publiée en septembre 2024.
La coexistence de plusieurs organisations dans l’espace sous-régional n’est d’ailleurs pas une réalité nouvelle, poursuit-il. Celle de la CEDEAO et de l’UEMOA en est une illustration. L’avènement de la nouvelle entité, l’AES, pourrait même représenter une opportunité pour attribuer à chaque organisation un mandat spécifique : à l’UEMOA, les questions monétaires ; à la CEDEAO, le développement intégré et la démocratisation ; à l’AES, les questions de sécurité, pour combler les lacunes des initiatives précédentes.
Dès sa création, l’AES s’est positionnée non seulement comme un instrument sécuritaire face aux défis communs, mais aussi comme un levier diplomatique et économique au service des trois États qui la composent.
Un espace intégré en construction
Avant la rencontre des Directeurs généraux des Douanes de l’AES à Bamako, plusieurs réunions avaient jeté les bases d’une coopération douanière plus étroite entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger.
À Niamey, en juillet 2024, la rencontre des DG des Douanes de l’AES a permis de créer des groupes de travail sur le transit, le Code des douanes, les tarifs communs et les règles d’origine. L’interconnexion des systèmes douaniers est apparue comme une priorité pour répondre aux difficultés d’approvisionnement et sécuriser les recettes douanières.
Ce processus s’est poursuivi lors de la réunion de Lomé, en septembre 2024, avec une recommandation forte en faveur de l’interconnexion des systèmes douaniers, y compris avec le Togo.
En janvier 2025, à Ouagadougou, les autorités douanières des trois pays ont évalué l’état d’avancement de cette interconnexion, notamment avec l’administration douanière togolaise.
La réunion de Bamako visait donc à dresser un état des lieux de l’évolution des chantiers engagés et des projets de textes. Parmi les dossiers examinés figuraient : l’encadrement du métier de Commissionnaire en douanes, l’adoption d’un Code des douanes unifié, l’établissement de règles d’origine spécifiques à l’AES, le régime de transit communautaire et l’élaboration de tarifs extérieurs communs (TEC) et préférentiels.
À l’issue des travaux, les Directeurs généraux ont validé le chronogramme proposé pour la finalisation du Code confédéral des douanes et des TEC entre le 28 et le 31 juillet 2025. Ils ont également fait le point sur les recommandations de Lomé : 7 sur 16 ont été réalisées, 6 sont en cours, et 3 restent à mettre en œuvre.
L’un des objectifs de cette réunion était de formuler des propositions concrètes à transmettre aux autorités de l’AES en vue des prochaines discussions avec la CEDEAO.
Interdépendance et dialogue
Le 22 mai 2025, les ministres des Affaires étrangères des pays de l’AES ont rencontré à Bamako le Président de la Commission de la CEDEAO. Cette première session de consultations visait à organiser les négociations entre les deux entités, après la formalisation du retrait de l’AES.
Les discussions ont porté sur les aspects politiques, diplomatiques, institutionnels, juridiques et sécuritaires, mais aussi sur le développement économique et social. Les deux parties ont souligné leur volonté de préserver les acquis majeurs de l’intégration régionale, en particulier la libre circulation des personnes et des biens.
La situation sécuritaire, point de friction majeur entre les États du Sahel et la CEDEAO, a également été abordée. Face à la menace persistante du terrorisme, les deux blocs ont réaffirmé leur volonté de coopérer dans ce domaine, essentiel à la stabilité régionale. Un impératif partagé dans un espace où les économies sont étroitement liées.
En 2024, 22,6% des importations du Mali provenaient de la CEDEAO, contre 31,3% pour le Burkina Faso. En 2022, les exportations du Niger vers la France, le Mali et le Burkina Faso représentaient 35,3% de son PIB. Ses importations – évaluées à environ 4 milliards de dollars – provenaient principalement de la France, de la Chine et des États-Unis.
Cadre parallèle avec l’UEMOA
Le Burkina Faso, le Mali et le Niger restent membres de l’UEMOA. Dans son rapport annuel 2024, l’Union mentionne des progrès en matière d’union douanière, notamment avec l’élaboration d’un avant-projet de règlement sur les procédures simplifiées de dédouanement.
La Commission a poursuivi ses efforts pour dématérialiser l’octroi d’agrément de l’origine et a reconnu l’origine communautaire de 111 produits. Elle a aussi renforcé le système d’alerte contre les entraves à la libre circulation et au droit d’établissement. Toutefois, elle admet que la mise en œuvre de ces dispositifs reste incomplète. Des campagnes de plaidoyer, de sensibilisation et de renforcement des capacités ont été menées dans les postes de contrôle pour améliorer la situation sur les corridors commerciaux.
Trois mois après la sortie formelle de la CEDEAO, les autorités de l’AES se sont réunies à Bamako le 28 mars 2025. Dans une logique d’autofinancement, elles ont adopté un prélèvement communautaire de 0,5% sur les importations provenant de pays tiers non membres de l’AES, à l’exception des États de l’UEMOA, de l’aide humanitaire et des biens diplomatiques. Ce prélèvement (PC-AES) concerne uniquement les pays n’ayant pas d’accord douanier avec l’AES. L’issue des négociations en cours avec la CEDEAO permettra de savoir si cette mesure s’y appliquera.
Vers une Banque confédérale
Le 16 janvier 2025, les États de l’AES ont entamé des discussions sur la création d’une Banque d’investissement. Le 23 mai 2025, les ministres des Finances de l’AES ont adopté les documents fondateurs de la Banque Confédérale pour l’Investissement et le Développement (BCID). Doté d’un capital initial de 500 milliards de francs CFA, cet instrument vise à financer des projets structurants dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie, de l’éducation et de l’industrialisation.
Estimée à 6,9% du PIB de la CEDEAO et à 28,4% de celui de l’UEMOA, la production économique de l’AES reste encore modeste, mais ses États membres souhaitent se doter d’un instrument vital pour soutenir leur développement.
Les défis sont immenses pour cette nouvelle institution, pensée pour réduire la dépendance des économies aux financements extérieurs. Elle devra répondre aux nombreuses attentes, notamment en matière de dynamisation des économies locales, de lutte contre le chômage des jeunes, de promotion de l’entrepreneuriat et de modernisation des infrastructures.
CEDEAO : 50e anniversaire sous le signe de la résilience
La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a célébré ce mercredi son cinquantième anniversaire à Lagos, au Nigeria. Fondée en 1975 par 15 États, l’organisation régionale traverse aujourd’hui l’une des périodes les plus sensibles de son histoire, marquée par le retrait officiel du Mali, du Burkina Faso et du Niger — désormais regroupés au sein de la Confédération AES.
Élevage : une nouvelle vision pour sécuriser les troupeaux
Face aux effets conjugués du changement climatique, de la pression foncière et des tensions récurrentes autour des ressources pastorales, le gouvernement malien a validé une nouvelle Stratégie nationale de stabilisation et de sécurisation du bétail. Le texte, pris en compte lors du Conseil des ministres du 28 mai 2025, est accompagné d’un premier plan quinquennal couvrant la période 2025–2029.
220 000 réfugiés : le Mali en première ligne d’une aide de 100 millions $
Le Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga, a reçu en audience, le mercredi 28 mai 2025, Abdouraouf Gnon-Kondé, Directeur du Bureau régional du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), en visite à Bamako depuis le 26 mai. Cette rencontre s’inscrit dans un contexte de coopération renforcée visant à soutenir les réfugiés et les communautés hôtes au Mali, dans une approche inclusive et durable saluée par les partenaires internationaux.
Le Mali accueille aujourd’hui plus de 220 000 réfugiés, principalement en provenance de pays de la sous-région confrontés à des crises sécuritaires persistantes. Contrairement aux modèles classiques, ces réfugiés ne sont pas regroupés dans des camps mais vivent au sein même des communautés locales maliennes, un choix d’intégration sociale qui témoigne d’une hospitalité remarquable mais qui engendre aussi des pressions importantes sur les ressources et les services de base. C’est dans ce cadre qu’Abdouraouf Gnon-Kondé a tenu à souligner l’importance d’un appui ciblé aux populations hôtes à travers des dispositifs nationaux coordonnés, notamment la Commission nationale chargée des réfugiés.
Au cœur de ces discussions figure une opportunité majeure : un financement de 100 millions de dollars, soit près de 58 milliards de francs CFA, mobilisé par la Banque mondiale au bénéfice conjoint des réfugiés et des communautés qui les accueillent. Le Mali, en raison du nombre de réfugiés présents sur son sol et des efforts déjà entrepris, est éligible à ce mécanisme de soutien. Ce financement vise à consolider les infrastructures, renforcer la résilience des territoires d’accueil et appuyer la mise en œuvre de solutions durables fondées sur le développement local.
Lors de l’audience, le Directeur du Bureau régional du HCR a salué les progrès enregistrés par le Mali en matière de sécurité, un facteur crucial pour envisager des politiques de réinstallation ou d’intégration à long terme. Il a également tenu à féliciter le Premier ministre pour l’adoption de documents stratégiques ambitieux comme la vision « Mali Kura Ɲɛtaasira Ka Bɛn San 2063 Ma » et la Stratégie Nationale pour l’Émergence et le Développement Durable (SNEDD 2024-2033), perçus comme des cadres cohérents et prometteurs face aux attentes des partenaires au développement et aux acteurs humanitaires.
Le Premier ministre Abdoulaye Maïga, pour sa part, s’est félicité de cette dynamique de coopération avec le HCR, qui vient conforter les orientations politiques de la Transition en matière de développement humain, de cohésion sociale et de souveraineté nationale. Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à poursuivre la mise en œuvre de solutions novatrices, adaptées au contexte malien et fondées sur la solidarité, la dignité et le respect des droits fondamentaux des réfugiés.
Par cette audience, le Mali affirme une fois de plus sa capacité à conjuguer impératifs de sécurité, priorités de développement et exigences humanitaires, dans un esprit de responsabilité partagée. Le partenariat avec le HCR s’annonce ainsi comme un levier stratégique dans la construction d’un avenir commun pour les réfugiés et les communautés hôtes, dans un pays qui, malgré les défis, continue de faire le choix de l’humain.
Kayes sous pression : les djihadistes frappent COVEC et paralysent un axe stratégique
Ce samedi 24 mai dans l’après-midi, un groupe armé a attaqué les travaux de réhabilitation de la RN1 à Tirena‑Marena, exploités par la société chinoise COVEC. Les assaillants, visiblement coordonnés, ont incendié grues, camions-citernes, entrepôts et matériaux avant de disparaître. Cet événement met un coup d’arrêt brutal à un projet crucial visant à relier Kayes à la frontière sénégalaise.
Mali : Lancement de la BCID-AES lors de la rencontre consacrée au développement
Le 23 mai 2025 au Centre international de conférences de Bamako (CICB), la première réunion ministérielle de la Confédération des États du Sahel (AES) dédiée au pilier « Développement » a acté la création de la Banque confédérale pour l’investissement et le développement (BCID-AES).
À l’ouverture, les chefs de gouvernement du Mali et du Niger, ainsi que le ministre burkinabè des Finances, ont posé les premiers jalons de cette institution régionale.
Mali–CEDEAO : Bamako relance le dialogue ouest-africain dans un esprit de responsabilité
Bamako a été le théâtre, le 22 mai 2025, d’une rencontre diplomatique d’une portée exceptionnelle. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso, regroupés au sein de la Confédération des États du Sahel (AES), ont tenu des consultations directes avec le président de la Commission de la CEDEAO, le Dr Omar Alieu Touray.
Cette initiative intervient à un moment charnière, quelques mois après le retrait officiel des trois États de l’organisation sous-régionale. Elle marque une tentative sérieuse de renouer les fils du dialogue entre deux blocs que tout semblait opposer jusqu’ici.
Les entretiens ont permis l’adoption d’un relevé de conclusions servant de base au lancement de futures négociations. Dans une atmosphère jugée constructive par toutes les parties, les représentants ont convenu de préserver les droits fondamentaux acquis au fil de l’intégration régionale. La libre circulation des personnes et des biens reste garantie jusqu’à la mise en place de nouveaux accords. Loin des déclarations symboliques, ce cadre de discussions pose les fondations d’un mécanisme de coopération qui pourrait s’avérer décisif pour les millions de citoyens concernés.
Le climat sécuritaire a largement orienté les débats. La situation dans le Sahel est critique. Selon le rapport 2024 de l’Index mondial du terrorisme, le Burkina Faso est désormais classé premier pays le plus touché au monde, avec près de deux mille morts et 258 attaques enregistrées en une année. Le Niger connaît une dégradation brutale avec une hausse de 94 % du nombre de décès liés au terrorisme, atteignant 930 victimes. Le Mali occupe la troisième place mondiale du classement, consolidant le triste constat selon lequel les trois pays de l’AES cumulent à eux seuls plus de 4 700 morts liés au terrorisme en 2024. Ces chiffres sont glaçants. Ils confirment que le Sahel central concentre aujourd’hui plus de la moitié des victimes du terrorisme dans le monde. Dans ce contexte, la relance du dialogue initiée à Bamako dépasse le cadre diplomatique pour devenir une nécessité humanitaire et stratégique.
Au-delà de la sécurité, l’économie constitue un autre défi majeur. En 2024, le PIB réel du Mali est estimé à 18,3 milliards de dollars, avec une croissance de 4 % portée par les performances agricoles, malgré des ralentissements dans le secteur industriel. Le Niger a enregistré une croissance remarquable de 9,9 %, grâce à la reprise minière et à la hausse des investissements publics. Le Burkina Faso a, pour sa part, maintenu une croissance de 5,5 %, malgré la pression sécuritaire persistante. L’ensemble de l’espace AES, fort de plus de soixante-dix millions d’habitants, génère un PIB cumulé supérieur à 62 milliards de dollars. Pourtant, les besoins restent immenses et les déséquilibres flagrants. La vulnérabilité alimentaire, la dépendance énergétique et l’accès limité aux services sociaux de base aggravent les fractures.
Nouvelle ère
Les autorités présentes à Bamako ont reconnu l’urgence d’ouvrir une nouvelle ère de coopération, dans le respect des choix souverains et des intérêts des populations. L’idée d’une rupture brutale est désormais dépassée. Le ton, désormais, est à la réinvention. L’avenir dira si cette rencontre constitue une simple trêve diplomatique ou l’amorce d’une nouvelle architecture régionale plus souple, plus réaliste, et centrée sur les besoins concrets des citoyens.
La tenue des consultations du 22 mai 2025 introduit une nouvelle phase dans les relations entre les parties concernées. Dans un environnement régional traversé par des ruptures et des incertitudes, le choix d’un échange direct et structuré témoigne d’un repositionnement stratégique. À mesure que les tensions institutionnelles se recomposent, la mise en place d’un canal de discussion offre une base de travail susceptible de faire évoluer les équilibres. La suite dépendra de la capacité des acteurs à ancrer ce dialogue dans des mécanismes concrets, visibles et durables, au bénéfice des populations sahéliennes.
L’Europe doit changer son approche de l’Afrique
Ces dernières années, la Chine a dépassé l’Europe en termes de commerce avec l’Afrique subsaharienne et d’investissements dans les infrastructures. Les États du Golfe ont remodelé les flux financiers sur le continent, tandis que le Brésil, l’Inde et la Turquie ont également renforcé leurs liens avec les pays africains. Parallèlement, les dirigeants africains ont mis en place la zone de libre-échange continentale africaine (Zleca), qui devrait transformer le commerce intra-africain. Pourtant, l’Union européenne continue de se bercer de l’illusion qu’elle est le principal partenaire de l’Afrique.
En conséquence, alors que l’Afrique se repositionne stratégiquement dans le monde multipolaire d’aujourd’hui, l’Europe reste largement complaisante. L’UE se considère également comme une puissance normative, un champion mondial des droits de l’homme, de la gouvernance démocratique et de la durabilité. Si cela est vrai dans certains domaines, les relations commerciales et économiques de l’Europe – en particulier avec l’Afrique – suggèrent le contraire. Et, jusqu’à présent, l’Europe ne s’est pas montrée disposée à changer.
En tant que haut représentant de l’Union africaine pour les relations avec l’Europe, j’ai été le témoin direct de cette dynamique. En 2019, j’ai proposé que l’UA reçoive un mandat officiel pour négocier un accord commercial continental avec l’UE. L’idée n’était pas révolutionnaire ; elle reflétait simplement la demande légitime de l’Afrique pour un pouvoir de négociation collective, que l’UA, qui a fait de grands progrès vers la cohérence politique, est bien placée pour exercer.
Mais la Commission européenne a plus de poids dans les négociations avec les pays individuels ou les communautés régionales, et les acteurs africains de ce système fragmenté sont réticents à abandonner leur rôle d’intermédiaire. Ma proposition a donc été bloquée et l’UE a continué à contourner les institutions de l’UA en faveur d’accords bilatéraux ou d’initiatives régionales qui ne correspondent pas aux besoins, aux intérêts ou aux priorités de l’Afrique.
Les accords de partenariat économique (APE) négociés entre l’UE et les pays (ou groupes de pays) africains ont notamment renforcé la dépendance de l’Afrique à l’égard des exportations de produits de base et limité la marge de manœuvre politique dont les pays africains ont besoin pour s’industrialiser. Ces accords ont largement profité aux exportateurs européens, tout en laissant les pays africains dans l’incapacité de tirer parti du commerce pour développer l’industrie manufacturière nationale ou réorienter leur avantage comparatif vers des activités à plus forte valeur ajoutée.
Pendant ce temps, les investissements de l’UE sont largement consacrés aux activités extractives, au contrôle des migrations et aux compensations liées au climat, plutôt qu’au renforcement des chaînes de valeur industrielles ou à la facilitation des transferts de technologie. Si l’on a beaucoup parlé de l’initiative « Global Gateway « de l’UE, qui vise à stimuler les liaisons numériques, énergétiques et de transport « intelligentes, propres et sûres » et à renforcer « les systèmes de santé, d’éducation et de recherche », son ambition fait pâle figure par rapport à l’initiative « Belt and Road » de la Chine et même par rapport aux packages de transition verte de l’Amérique.
De plus, avec ses investissements en Afrique, l’UE ne partage pas les risques, mais s’en décharge. Les capitaux privés sont censés jouer un rôle moteur, alors que le financement du développement est loin d’être à la hauteur de ce qui est nécessaire pour débloquer la transformation industrielle. On demande à l’Afrique de réduire les risques des investissements pour les autres sans recevoir de garanties structurelles, comme un meilleur accès aux marchés des capitaux, des conditions commerciales favorables ou des engagements à long terme.
Toutefois, l’évolution de l’environnement mondial offre à l’Europe une occasion unique de transformer ses relations avec l’Afrique. Tout d’abord, les États-Unis tournent le dos au continent, en imposant des droits de douane élevés, en réduisant l’aide et en diminuant leur présence diplomatique. Plus généralement, l’économie mondiale subit une transformation fondamentale, car le système multilatéral du passé – qui mettait l’accent sur le libre-échange et la libéralisation financière – est remplacé par un nouveau terrain, plus fragmenté. Les nouvelles règles sont rédigées par les plus grandes puissances du monde, qui se soucient peu des besoins et des intérêts des économies en développement.
Dans un monde où le commerce est guidé principalement par le pouvoir de marché plutôt que par l’avantage comparatif, l’Afrique doit s’adapter en conséquence. Cela signifie qu’elle doit renforcer ses capacités de production plutôt que d’attendre des concessions. Cela signifie construire un écosystème commercial propre à l’Afrique, plutôt que de s’engager dans des négociations basées sur la conformité. Et cela signifie qu’il faut concevoir des moyens de façonner les chaînes de valeur mondiales en faveur de l’Afrique, plutôt que de chercher des occasions de rejoindre les structures existantes. Pour soutenir ces efforts, l’Afrique n’a pas besoin de mécènes ; elle a besoin de partenaires stratégiques qui reconnaissent son rôle, investissent dans sa capacité de production et s’adaptent à ses priorités.
Si l’Europe espère jouer ce rôle, elle doit commencer par abandonner l’idée qu’elle est le partenaire par défaut de l’Afrique. L’influence doit se mériter.
En outre, l’engagement de l’UE en Afrique doit s’inscrire dans le cadre de l’architecture institutionnelle africaine, en particulier dans les domaines du commerce, de la gouvernance numérique et de la diplomatie climatique. L’UE doit cesser de contourner l’UA et reconnaître l’organisation comme un interlocuteur légitime pour l’Afrique. Elle doit également fonder son engagement économique avec l’Afrique sur la logique de l’AFCFTA – l’innovation la plus importante en matière de politique économique du continent depuis des décennies – et non pas en contradiction avec elle.
En outre, l’UE doit dissocier l’aide du patronage moral. L’aide au développement n’est pas un don, mais un outil géopolitique, et une conditionnalité excessive sape souvent les institutions mêmes qu’elle est censée aider. Au lieu de micro-gérer les réformes de gouvernance, l’Europe devrait se concentrer sur le soutien des ambitions de l’Afrique, notamment en ce qui concerne les infrastructures, l’éducation et la transformation industrielle.
À cet égard, la meilleure approche consisterait à co-investir avec des partenaires africains dans des chaînes de valeur régionales. Cela signifie qu’il faut soutenir les industries africaines non pas en tant que « bénéficiaires », mais en tant qu’acteurs égaux ; repenser la politique agricole commune de l’UE, qui fausse les systèmes alimentaires africains ; et démanteler les barrières non tarifaires qui pénalisent les exportateurs africains.
Enfin, dans les enceintes internationales, l’UE devrait se coordonner avec l’UA sur des questions comme la réforme de la dette, le financement de la lutte contre le changement climatique et la propriété intellectuelle. L’appel de l’Afrique en faveur d’un mécanisme d’apurement de la dette souveraine doit faire l’objet de propositions concrètes, et non d’une multiplication des services de conseil. Le financement de la lutte contre le changement climatique doit refléter les responsabilités historiques et les coûts réels, et non l’opportunisme politique.
Quant à l’UA, elle doit faire preuve de plus d’audace en exigeant de véritables changements structurels dans les relations de l’Afrique, plutôt que de se contenter de belles paroles sur la souveraineté du continent. Il s’agit notamment d’affirmer le rôle de l’UA dans tous les partenariats extérieurs, de rejeter l’ingérence extérieure dans les processus d’intégration africains et d’investir dans la capacité à proposer des cadres macroéconomiques alternatifs. En bref, l’UA doit s’engager dans la politique désordonnée mais nécessaire de la réforme multilatérale – non pas en tant que pétitionnaire, mais en tant que responsable de la définition de l’ordre du jour.
Carlos Lopes, professeur honoraire à la Nelson Mandela School of Public Governance de l’université du Cap, est professeur invité à Sciences Po, chercheur associé à Chatham House, membre du conseil d’administration du World Resources Institute, président du conseil d’administration de la Fondation africaine pour le climat et haut représentant de l’Union africaine pour les relations avec l’Europe. Il est l’auteur de The Self-Deception Trap : Exploring the Economic Dimensions of Charity Dependency within Africa-Europe Relations (Palgrave Macmillan, 2024).
Project Syndicate, 2025.
www.project-syndicate.org
Ce que la finance islamique apporte à la résilience climatique
En cette période de rassemblement des ministres des 57 États membres du Groupe de la Banque islamique de développement à Alger, dans le cadre de la 51e réunion annuelle de la BID, il n’est plus possible d’ignorer les effets dévastateurs du changement climatique. Les incendies de forêt anéantissent des communautés entières, les inondations entraînent le déplacement des millions de personnes, et les vagues de chaleur font plusieurs centaines de milliers de morts. Ces phénomènes météorologiques extrêmes ne sont plus des anomalies ; ils constituent la nouvelle normalité, menaçant la vie humaine et les moyens de subsistance au sein des régions du monde les plus vulnérables au changement climatique, en particulier dans les pays du Sud.
Les réponses traditionnelles se révélant insuffisantes face à cette menace croissante, il est nécessaire que des financements innovants occupent le devant de la scène. D’après le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, pas moins de 3,6 milliards de personnes vivent actuellement dans des régions extrêmement vulnérables au changement climatique. Entre 2010 et 2020, le nombre de décès provoqués par les inondations, les sécheresses et les tempêtes dans ces régions a été 15 fois supérieur à celui observé dans les régions peu vulnérables, ce qui illustre la gravité et l’inégalité des effets de la crise climatique.
Selon la pensée dominante, l’action climatique constitue pour les économies dépendantes des ressources une question de survie économique, tandis qu’elle offre un chemin vers une croissance et un développement durables pour les économies en voie de développement. Or, de nombreuses économies s’inscrivent dans ces deux catégories – étant à la fois en voie de développement et dépendantes des ressources – ce qui accentue la difficulté de l’élaboration et de la mise en œuvre de stratégies climatiques efficaces.
Bien qu’une stratégie globale de résilience face au climat soit essentielle pour renforcer la capacité des économies en voie de développement à résister aux chocs, la résilience et l’adaptation doivent aller de pair. Pour les pays vulnérables, cela peut signifier consolider les infrastructures de protection contre les inondations, investir dans des variétés agricoles résistantes à la sécheresse, et diversifier les sources de revenus afin de réduire la dépendance aux secteurs sensibles au climat.
Les modes de financement conventionnels n’en demeurent pas moins limités, à la fois en termes de sources et de mécanismes de mise en œuvre. Les mesures cruciales de protection sociale et les systèmes de soutien sont par conséquent bien souvent sous-financés ou insuffisants. Vient s’ajouter au problème une incertitude croissante autour de la disponibilité de financements concessionnels en provenance des pays développés.
Face à cette réalité, il est nécessaire que l’innovation financière devienne un pilier de la résilience climatique. Institutions financières, gouvernements et autres parties prenantes doivent collaborer afin de mettre au point de nouveaux mécanismes de financement, destinés à protéger les régions vulnérables au climat.
Constat encourageant, plusieurs fonds et mécanismes de financement innovants ont vu le jour pour soutenir les efforts de résilience et d’adaptation. Parmi ces avancées figurent le Fonds vert pour le climat, qui fournit une assistance financière aux pays en voie de développement ; la Climate Bonds Initiative, qui favorise la croissance du marché des « obligations climat » ; l’assurance climatique, qui contribue à la gestion et réduction des risques liés au climat ; l’adaptation communautaire, qui permet aux communautés locales d’élaborer et de mettre en œuvre leurs propres stratégies d’adaptation ; ainsi que les solutions fondées sur la nature, qui se concentrent sur la restauration et la protection des écosystèmes naturels. Ces financements sont malheureusement très loin de répondre aux besoins.
Les banques multilatérales de développement (BMD) jouent un rôle essentiel dans la fourniture des fonds permettant aux pays vulnérables de réduire leurs émissions et d’investir dans des projets d’adaptation. D’après le plus récent rapport conjoint des banques multilatérales de développement sur le financement climatique, les BMD ont fourni en 2023 un montant record de 125 milliards $ de fonds publics pour l’action climatique. Il convient de souligner que 60 % de ce montant – 74,7 milliards $ – a été dirigé vers des pays à revenu faible et intermédiaire, ce qui illustre l’engagement des BMD à soutenir les pays les plus exposés aux risques climatiques.
La Banque islamique de développement fournit des efforts importants dans ce domaine. En novembre 2024, la BID a approuvé un financement de 1,15 milliard $ visant à renforcer la sécurité alimentaire et hydrique au Kazakhstan, grâce à l’irrigation durable de 350 000 hectares de terres. Ce projet a pour objectif d’accroître de 30 % le rendement moyen des cultures, ce qui améliorera la résilience des communautés face aux catastrophes climatiques, ainsi que le bien-être économique de 1,3 million de personnes vulnérables.
À l’instar des autres BMD, la BID est confrontée au défi du renforcement de la résilience climatique dans ses 57 États membres, dont plus de la moitié sont plus vulnérables au changement climatique que la moyenne mondiale. Pour remédier à ces vulnérabilités, il est nécessaire, d’après les estimations, que 75 à 90 milliards $ soient investis chaque année jusqu’en 2030 dans des projets d’agriculture durable, d’approvisionnement en eau et d’infrastructure. Les flux financiers en direction de ces pays aux fins de l’adaptation s’élèvent en moyenne à 23,9 milliards $ par an, ce qui signifie un déficit de financement de 68 %, que la BID s’efforce activement de combler.
L’offre croissante de financements pour l’adaptation illustre la contribution indispensable des BMD aux efforts mondiaux pour le climat. La réussite ne saurait toutefois se mesurer par les seuls montants déboursés, mais par les résultats tangibles et réels. Bien que le financement de l’action climatique progresse quantitativement, son efficacité dépend d’un suivi rigoureux et d’une évaluation de l’impact. Il est par conséquent essentiel que soient mis en place de solides cadres de reporting, afin de renforcer la confiance des parties prenantes, et de canaliser davantage de financements vers des projets d’adaptation. Pour renforcer leur impact, il est également nécessaire que les BMD adoptent des modèles de financement ciblés, axés sur les résultats et les politiques.
Au-delà du renforcement des capacités institutionnelles des emprunteurs ainsi que du développement des financements ciblés, une opportunité s’offre aux BMD de stimuler la mobilisation de ressources en attirant des capitaux en provenance de sources non conventionnelles. Le cadre de durabilité de la BID en constitue l’une des illustrations. Grâce à ce dispositif, la BID a mobilisé plus de 6 milliards $ en émettant des obligations islamiques (sukuk), qui attirent des investisseurs musulmans et non musulmans.
Axée sur l’adossement d’actifs et le partage des risques, la finance islamique est intrinsèquement alignée sur les principes de durabilité. Ces dernières années, plusieurs instruments tels que l’assurance coopérative (takaful), les dotations caritatives (waqf) et les plateformes de crowdfunding basées sur la foi religieuse sont apparus comme des sources alternatives de financement climatique dans le monde musulman.
Consciente de la nécessité de solutions de financement climatique ciblées, la BID promeut et soutient activement ces mécanismes. En tirant parti d’un secteur de la finance islamique qui représente 4 500 milliards $, ainsi qu’en adoptant son modèle d’adossement d’actifs et de partage des risques, d’autres BMD pourraient élargir et diversifier leurs sources de financement, ce qui leur permettrait de soutenir des initiatives d’adaptation et d’atténuation dans les régions les plus vulnérables du monde.
L’époque des projets pilotes et des interventions parcellaires est révolue. Pour bâtir un avenir de durabilité et de résilience face au climat, il est urgent que les BMD développent à plus grande échelle des solutions à fort impact, qu’elles s’ouvrent à l’innovation financière, et qu’elles favorisent la coopération mondiale. Forte de son expérience de plus d’un demi-siècle, la BID est prête à jouer son rôle.
Muhammad Al Jasser est président du Groupe de la Banque islamique de développement.
Project Syndicate, 2025.
www.project-syndicate.org
Fin de mandat au BVG : Samba Alhamdou Baby dresse son bilan
Le Président de la Transition a reçu à Koulouba, le jeudi 22 mai 2025, le Vérificateur général sortant, Samba Alhamdou Baby, pour la remise officielle du rapport d’activité couvrant son mandat de 2018 à 2025. Cette rencontre marque la fin d’un cycle de sept années à la tête du Bureau du Vérificateur général (BVG), une institution clef du contrôle des finances publiques au Mali.
Selon les chiffres présentés, le BVG a mené 232 missions de vérification et d’évaluation au cours de cette période. Parmi elles, 140 ont porté sur la conformité et la gestion financière, 29 ont évalué la performance des structures publiques, 56 ont consisté à suivre l’application des recommandations précédentes, et 7 ont ciblé l’évaluation de secteurs spécifiques. Près de 80 % de ces missions, soit 183 au total, ont été conduites pendant la Transition, ce qui traduit un effort accentué de redevabilité sous l’actuel régime.
Le rapport remis au chef de l’État met également en lumière les résultats sur le plan judiciaire. Au total, 158 dossiers ont été transmis aux Procureurs des pôles économiques et financiers de Kayes, Mopti, Bamako ainsi qu’au parquet économique national. À ces dénonciations s’ajoutent 147 dossiers adressés à la Section des comptes de la Cour suprême pour suspicion d’irrégularités budgétaires ou financières.
Ces missions ont permis à l’État de recouvrer ou de régulariser près de 12 milliards de francs CFA, souvent avant même la fin des opérations de vérification. Par ailleurs, les suites judiciaires engagées ont conduit à des récupérations additionnelles estimées à environ 600 millions de F CFA au niveau du Pôle national économique et financier.
Au-delà des chiffres, Samba Alhamdou Baby a insisté sur la portée symbolique de ce rapport. Il a salué la collaboration avec les autorités de la Transition, affirmant que les résultats obtenus témoignent d’une volonté politique de promouvoir la bonne gouvernance et la transparence.
Sous son mandat, le BVG a également renforcé sa communication institutionnelle. Des rapports sectoriels ont été publiés pour la première fois sur son site web, et plusieurs évaluations du secteur public ont été menées afin d’élargir le périmètre du contrôle citoyen.
Le passage de témoin a déjà eu lieu. Le décret présidentiel du 16 mai 2025 a nommé Abdoul Aziz Aguissa au poste de Vérificateur général. Administrateur civil, ancien secrétaire général du BVG, il est titulaire d’un doctorat en droit public obtenu à Grenoble. Sa nomination intervient dans un contexte où les attentes sont élevées en matière de moralisation de la gestion publique et de résultats concrets dans la lutte contre la corruption.
Avec ce changement à la tête de l’institution, la continuité des missions de contrôle est attendue, de même qu’une intensification des efforts pour renforcer la confiance des citoyens dans l’utilisation des ressources publiques.
Sécurité régionale : Le Mali s’engage dans une nouvelle dynamique
Le 22 mai 2025, Bamako a accueilli le lancement de la phase nationale du Programme des États du Sahel, une initiative coordonnée par la Coalition Islamique Militaire Contre le Terrorisme (CIMCT).
Festival Sogobô 2025 : Les marionnettes au service de la paix et du développement
Depuis le 20 mai, le Musée national du Mali accueille la deuxième édition du Festival international Sogobô, porté par la Compagnie Sogolon. Devant un public nombreux, marionnettes géantes, masques rituels et danses initiatiques célèbrent la mémoire et l’ancrage culturel.
« Ce que vous voyez là, ce ne sont pas que des objets. Ce sont des voix, des héritages. Ce sont nos bibliothèques vivantes », rappelle Yaya Coulibaly, figure tutélaire du théâtre africain de marionnettes, dont l’œuvre est classée au Patrimoine mondial immatériel. Il voit dans cette édition un moment décisif pour sensibiliser la jeunesse à la richesse de l’oralité. Selon lui, « la marionnette, c’est politique, éducatif et profondément spirituel ».
Le terme « Sogobô » signifie « sortie des masques et marionnettes » en bambara. Une tradition ancestrale que Yaya Coulibaly s’efforce de préserver et de moderniser depuis la création de sa compagnie en 1980. « Je dépends des marionnettes, ma famille vit uniquement pour cela. C’est ma banque, c’est mon territoire, c’est mon livre, c’est tout mon domaine et chaque jour que Dieu nous donne », confie-t-il.
Le thème retenu cette année, « La culture, facteur de paix, de cohésion sociale et de développement socio-économique », donne le ton d’un programme riche, marqué par des spectacles inspirés des épopées bambaras, des restitutions de formations dans les quartiers périphériques et la participation de jeunes artistes issus de l’Institut national des arts et du Conservatoire. Le centre Happy Théâtre de Dialakorodji a notamment présenté une performance poignante sur les violences domestiques.
Le programme comprend également des ateliers de fabrication et de manipulation, des expositions, des conférences-débats et des master classes. Ces activités visent à renforcer les liens sociaux et à promouvoir la culture comme levier de développement.
En coulisses, l’organisation repose sur un équilibre fragile entre passion et faibles ressources. Aucune enveloppe budgétaire officielle n’a été rendue publique, mais les organisateurs évoquent des « moyens très limités », partiellement compensés par l’appui logistique de l’UNESCO et de partenaires comme Moov Africa ou Instruments 4Africa. « Il faut créer de la valeur culturelle avec presque rien, mais nous tenons debout », résume un membre de l’équipe.
Le festival joue aussi un rôle discret mais essentiel, en ce sens qu’il rémunère des dizaines d’artisans, couturiers, musiciens, forgerons, sculpteurs et jeunes comédiens. Il ravive des réseaux de transmission souvent rompus et remet en lumière des figures comme les Trésors Humains Vivants du Mali.
Le Festival international Sogobô s’impose comme un rendez-vous majeur pour les amateurs d’art et de culture, offrant une immersion rare dans l’univers des masques et marionnettes du Mali.
MD
Ligue 1 de Basket : Les playoffs en ligne de mire
Les matchs du carré d’as du championnat national de Basket Ligue 1 Orange ont débuté le 19 mai sur les deux tableaux, masculin et féminin. Il s’agit de l’ultime étape avant les playoffs, qui détermineront les équipes championnes du Mali pour la saison 2024 – 2025.
Les quatre meilleures équipes à l’issue de la saison régulière s’affrontent. Chez les Messieurs, il s’agit du Stade Malien de Bamako, de l’AS Police, de l’USFAS et du Centre de référence de Basketball de Tombouctou (CRBT). Dans le tableau féminin, les mêmes équipes s’affrontent, sauf le CRBT, remplacé par le Djoliba AC.
Pour son entrée en lice, le champion en titre, le Stade Malien de Bamako, porté par Ibrahim Cissé (16 points, 2 rebonds, 3 passes décisives), a envoyé un signal fort à tous les prétendants en s’imposant largement devant l’USFAS 82 – 42, soit une différence de 40 points entre les deux formations.
Les Blancs de Bamako ont enchaîné avec une deuxième victoire face à l’AS Police le 20 mai (92 – 71) et sont quasiment qualifiés pour les playoffs, même avec un dernier match à disputer ce jeudi 22 mai face au CRBT.
Lutte pour le 2ème ticket
Les Tombouctiens, qui ont créé la sensation lors de leur premier match en venant à bout de l’AS Police (77 – 68), ont ensuite été défaits par l’USFAS (76 – 72). Avec une victoire chacun en deux matchs, le CRBT et l’USFAS, qui sera opposé à l’AS Police, quasi éliminé, vont se livrer un duel à distance ce jeudi pour le 2ème ticket.
À l’instar de l’équipe masculine, les Dames du Stade Malien de Bamako ont également obtenu deux victoires en autant de rencontres et ont décroché leur ticket pour les playoffs avant la 3ème journée. Elles se sont imposées respectivement face à l’USFAS (86 – 58) et à l’AS Police (69 – 50), avant d’affronter le 22 mai le Djoliba AC.
Les Rouges de Hérémakono, qui se sont relancées lors de la 2ème journée face à l’USFAS (87 – 50) après leur défaite inaugurale contre l’AS Police (71-74), sont dans l’obligation de gagner ce 3ème match face au Stade Malien.
Le 2ème ticket pour les playoffs chez les Dames pourrait également revenir à l’AS Police, si les Policières, vainqueures face au Djoliba AC puis battues par le Stade Malien, prenaient le dessus lors de la 3ème journée sur l’USFAS, déjà éliminée.
Mohamed Kenouvi
Syndicats de l’Éducation et leur financier : Difficile compromis
Moins d’un mois après l’accord entre les syndicats de l’Éducation signataires du 15 octobre et les autorités, l’accalmie semble compromise. Un arrêt de travail prévu ce 21 mai 2025 vient d’être suspendu en attendant de nouvelles négociations.
Les syndicats de l’Éducation signataires du 15 octobre 2016 du District de Bamako, constitués du SYPESCO, du SYNEFCT, du SYNEM, du COSES, de la FENAREC et du SYLDEF, avaient entamé un arrêt de travail du 23 au 25 avril 2025. Ce mouvement avait été suspendu le 24 avril après « satisfaction des revendications ».
Cette grève des syndicats enseignants avait deux points de revendication : le départ sans délai du billeteur de l’Académie d’Enseignement de Bamako Rive Gauche et le rétablissement immédiat et effectif de toutes les primes d’enseignants suspendues.
La Coordination des syndicats d’enseignants accusait alors le financier d’avoir suspendu des primes auxquelles ils avaient droit. Un point concerne une cinquantaine d’enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales en détachement au niveau d’autres départements.
Goulot d’étranglement
Entre les syndicats de l’Éducation et leur financier, le point d’achoppement était le départ de ce dernier de son poste. Cette décision, prise le 20 mai 2025, a provoqué le mot d’ordre d’arrêt de travail suspendu de justesse, à la demande de la centrale syndicale UNTM.
Il faut rappeler que les primes objet du différend entre les deux parties sont des « primes supplémentaires » qui doivent être payées par le service d’accueil.
Selon une note explicative émanant du financier de l’Académie d’enseignement, ces primes ont été payées par l’Académie d’enseignement dont ils relèvent par méconnaissance. C’est pourquoi elles avaient été suspendues une première fois en 2023. Suite à un préavis des syndicats signataires du 15 octobre 2016 et à une conciliation, il avait été convenu du paiement des primes pour les enseignants mis à disposition et du paiement d’une prime de risque aux professeurs d’informatique.
Ce « rétablissement » a fini par questionner le financier, qui a tenu à respecter les dispositions de la loi N°2018-035 du 27 juin 2018 portant statut des fonctionnaires des collectivités territoriales, dont l’article 51 stipule : « le fonctionnaire mis à disposition relève, du point de vue traitement, de la collectivité territoriale de départ. Toutefois, il peut bénéficier d‘avantages supplémentaires à la charge de la structure d’accueil ».
L’accord trouvé comprenait le rétablissement des primes au mois de mai et le rappel du mois d’avril, ainsi que le départ du financier, qui vient d’être acté, ce qui a provoqué la réaction du syndicat des financiers.
Soumaila Lah : « Le vrai chantier, c’est l’exemplarité du pouvoir »
Suite à la présentation du Plan d’Action Gouvernemental (PAG) 2025–2026 par le Premier ministre devant les membres du CNT, le 16 mai 2025, Soumaila Lah, chercheur-analyste, en livre une lecture lucide, critique et argumentée. Pour cet analyste indépendant, le vrai défi n’est pas d’accumuler les promesses, mais de garantir leur concrétisation, dans un contexte de tensions politiques persistantes.
La sécurité est de nouveau la grande priorité budgétaire. Est-ce soutenable ?
La défense et la sécurité ont toujours constitué les plus grosses poches budgétaires de l’État malien. Ce n’est pas nouveau et cela s’inscrit dans une continuité, avec des lois d’orientation et de programmation militaire, de réforme du secteur de la sécurité. Le gouvernement les considère comme prioritaires. Cependant, il s’agit là encore de prévisions. Leur exécution dépendra des capacités réelles à mobiliser les ressources. Si ces fonds ne sont pas disponibles, il faudra redéployer les moyens en puisant dans des secteurs jugés moins urgents, ce qui pourrait se faire au détriment de services sociaux déjà fragiles. L’équilibre budgétaire, dans un contexte aussi tendu, devient alors un enjeu majeur.
Les réformes annoncées (Relecture des lois, SIGRH) peuvent-elles garantir une meilleure gouvernance ?
Je ne le pense pas. Ce n’est pas une simple question de textes. Le vrai chantier, c’est l’exemplarité du pouvoir. Aucun logiciel, aucune relecture de loi ne remplace la volonté politique d’être exemplaire. Tant que ceux qui dirigent ne montrent pas l’exemple, les autres suivront difficilement. Revenir sur des textes déjà modélisés, vouloir tout changer sans raison claire, c’est parfois détourner l’attention, ou, pire, chercher à légitimer des desseins inavoués. Ce dont nous avons besoin, c’est d’un pouvoir sobre, transparent et respectueux de la loi.
L’objectif agricole de 11 millions de tonnes est-il réaliste ?
C’est ambitieux, mais difficile à croire dans l’immédiat. Les capacités logistiques et techniques du pays sont encore mal connues. Il y a des aléas climatiques, des problèmes de distribution d’intrants. Et, surtout, on assiste depuis quelque temps à une inflation de promesses non suivies d’effets. Tant que les conditions ne sont pas réunies de façon concrète, cette projection reste une annonce politique parmi d’autres.
Peut-on croire à des élections transparentes bientôt ?
Je reste très sceptique. L’AIGE, bien qu’installée, ne dispose ni des moyens suffisants ni de l’autonomie nécessaire. On connaît les conditions floues de sa mise en place et ce flou persiste. Cela fait des années que le pouvoir répète les mêmes engagements, sans action concrète. Le Premier ministre a encore tenu un discours sans garanties, sans feuille de route claire. On est dans l’effet d’annonce, pas dans l’action réelle.
Charte pour la paix et la réconciliation : Outil d’unité ou texte vidé de l’essentiel ?
Annoncée comme un texte de référence, la Charte nationale pour la paix et la réconciliation est en voie d’achèvement. Mais certains sujets majeurs, comme le sort des partis politiques, ont été exclus de ses discussions. Ce choix interroge sur sa portée réelle dans un contexte politique toujours tendu.
Selon Zeïni Moulaye, ancien ministre et membre de la Commission, la Charte vise à « unir tous les fils du Mali autour de l’essentiel » et doit servir de socle aux politiques de sécurité, de paix et de réconciliation. C’est ainsi qu’elle intègre cinq grands thèmes – Paix, Sécurité, Réconciliation nationale, Cohésion sociale et Vivre ensemble – et valorise plus de vingt mécanismes de règlement locaux issus des différentes cultures du pays. Le texte n’a pas vocation à être un document partisan, a précisé Zeïni Moulaye, mais plutôt un outil transversal à portée nationale.
Le volet Sécurité, piloté par le Général à la retraite Yamoussa Camara, insiste sur la nécessité d’un maillage sécuritaire complet du territoire en s’appuyant sur une collaboration active entre forces armées et populations civiles. Trois fonctions stratégiques sont retenues, la protection, l’anticipation et l’intervention. Le Général Camara a rappelé que les mesures d’autodéfense communautaire doivent être encadrées et intégrées à une stratégie nationale afin d’éviter les dérives constatées ces dernières années.
Sur le plan judiciaire, le Dr Marie-Thérèse Dansoko a souligné que la Charte aborde les questions de justice de manière globale, en intégrant la lutte contre l’impunité, la corruption, la délinquance financière et l’enrichissement illicite. La justice transitionnelle est également traitée, avec une reconnaissance du rôle des autorités traditionnelles dans la résolution des conflits mineurs, sans exclure les voies judiciaires classiques. Pour elle, « la réconciliation ne peut se faire au détriment de la justice ».
Suspens autour de l’ancrage juridique
Mais, au-delà du contenu, des zones d’ombre persistent. Le document est « pratiquement achevé », selon la Commission, mais son ancrage juridique n’est pas encore défini. Ce sera à la Présidence, avec l’avis de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle, de déterminer son statut légal. Ce flou soulève des inquiétudes sur la portée réelle de la Charte à court et moyen terme.
Autre interrogation de fond : nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi la question du sort des partis politiques, et notamment leur dissolution, n’a pas été confiée à cette Commission, déjà mandatée pour traiter de la paix et de la cohésion nationale ? Le Dialogue Inter-Maliens d’avril 2024, à l’origine de la création de cette Charte, avait pourtant abordé des sujets éminemment politiques. C’est cette même instance qui avait proposé l’élévation du Colonel Assimi Goïta et de 5 autres officiers supérieurs au grade de Général, décision entérinée depuis. Et, selon plusieurs sources, l’avant-projet de la Charte avait également recommandé la libération, en décembre 2024, de onze personnalités politiques arrêtées en juin de la même année. Ces éléments démontrent que la Commission a déjà traité de dossiers politiques sensibles.
Dès lors, pourquoi avoir choisi d’écarter cette même Commission de la gestion du dossier explosif des partis politiques et de leur avenir, en lui préférant un nouveau cadre – les Concertations nationales du 16 au 29 avril – annoncé tardivement et préparé dans l’urgence ? Une meilleure articulation entre les deux cadres aurait peut-être permis une sortie de crise plus apaisée, dans un climat de confiance renforcée.
Publication retardée
De plus, le retard dans la publication officielle de la Charte interroge. Annoncée comme prioritaire dès 2024, sa remise au chef de l’État n’interviendra qu’à la fin du premier semestre 2025. Entre-temps, le pays a connu des bouleversements majeurs, tant sur le plan sécuritaire que politique, sans que ce texte ait pu jouer son rôle d’outil d’apaisement et de cohésion.
Autre aspect non négligeable, le Programme d’action gouvernementale 2025-2026 évoque bien la paix et la réconciliation dans l’un de ses huit axes, mais sans lien direct explicite avec le document en cours. Il reste donc à espérer que cette Charte, une fois remise, ne devienne pas un texte de plus, mais bien un guide concret d’action accepté par tous, y compris par ceux qui, jusqu’ici, n’ont pas été associés à son élaboration.
MD
Dissolution des partis politiques : Le grand nettoyage
Le 13 mai 2025, les autorités de la Transition ont annoncé par décret présidentiel la dissolution de l’ensemble des partis politiques et des associations à caractère politique. Officiellement présentée comme une étape décisive et un passage obligé vers la mise en œuvre des recommandations des Assises Nationales de la Refondation, cette mesure marque une rupture sans précédent dans l’histoire démocratique du pays.
Purge salutaire d’un système politique défaillant ou glissement préoccupant vers un pouvoir sans contrepoids ? La dissolution des partis politiques sur l’ensemble du territoire national ainsi que des associations à caractère politique continue de soulever des interrogations.
Le gouvernement de transition justifie cette mesure par la nécessité de reconstruire la scène politique sur des bases assainies, suite au constat, au fil des années, d’un pluralisme politique, vidé de sa substance, qui a réduit les partis à des instruments d’opportunisme électoral.
Plus de 280 partis politiques étaient enregistrés, dont une large majorité sans réelle activité ni ancrage territorial. En mettant fin à cette « cacophonie », le gouvernement entend ouvrir la voie à une nouvelle ère de gouvernance politique, mieux structurée et plus éthique.
Lors d’un point de presse tenu le 14 mai dernier, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Réformes politiques et du Soutien au processus électoral, Mamani Nassiré, a indiqué que la décision du gouvernement était la suite logique des différentes réformes engagées sous la Transition depuis quelques années.
« La dissolution des partis politiques constitue une voie que nous avons trouvée pour appliquer l’une des recommandations fortes, qui a été d’ailleurs faite par l’ensemble des forces vives de la Nation ayant participé aux Assises Nationales de la Refondation, à savoir la réduction du nombre des partis politiques », a confié pour sa part le Premier ministre Abdoulaye Maïga le 19 mai 2025 devant les membres du Conseil national de Transition.
L’analyste politique Ousmane Bamba partage cet avis. « Je fais la part des choses entre la démocratie et la dissolution des partis politiques. Cela n’a rien d’anti-démocratique. Selon moi, cela permet simplement une réorganisation », soutient-il.
Des voix contre
La décision du 13 mai a été accueillie avec indignation par une grande partie de la classe politique dissoute. Dénonçant une dérive autoritaire, certains dirigeants de formations politiques ont annoncé des recours en justice, tant devant les juridictions nationales que régionales et internationales, pour obtenir l’annulation du décret de dissolution des partis politiques.
L’ancien ministre de la Justice Mamadou Ismaïla Konaté regrette pour sa part « un recul historique du Mali en matière de démocratie ». « Cette dissolution des partis politiques confirme une volonté assumée d’installer un pouvoir militaire personnel, en dehors de tout processus démocratique. C’est un acte de guerre contre le pluralisme, l’État de droit et la liberté », dénonce l’ancien Garde des sceaux du Mali.
Dans un communiqué publié le 16 mai 2025, le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme, Volker Türk, a lui aussi appelé les autorités de la Transition malienne à abroger le décret de dissolution des partis et à rétablir pleinement les droits politiques dans le pays.
« Le Président de la Transition doit abroger ce décret draconien et toute restriction de la participation politique doit être conforme aux obligations internationales du Mali en matière de droits humains », a-t-il demandé.
Mais, dans un contexte où la Transition bénéficie d’un contrôle institutionnel renforcé et où les appels à la souveraineté nationale priment sur les injonctions extérieures, peu d’observateurs s’attendent à une issue favorable à court terme.
Les voies de recours, bien que légitimes, semblent symboliques face à la volonté politique affirmée de recomposition du champ politique.
Vers un système politique rationalisé ?
Le gouvernement ne cache pas ses intentions. Une nouvelle Charte des partis politiques est en cours d’élaboration. Le futur texte vise à définir un nouveau cadre légal, plus strict, pour autoriser l’existence et le fonctionnement des partis au Mali. Plusieurs pistes issues des recommandations des forces vives de la Nation sont déjà à l’étude.
D’abord, la mise en place de critères rigoureux de création, pour éradiquer les partis de façade et favoriser l’émergence d’acteurs politiques crédibles et enracinés. Parmi ces critères, entre autres, une implantation effective dans plusieurs régions, un fonctionnement interne démocratique et transparent et une caution de 100 millions francs CFA pour la création de tout parti politique.
Ensuite, la moralisation de la vie politique est érigée en principe fondateur. En vue de restaurer la confiance entre citoyens et représentants politiques, le futur texte pourrait interdire l’accès à la direction d’un parti à toute personne condamnée pour des faits de corruption ou de détournement de fonds publics.
Le financement public des partis sera lui aussi repensé. Pour éviter que les subventions publiques ne servent à enrichir quelques individus au lieu de soutenir l’action politique, la nouvelle charte pourrait supprimer tout simplement ce financement, comme recommandé d’ailleurs par les forces vives, ou établir de nouveaux mécanismes avec un contrôle renforcé de la Cour des comptes.
Enfin, des réflexions sont en cours autour de la limitation du nombre de partis autorisés. Si lors des dernières consultations des forces vives, fin avril dernier, elles avaient recommandé un maximum de cinq partis politiques dans le pays, certains évoquent l’instauration d’un système de regroupements politiques ou de blocs afin de structurer durablement la scène politique autour de grandes forces idéologiques cohérentes. Une telle configuration pourrait renforcer la lisibilité du débat public et la stabilité des institutions.
« Il faut que les nouveaux partis politiques naissent sur la base d’une idéologie. Les gens ont détaché la politique de l’idéologie. Or si l’on détache la politique de l’idéologie, on ne pourra plus faire la différence entre les partis politiques et le peuple n’aura plus de grille de lecture pour faire un choix conscient et civique », appuie l’analyste politique Ousmane Bamba.
Nouvelle architecture en vue
La dissolution des partis politiques actée le 13 mai 2025 ne signe pas la fin du jeu politique au Mali, mais son redémarrage sur des bases profondément remaniées. Pour exister dans le cadre du nouveau dispositif légal en gestation, les anciens partis devront se restructurer ou fusionner et revoir leur mode d’organisation. Si certains disparaîtront, d’autres renaîtront sous de nouvelles formes.
Lors de ce « nouveau départ », de nouveaux acteurs pourraient émerger. Des mouvements citoyens, des collectifs de jeunes, des personnalités issues de la société civile ou de la diaspora, ou même des jeunes leaders issus des anciennes formations politiques pourraient incarner une nouvelle dynamique. Le renouvellement générationnel et idéologique, souvent souhaité mais rarement observé, pourrait enfin s’amorcer.
Toutefois, cette probable recomposition de la scène politique ne va pas sans risques. Certains craignent que la refondation de la vie politique en cours dans le pays ne serve à verrouiller le système au profit d’un cercle restreint de fidèles du pouvoir.
Si la tentation d’exclure ou de marginaliser les voix discordantes semble bien réelle, le défi pour la Transition sera de concilier assainissement politique et pluralisme démocratique.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Réformes politiques et du Soutien au processus électoral, Mamani Nassiré, assure que le gouvernement mettra tout en œuvre pour élaborer la nouvelle charte dans un contexte inclusif.
Dans le processus de rédaction du nouveau texte, il affirme que les autorités de la Transition feront appel à toutes les personnalités qui peuvent y contribuer, y compris les anciens acteurs politiques.
Mohamed Kenouvi
Énergie : 30 milliards FCFA pour renforcer l’alimentation électrique autour de Bamako
Le Conseil des ministres du mercredi 21 mai 2025 a adopté des projets de textes relatifs à la ratification d’un accord de prêt entre le gouvernement du Mali et la Banque Ouest-africaine de Développement (BOAD), signé à Lomé le 10 mars 2025.
Cet accord porte sur un financement de 30 milliards de francs CFA, destiné à appuyer la construction du tronçon nord de la boucle Nord de 225 kilovolts autour de Bamako, ainsi que l’extension de plusieurs postes électriques stratégiques.
Les travaux prévus concernent la construction d’une ligne haute tension 225 kV en double circuit, reliant les localités de Kodialani, Kambila, Safo et Dialakorobougou, la création de nouveaux postes de transformation à Safo et Kénié, ainsi que le renforcement des postes existants de Kodialani, Kambila et Dialakorobougou. Il est également prévu l’extension du réseau haute tension pour l’électrification de nouveaux quartiers dans ces zones périurbaines.
Ce projet s’inscrit dans la politique de renforcement des infrastructures énergétiques autour de la capitale, face à une demande en électricité en hausse constante. Selon des données de l’EDM-SA, la région de Bamako concentre près de 40 % de la consommation nationale d’électricité, avec une croissance annuelle moyenne de la demande estimée entre 7 et 10 %. La boucle Nord, qui constitue un maillon du réseau interconnecté national, vise à sécuriser l’alimentation de la capitale et à réduire les coupures récurrentes.
En plus de soulager la pression sur les installations actuelles, le projet permettra de soutenir le développement des zones industrielles autour de Bamako et de faciliter l’électrification de nouveaux quartiers résidentiels, notamment dans les communes rurales limitrophes confrontées à une urbanisation rapide. Il pourrait également permettre une meilleure intégration des projets d’énergies renouvelables à venir, en augmentant la capacité d’évacuation du réseau haute tension.
L’accord de financement conclu avec la BOAD prévoit une contribution de l’État malien, avec un cofinancement possible par d’autres partenaires techniques. Le calendrier d’exécution précis du projet sera arrêté à l’issue des études techniques en cours.