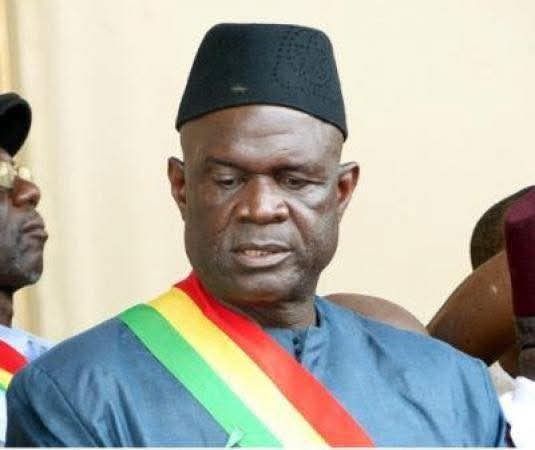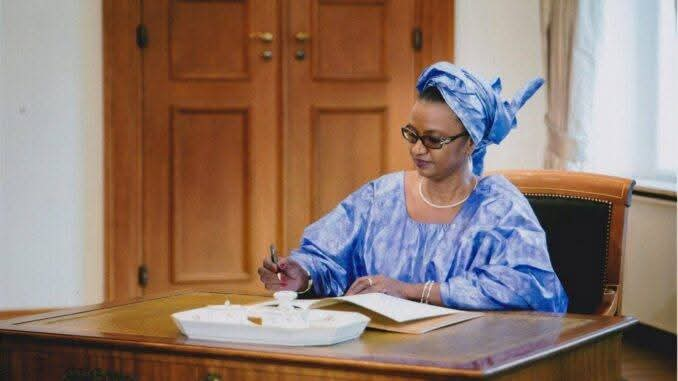La nouvelle loi portant révision de la Charte de la Transition a été promulguée, le 8 juillet, par le Président Assimi Goïta et rendue publique le 10 juillet. Le texte, adopté par le Conseil national de Transition (CNT) le 3 juillet, enterre l’interdiction faite aux autorités de la Transition d’être candidats aux prochaines élections, une disposition qui figurait dans la Charte adoptée en 2022.
Le texte promulgué est issu du projet de loi adopté en Conseil des ministres le 12 juin 2025, puis transmis et adopté sans amendement par le CNT le 3 juillet. Il consacre plusieurs modifications substantielles de la Charte, qui complète la Constitution du 22 juillet 2023. Le préambule révisé évoque désormais explicitement les « recommandations des Forces vives de la Nation » issues des consultations d’avril 2025 et insiste sur le caractère « patriotique » des évènements du 18 août 2020.
Dans son article 4 nouveau, la durée de la Transition est fixée à cinq ans renouvelables « autant de fois que nécessaire » à partir de la promulgation, jusqu’à la pacification du pays. Cette durée peut toutefois être écourtée dès que les conditions d’organisation d’élections « transparentes et apaisées » sont réunies. Selon les nouvelles dispositions, le Président de la Transition conserve ses prérogatives définies par la Charte et la Constitution.
La principale évolution par rapport à la Charte de 2022 se trouve dans les articles 9, 12 et 13 nouveaux, qui stipulent désormais clairement que le Président de la Transition, les membres du gouvernement et les membres du Conseil national de Transition (organe législatif) « sont éligibles » à l’élection présidentielle et aux élections générales qui marqueront la fin de la Transition. Cette éligibilité était explicitement exclue dans la version précédente de la Charte, qui précisait que les responsables de la Transition ne pouvaient pas se présenter aux scrutins organisés pour clore la période transitoire. Le texte de 2022 visait alors à éviter tout conflit d’intérêts et à garantir l’impartialité des institutions de Transition.
Les autres modifications portent sur la réaffirmation des valeurs de patriotisme, de probité, de mérite, d’intégrité et de réconciliation dans la conduite de la Transition (article 1 nouveau) ainsi que sur la confirmation des missions de sécurisation, de refondation institutionnelle, de réforme éducative, de bonne gouvernance, et de mise en œuvre des recommandations des Assises nationales et des consultations populaires.
La nouvelle Charte précise enfin que la Transition prendra fin avec l’élection présidentielle, la prestation de serment et la passation de pouvoir au président élu. Elle stipule que, en cas de contradiction entre la Charte et la Constitution de juillet 2023, c’est la Constitution qui prévaut.
Le CNT, qui a adopté la loi à la quasi‑unanimité le 3 juillet, avait justifié cette révision par la nécessité d’adapter la Transition à la situation sécuritaire persistante et aux recommandations issues des consultations populaires d’avril 2025.
Cette promulgation ouvre donc la voie à la participation du Président de la Transition, de ses ministres et des membres du CNT aux élections à venir, ce qui constitue une rupture avec l’esprit initial de la Charte de 2022, laquelle interdisait cette possibilité. Elle prolonge également, de manière potentiellement indéfinie, la durée de la Transition tant que la « pacification » du pays ne sera pas jugée acquise.