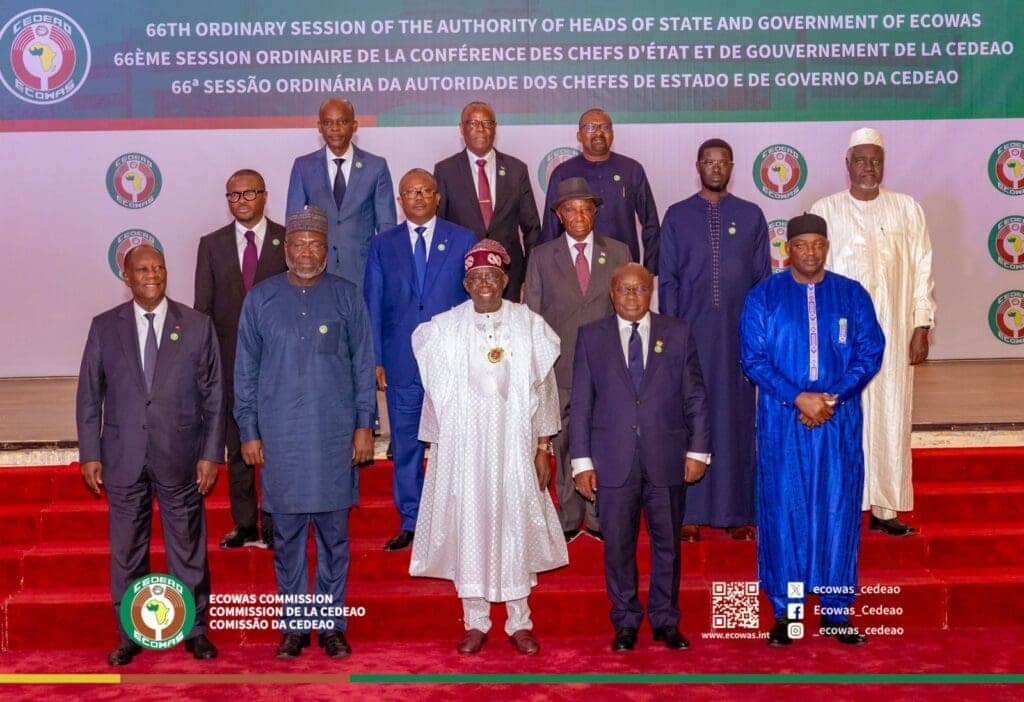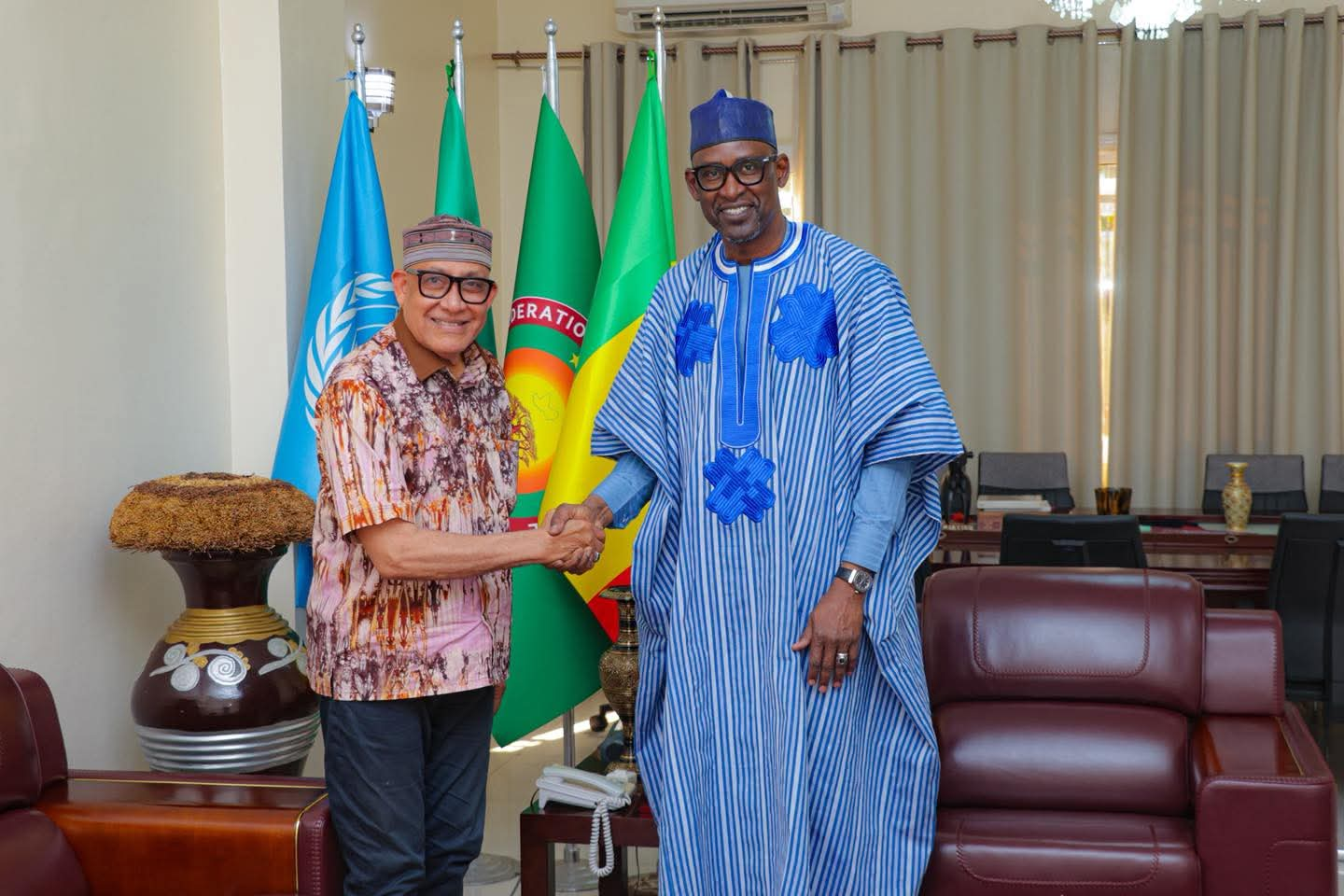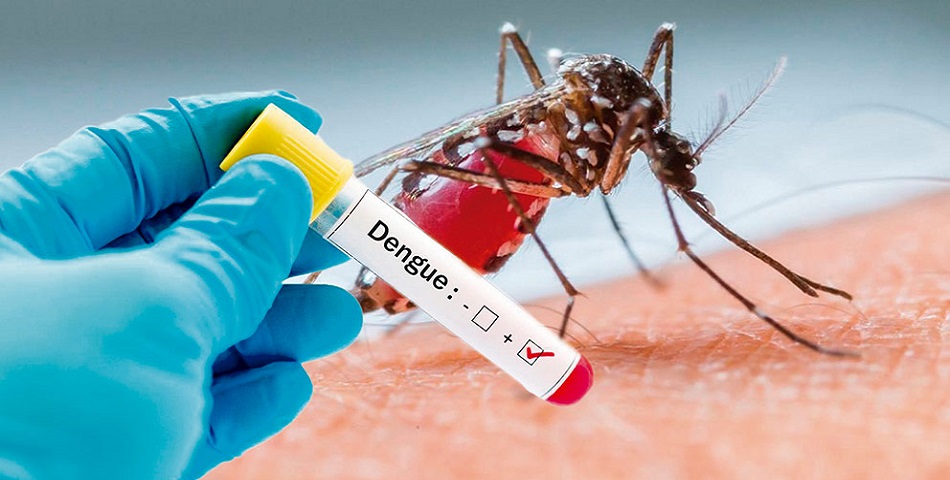Depuis quelques semaines, le Mali est de nouveau confronté à une série d’attaques terroristes coordonnées qui ont ciblé principalement des positions militaires. Face à cette recrudescence des violences, l’armée malienne a lancé une vaste contre-offensive.
Le Global Terrorism Index 2025 révèle que le Sahel concentre désormais plus de 51% des décès liés au terrorisme dans le monde, soit environ 4 794 morts en 2024. Ce phénomène place le Mali au cœur d’un fléau sécuritaire global, au-delà des seuls incidents mentionnés.
Lorsque l’attaque du camp militaire de Dioura, dans la région de Mopti, s’est déclenchée, le 23 mai 2025, nombreux sont ceux qui y ont vu un épisode isolé. Pourtant, cet assaut, qui selon des sources sécuritaires aurait fait des dizaines de victimes dans les rangs de l’armée, s’est vite révélé n’être que le premier acte d’une nouvelle poussée terroriste coordonnée qui allait secouer plusieurs régions du Mali.
Le 1er juin, c’est le camp stratégique de Boulkessi, près de la frontière burkinabè, qui est pris pour cible. Cette localité, déjà attaquée dans le passé, a été frappée avec une rare violence. Les terroristes du Groupe de soutien à l’Islam et aux Musulmans (JNIM), lourdement armés et visiblement bien renseignés, ont lancé une opération éclair. L’armée malienne, bien que résistante, a dû procéder à un repli tactique pour éviter un carnage dans un premier temps, avant de mener des opérations pour détruire plusieurs terroristes regroupés dans des lieux de repli.
Dans le même temps, au nord, Tombouctou s’embrasait à son tour. Le 2 juin, une attaque coordonnée mêlant explosion d’un véhicule piégé et assaut d’hommes armés visait à la fois le camp militaire et l’aéroport. Ce mode opératoire des grandes offensives du JNIM laisse supposer une volonté de frapper fort et symboliquement. L’armée a répliqué immédiatement, affirmant avoir neutralisé 14 terroristes, interpellé 31 autres présumés et repris la maîtrise du terrain.
Les jours suivants ont confirmé l’installation d’un front mouvant et étendu. Le 4 juin, Tessit, dans la région de Gao, est visée. Là, la riposte des FAMa a été plus préparée. Grâce à l’appui de l’aviation, les FAMa affirment avoir tué plus de quarante terroristes, dont un chef terroriste nigérien connu sous le nom de Mamoudou Akilou.
Le 5 juin, à Mahou, dans la région de Sikasso, un groupe d’hommes à motos attaque un poste militaire, causant la mort de cinq soldats et plusieurs blessés, selon une source militaire, bien que l’État-major général des FAMa n’ait pas communiqué sur les victimes dans les rangs de l’armée. Cette dernière, une fois encore, a engagé une poursuite aérienne appuyée par des commandos déployés au sol. Bilan : au moins 40 terroristes tués, 16 motos, 4 PM, une arme 12,7, plusieurs chargeurs, une importante quantité de munitions et de nombreux autres effets abandonnés par les terroristes.
Une campagne préparée en amont
Selon l’armée malienne, ces attaques sont le reflet d’un « sursaut d’une bête qui, déjà terrassée, est en train d’être ressuscitée et maintenue en vie par des forces désormais identifiées ».
Certains spécialistes notent une réorganisation tactique visible chez les groupes terroristes, notamment le JNIM. Après une période de relative accalmie dans certaines zones, ces groupes semblent avoir opéré une montée en puissance discrète, appuyée par un travail de fond sur leurs bases arrière, leur recrutement local et leur mobilité.
Des rapports indiquent que le JNIM revendique des milliers de combattants actifs au Sahel, avec une influence croissante dans la région, notamment dans des pays tels que le Burkina Faso, le Niger et même le Bénin et le Togo. Le groupe mise sur des réseaux clandestins et une gouvernance locale souterraine pour renforcer son emprise.
« Ces récentes attaques jihadistes au Mali témoignent de la volonté de certains groupes armés de maintenir une pression sur l’État et les populations, même face aux efforts importants engagés par les autorités pour restaurer la sécurité », explique Mohamed Maiga, analyste et consultant en Politiques sociales et territoriales.
« Ils sont dans une dynamique d’infiltrations simultanées dans plusieurs régions pour instaurer la peur et les conditions d’une insécurité chronique », appuie pour sa part Boubacar Ba, Directeur du Centre d’analyses sur la gouvernance et la sécurité au Sahel.
D’autres facteurs peuvent expliquer cette récente recrudescence des attaques terroristes dans plusieurs régions. Le réajustement interne au sein des forces armées maliennes et de leurs alliés constitue un élément de contexte particulièrement important.
Depuis fin mai, le groupe Wagner a annoncé son retrait du Mali, dans un contexte de réorganisation du soutien militaire russe en Afrique. Ce retrait s’effectue au profit du déploiement de l’Afrika Corps, une nouvelle structure militaire russe officiellement axée sur la formation, le soutien logistique et le renseignement plutôt que sur les opérations de terrain.
Selon le Council on Foreign Relations, la diminution de la présence occidentale, notamment le retrait des forces françaises et américaines, combinée à l’influence intermittente du groupe Wagner suivi de l’Afrika Corps, a créé un vide sécuritaire favorable aux groupes jihadistes. Ce repositionnement international ralentit la réactivité tactique de l’armée malienne.
Cette transition a entraîné, selon certains observateurs, un moment de flottement dans l’appui tactique immédiat dont bénéficiait l’armée malienne dans certaines zones sensibles. Les groupes armés auraient alors profité de cette brève période d’ajustement pour frapper vite et fort, avant que le nouveau dispositif ne soit totalement opérationnel.
Par ailleurs, la saison des pluies, qui débute progressivement dans certaines régions du pays, représente traditionnellement une contrainte pour les mouvements armés. Certains experts estiment que les groupes terroristes ont voulu devancer cette période difficile en multipliant les attaques avant l’arrivée effective de l’hivernage. Il s’agirait donc d’une campagne de pression, tactiquement opportuniste, menée dans une fenêtre logistique favorable.
Réponse militaire d’envergure
Face à cette vague de violences, l’armée malienne a opté pour une réaction immédiate et musclée. Des frappes aériennes ont été menées dans plusieurs zones supposées abriter des bases terroristes, notamment le 3 juin 2025 à Diafarabé, dans la région de Mopti, et à Niagassadiou, dans la région de Douentza. « Ces actions ont permis de désorganiser les planifications des groupes terroristes tout en leur infligeant de lourdes pertes », souligne l’armée.
À Tessit et à Tombouctou, des raids ciblés ont aussi permis de neutraliser plusieurs combattants ennemis. Des unités d’élite ont été redéployées sur les axes jugés sensibles et des patrouilles renforcées sillonnent les environs des camps récemment attaqués.
Le 4 juin, l’armée malienne a mené une série d’opérations offensives ayant permis de détruire des plots logistiques et de neutraliser plusieurs terroristes dans les régions de Ménaka, Douentza, Koulikoro et Kidal.
Dans un communiqué en date du 7 juin 2025, l’armée affirme avoir déjoué, à l’approche de la fête de Tabaski, plusieurs complots et projets d’attentats terroristes dont le but était de semer la panique au sein des populations et de déstabiliser les Institutions de la République, en coordination avec des relais financiers et médiatiques prêts à exploiter leurs actions.
Ainsi, le 6 juin, les FAMa ont débusqué et détruit le plot logistique terroriste de Kardjiba, à l’est de Gourma Rharous, dans la région de Tombouctou, ainsi qu’un autre dans les secteurs de Boulkessi et Douna, dans la région de Bandiagara.
Le jour suivant, l’armée a annoncé avoir détruit « suite aux renseignements précis et de longues heures de surveillance », une importante base terroriste à l’est de Zarho, dans la localité de Gourma Rharous, incluant un poste de commandement contenant des équipements et des moyens de transmission et 3 véhicules embarquant des combattants terroristes et d’importants stocks logistiques.
Adapter la stratégie
Pour éviter que cette vague d’attaques ne précède un hivernage meurtrier, les experts recommandent une stratégie combinant renforcement du renseignement, surveillance radar et déploiement rapide de forces mobiles. Sans cette anticipation, après l’hivernage la pression terroriste pourrait se transformer en insurrection prolongée.
Cependant, malgré ces nombreux résultats de la contre-offensive des FAMa, les défis restent nombreux. L’étendue du territoire national, la porosité des frontières et la complexité sociopolitique locale freinent encore la consolidation des victoires militaires.
« Il est possible que des camps militaires puissent empêcher les infiltrations, mais lorsque ces camps militaires stratégiques sont attaqués, le reste du pays devient vulnérable », alerte Boubacar Ba.
Pour le chercheur, la contre-offensive menée par l’armée peut atténuer les velléités terroristes, mais face à cette guerre hybride, de dissimulation et d’infiltration, conclut-il, l’armée malienne doit aussi développer une stratégie adaptée du point de vue des matériels et équipements, du renseignement et de l’action militaire même sur le terrain.
Mohamed Kenouvi