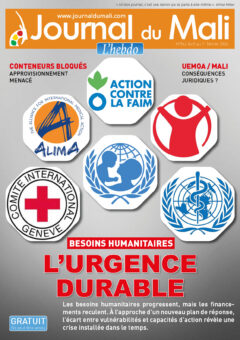L’incident du 1er avril 2025 entre le Mali et l’Algérie, marqué par la destruction d’un drone malien par les forces algériennes, a plongé les deux pays dans une crise diplomatique majeure. L’appareil, immatriculé TZ-98D, s’est écrasé à Tinzawatène, dans la région de Kidal, à environ 10 kilomètres au sud de la frontière. Bamako affirme que le drone n’a jamais quitté son espace aérien. Alger soutient au contraire qu’il a violé son territoire sur près de deux kilomètres.
Pour Bamako, les données de vol et l’enregistrement des coordonnées confirment que l’appareil a été abattu alors qu’il survolait encore le territoire malien, en mission de reconnaissance face à une menace terroriste. Trois jours après les faits, l’Algérie n’avait pas produit les preuves techniques réclamées. Le gouvernement malien évoque un acte d’agression prémédité, soulignant que le drone aurait pu permettre de neutraliser des cibles à haut risque.
En réaction, le Mali a convoqué l’ambassadeur d’Algérie à Bamako, protesté officiellement et pris trois mesures fortes : le retrait immédiat du Comité d’État-major Opérationnel Conjoint (CEMOC), le dépôt d’une plainte devant les instances internationales et la fermeture de son espace aérien à tous les vols en provenance ou à destination de l’Algérie. Celle-ci avait pris une mesure équivalente un peu plus tôt dans la même journée.
La Confédération des États du Sahel (AES), regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a exprimé son soutien total au Mali. Dans son communiqué, le Collège des Chefs d’État a qualifié la destruction du drone d’attaque contre l’ensemble de l’espace confédéral. Il a rappelé ses ambassadeurs accrédités à Alger, dénonçant une tentative de déstabilisation. L’Algérie, en retour, a rappelé ses ambassadeurs à Bamako et Niamey, tout en différant la prise de fonction de son diplomate à Ouagadougou.
Ce nouvel épisode marque une rupture. Pourtant, en mars dernier, la prise de fonction de Mohamed Dolo comme nouvel ambassadeur du Mali à Alger avait été perçue comme un signal d’apaisement après plusieurs mois de brouille. Cette tentative de normalisation semble aujourd’hui caduque.
Les tensions entre les deux pays ne datent pas d’hier. L’accueil réservé à l’Imam Dicko en Algérie en 2022 puis les critiques maliennes sur le rôle d’Alger dans l’Accord de paix de 2015 avaient déjà fissuré la confiance. Le retrait officiel du Mali de cet Accord en janvier 2024 a marqué un tournant. Bamako accuse désormais Alger d’abriter et de soutenir indirectement certains groupes armés, notamment dans le nord du Mali.
Le retrait du CEMOC est aussi un symbole fort. Cette structure, basée à Tamanrasset et regroupant l’Algérie, le Mali, le Niger et la Mauritanie, visait à renforcer la coordination militaire face aux menaces transfrontalières. Même si le CEMOC était peu actif ces dernières années, son abandon traduit une volonté de rupture stratégique. L’AES semble vouloir redéfinir ses partenariats en matière de sécurité.
Au-delà du CEMOC, d’autres cadres bilatéraux sont aujourd’hui en suspens. Des accords de coopération frontalière aux échanges de renseignements, l’ensemble des mécanismes de coordination pourrait être remis en cause. Or la frontière commune de plus de 1 400 kilomètres est l’une des plus sensibles de la bande sahélo-saharienne. Sans coopération active, la surveillance de cette zone complexe deviendra quasi impossible.
Le soutien unanime de l’AES à Bamako, avec seul le Niger comme membre du CEMOC, illustre un réalignement stratégique. Le Niger, bien que n’ayant pas formellement quitté le comité, se range du côté malien dans cette affaire, ce qui isole davantage Alger dans la région.
Cette crise dépasse donc le simple différend technique. Elle traduit l’échec d’une médiation historique et la montée d’un nouveau pôle sahélien structuré autour d’objectifs sécuritaires communs. Pour Alger, la perte d’influence dans la région est tangible. Pour le Mali, c’est l’affirmation d’une souveraineté sans concession.
À court terme, les perspectives de désescalade semblent faibles. À long terme, la question centrale reste la suivante : une coopération minimale est-elle encore possible entre deux pays liés par l’histoire, la géographie et des défis sécuritaires communs ? Car une rupture totale, dans un environnement régional aussi fragile, risque de créer un vide dont seuls les groupes armés tireront profit.
Massiré Diop