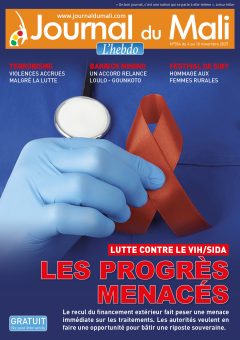Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé le 22 septembre 2025 leur retrait « avec effet immédiat » de la Cour pénale internationale, dénonçant une justice sélective et néocoloniale. Une décision au fort poids politique, mais dont la portée juridique est encadrée et différée dans le temps.
Les trois pays sahéliens ont adhéré au Statut de Rome peu après son adoption : le Mali en août 2000, le Niger en avril 2002 et le Burkina Faso en avril 2004. Ils avaient alors conclu des accords facilitant l’installation et le travail de la Cour, une coopération qu’ils jugent aujourd’hui devenue une contrainte. Dans leur communiqué, ils accusent la CPI de pratiquer une « justice sélective » et de garder un « mutisme complaisant » face à certains crimes, tout en s’acharnant contre ceux exclus du « cercle fermé des bénéficiaires de l’impunité internationale ». Parmi eux, seul le Mali a formellement déféré une situation à la Cour, en juillet 2012, après la chute du Nord face aux groupes armés. L’enquête avait été ouverte en janvier 2013, sur la base de l’article 13 du Statut, permettant à un État partie de saisir la juridiction pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou génocide.
Deux affaires emblématiques ont suivi. Ahmad Al Faqi Al Mahdi a été condamné le 27 septembre 2016 pour la destruction des mausolées de Tombouctou, sur le fondement de l’article 8-2-e)iv) relatif aux atteintes aux biens culturels. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud a été reconnu coupable le 26 juin 2024 de crimes de guerre et crimes contre l’humanité et condamné le 20 novembre 2024 à dix ans d’emprisonnement, peine réduite de douze mois le 23 juillet 2025.
Réparations en cours
L’affaire Al Mahdi a marqué un tournant en devenant en 2016 le premier procès pour destruction de biens culturels. En août 2017, la Chambre de première instance a ordonné 2,7 millions d’euros de réparations, financées en partie par le Fonds au profit des victimes, qui a mobilisé 1,35 million d’euros. Près de 989 victimes ont déjà bénéficié de réparations individuelles et une phase collective a été engagée en juillet 2022 à Tombouctou, incluant la réhabilitation de sites et un soutien communautaire.
Dans l’affaire Al Hassan, la décision sur les réparations est toujours attendue. Selon Mme Margo du bureau de l’information de la CPI à Bamako, « l’affaire Al Hassan est au stade des réparations pour les victimes. Nous attendons d’ailleurs une décision prochaine sur le type de réparations », soulignant que le processus reste pleinement en vigueur malgré l’annonce du retrait. Conformément à l’article 127 du Statut de Rome, ce retrait « ne libère pas l’État des obligations contractées » et « n’affecte pas la compétence de la Cour sur les affaires déjà engagées ».
Un retrait juridiquement limité
Le communiqué de l’AES parle d’un retrait « avec effet immédiat », alors que l’article 127-1 prévoit qu’il n’entre en vigueur qu’un an après notification au Secrétaire général de l’ONU. Comme le rappelle Mme Margo, ce délai implique que les obligations de coopération se poursuivent jusqu’en septembre 2026 et que les crimes commis jusque-là restent dans le champ de compétence de la Cour. Amnesty International a également réagi, soulignant que « le retrait du Statut de Rome n’aurait aucune incidence sur l’enquête en cours au Mali ni sur les obligations de coopération de l’État envers la Cour, mais il compromettrait l’accès futur des victimes de crimes graves à la justice internationale », selon Marceau Sivieude, Directeur régional pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale.
Pour Dr Jean-François Marie Camara, enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences administratives et politiques, cette annonce s’inscrit dans la dynamique des retraits précédents mais surprend au moment où le Mali saisit la CIJ. Il avertit que la souveraineté ne doit pas conduire à l’isolement et plaide pour le renforcement de juridictions nationales compétentes et impartiales.
Les précédents du Burundi, sorti en octobre 2017, et des Philippines, en mars 2019, confirment que la CPI conserve sa compétence pour les crimes commis avant le retrait. D’autres pays africains avaient amorcé la même démarche avant de reculer : la Gambie de Yahya Jammeh, dont la notification d’octobre 2016 a été annulée après l’alternance politique, et l’Afrique du Sud, où la justice a jugé la procédure inconstitutionnelle. Ces exemples illustrent que les annonces de dénonciation du Statut de Rome peuvent être réversibles.
Dynamique régionale
Au-delà du droit, l’annonce du 22 septembre 2025 s’inscrit dans le repositionnement politique de l’AES, marqué par le retrait du G5 Sahel en 2022, la sortie de la CEDEAO en janvier 2024, puis la suspension de sa participation à l’Organisation internationale de la Francophonie en 2024. Quelques jours plus tôt, du 15 au 17 septembre 2025 à Niamey, les ministres de la Justice avaient évoqué la création d’une Cour pénale sahélienne des droits de l’Homme pour juger les crimes internationaux, le terrorisme et la criminalité organisée. Présentée comme une justice « endogène », cette initiative reste entourée d’incertitudes, tant sur son financement que sur l’indépendance des juges, les garanties procédurales et le calendrier de sa mise en œuvre.
Relation complexe
L’Afrique compte 33 États parties au Statut de Rome, soit plus d’un quart des membres, mais est la région la plus concernée, avec neuf situations ouvertes depuis 2002. Plusieurs dirigeants africains ont été visés, d’Omar el-Béchir à Uhuru Kenyatta, tandis que Laurent Gbagbo avait été transféré à La Haye avant son acquittement en 2021. Plus récemment, la Cour a émis des mandats d’arrêt contre Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahu, montrant que sa compétence peut s’étendre à des États non signataires par renvoi du Conseil de sécurité ou selon la reconnaissance territoriale.
Mme Margo rappelle que « la CPI est une cour de dernier recours », complémentaire des juridictions nationales, et cite les saisines du Mali, de la RDC, de l’Ouganda ou encore de la Centrafrique. Elle insiste aussi sur le fait que la Cour mène des enquêtes bien au-delà de l’Afrique, « notamment en Palestine, au Venezuela, en Géorgie, en Ukraine, au Bangladesh / Myanmar ou encore en Afghanistan ».
Les victimes, premières concernées
La question des victimes reste centrale. Les réparations de l’affaire Al Mahdi se poursuivent malgré le retrait, mais le Fonds au profit des victimes, qui dépend de contributions volontaires, pourrait être fragilisé par des difficultés d’accès au terrain. Dans l’affaire Al Hassan, la décision sur les réparations est encore attendue et les victimes maliennes resteront sous la compétence de la Cour jusqu’en septembre 2026. « La CPI a permis à de nombreuses victimes de voir les présumés auteurs de crimes jugés et, dans les affaires où des condamnations ont été prononcées, de recevoir des réparations », rappelle Mme Margo.
Aucun impact sur la CIJ
La décision de l’AES n’affecte pas les procédures devant d’autres juridictions internationales, comme la Cour internationale de Justice de La Haye, où le Mali a déposé le 16 septembre une plainte contre l’Algérie pour la destruction d’un drone à Tinzaouaten. La CIJ, qui juge les différends entre États en vertu de son Statut, est une juridiction distincte de la CPI. Le retrait annoncé ne change rien à cette procédure.
En tout état de cause, l’annonce du 22 septembre marque une rupture politique forte, l’AES affirmant sa volonté de se distancier d’une institution jugée partiale et d’envisager une alternative régionale. Sur le plan juridique, l’article 127 du Statut limite toutefois les effets du retrait, puisque les affaires maliennes se poursuivent, que les condamnations et réparations demeurent et que la compétence de la Cour reste valable jusqu’en septembre 2026. Cette tension entre souveraineté et obligations pose la question de savoir si une future Cour sahélienne pourra garantir aux victimes le même niveau de justice que la CPI.
MD