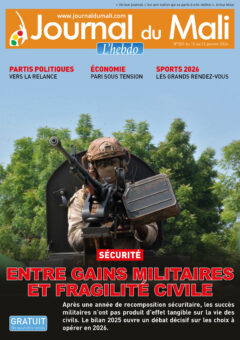Alors que les attaques et les pénuries rappellent la fragilité du pays, l’idée d’un dialogue doctrinal refait surface. Entre réalités sécuritaires et quête de réconciliation, de nombreuses voix appellent à désarmer les esprits avant les armes.
Les longues files devant les stations-service de Bamako reflètent la pénurie de carburant causée par les attaques contre les camions-citernes, paralysant une partie du pays. Cette recrudescence des violences perturbe les échanges économiques et la sécurité des populations, ravivant le débat sur la nécessité d’un dialogue avec les groupes armés.
C’est dans ce contexte que le Professeur Ali Nouhoum Diallo, ancien Président de l’Assemblée nationale, s’est récemment exprimé avec insistance sur la nécessité d’un dialogue doctrinal. Dans une tribune largement relayée, il appelle à une clarification religieuse conduite par les érudits maliens pour déconstruire les interprétations erronées du Coran qui servent de fondement idéologique aux violences. Selon lui, le retour à la paix passe par la réappropriation du discours religieux et par la parole de ceux qui détiennent l’autorité spirituelle.
L’idée d’un tel dialogue a trouvé un écho particulier lors de plusieurs rencontres nationales, y compris le Dialogue inter-Maliens de 2024, dont le rapport final recommande l’ouverture de discussions doctrinales et communautaires avec toutes les parties, notamment les mouvements armés se réclamant du Jihad.
Les participants y ont vu une étape vers la réconciliation nationale, à condition que le processus soit conduit par des acteurs crédibles et proches du terrain. Des chercheurs jugent cette approche pertinente, mais difficile à mettre en œuvre dans un climat marqué par la méfiance et la fragmentation des acteurs.
Des exemples à dupliquer
Sur le continent, plusieurs pays ont adopté des approches comparables. En Mauritanie, dès 2010 des théologiens ont dialogué avec des détenus radicalisés, permettant à certains de renoncer à la violence et de se réinsérer. En Algérie, la réconciliation nationale après la décennie noire des années 1990 a favorisé des amnisties encadrées et une désescalade durable.
Au Maroc, le programme Moussalaha lancé en 2017 combine rééducation religieuse, accompagnement psychologique et réinsertion socioéconomique. Au Nigeria, Operation Safe Corridor propose un parcours de déradicalisation et de formation professionnelle pour d’anciens membres de Boko Haram. Ces initiatives démontrent qu’un dialogue fondé sur la foi et la raison peut efficacement compléter l’action militaire.
Au Mali, le prêtre allemand Ha-Jo Lohre, enlevé à Bamako en 2022 puis libéré un an plus tard, a partagé son expérience et ses échanges avec de jeunes ravisseurs animés d’un idéal religieux mal compris. Il estime qu’un débat doctrinal mené par des érudits dans les langues locales pourrait les amener à douter de leurs convictions. Il préconise aussi l’usage des médias et des réseaux sociaux pour promouvoir des messages de paix, à l’image des vidéos d’érudits maliens répondant aux discours extrémistes.
Des pistes à explorer
Sur le plan économique, la crise sécuritaire a aggravé les difficultés du pays. Le Président du Conseil national du Patronat, Mossadeck Bally, a récemment souligné les effets de l’insécurité et de la pénurie de carburant, rappelant que la paix ne se conquiert pas par les armes. Il appelle à un dialogue national réunissant gouvernement, secteur privé, société civile et groupes armés pour traiter les causes profondes du conflit et rétablir la confiance. Il estime que la survie du pays passe par une mobilisation collective et une refonte économique et sociale pour combattre la précarité.
Mécanismes endogènes
Pourtant, le ministère des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes dispose d’un Secrétariat permanent chargé d’appliquer la Politique nationale de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme (2021 – 2025). Cette structure forme Imams et enseignants coraniques, promeut la tolérance religieuse et encourage des prêches axés sur la paix et la cohésion sociale, établissant ainsi un cadre institutionnel favorable à un futur dialogue doctrinal.
Ce mécanisme pourrait, en collaboration avec le Haut Conseil islamique et avec l’appui de personnalités indépendantes ou de leaders communautaires respectés, constituer un cadre privilégié pour initier et encadrer ce dialogue doctrinal.
Les appels au dialogue se multiplient parmi les leaders religieux, politiques et économiques, unanimes sur un point : la réponse militaire, bien que nécessaire, ne suffit pas à instaurer une paix durable.
Le dialogue doctrinal s’impose alors comme une voie essentielle pour comprendre et désamorcer l’idéologie de la violence, redonner sens à la foi et restaurer les liens communautaires. En alliant parole religieuse et raison politique, cette approche pourrait restaurer la paix par la connaissance et l’écoute, là où les armes ont échoué.
MD