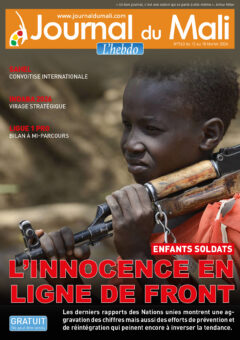Plusieurs conflits armés demeurent actifs en République démocratique du Congo, au Soudan, dans le Sahel et dans la Corne de l’Afrique, avec des conséquences humaines et sécuritaires majeures. Dans ce contexte, l’Union africaine peine à s’imposer comme un acteur central, tandis que les initiatives diplomatiques et sécuritaires sont largement portées par des puissances extérieures.
De l’est de la République démocratique du Congo au Soudan, les dynamiques de violence continuent de s’intensifier ou de se fragmenter. En RDC, les affrontements impliquant des groupes armés aux ramifications régionales provoquent des déplacements massifs de populations et fragilisent davantage un État déjà sous pression. Malgré des cadres de dialogue existants et des accords successifs, les combats se poursuivent, mettant en évidence l’incapacité des mécanismes africains à imposer une désescalade durable.
Au Soudan, le conflit déclenché en 2023 a entraîné l’effondrement quasi total des structures étatiques. Les violences récurrentes, y compris contre des installations humanitaires et onusiennes, illustrent une guerre devenue incontrôlable, où les appels de l’Union africaine à un cessez-le-feu restent sans effet concret. La situation humanitaire y est aujourd’hui l’une des plus graves au monde, avec des millions de déplacés et de réfugiés.
Au Sahel, la persistance des groupes armés et la recomposition des alliances régionales traduisent une instabilité durable. Face au relatif effacement de l’Union africaine, certaines organisations sous-régionales, dont la CEDEAO, tentent de s’affirmer sur la gouvernance, les transitions politiques et la sécurité, malgré des divergences internes et des capacités opérationnelles inégales.
Face à ces crises, l’Union africaine apparaît souvent en retrait, les médiations les plus visibles étant menées par des acteurs extérieurs comme les États-Unis, le Qatar ou certaines puissances européennes. Si ces initiatives maintiennent parfois le dialogue, elles restent largement guidées par des intérêts stratégiques liés aux ressources, à l’énergie, à la sécurité maritime et à l’influence géopolitique.
Cette situation alimente le sentiment d’une marginalisation de l’architecture africaine de paix et de sécurité. Cantonnée à un rôle surtout normatif, l’Union africaine peine à traduire ses positions en actions concrètes, tandis que la multiplication des conflits interroge quant à sa capacité réelle à prévenir et résoudre les crises.
Le sommet de l’Union africaine de février 2026 est attendu comme un test de la capacité de l’organisation à renforcer son rôle opérationnel dans la gestion des crises, notamment sur les mécanismes de prévention, de médiation et de financement de la paix, à l’épreuve de conflits persistants.
Massiré Diop