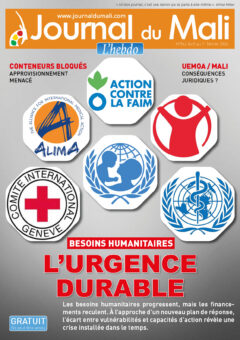Depuis le « Jour de la libération » proclamé par Trump le 2 avril, date à laquelle le président des États-Unis a annoncé l’imposition de droits de douane très élevés à l’encontre de ses adversaires comme de ses alliés, l’opinion générale est pessimiste quant aux perspectives de l’économie américaine à court, moyen et long terme : ces droits de douane démesurés provoqueront une récession aux États-Unis et à travers le monde, c’en est fini de l’exceptionnalisme américain, le déficit budgétaire et celui de la balance courante du pays deviendront insoutenables, le statut du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale disparaîtra, et le billet vert s’affaiblira considérablement au fil du temps, entend-on actuellement.
Ce pessimisme est certes justifié par plusieurs des politiques annoncées par Trump. Droits de douane, protectionnisme et guerre commerciales sont en effet de nature à provoquer une stagflation (augmentation de l’inflation et ralentissement de la croissance), tout comme les restrictions draconiennes sur l’immigration, les expulsions massives de travailleurs sans papiers, les importants déficits budgétaires non financés, ou encore les démarches contraires à l’indépendance de la Réserve fédérale des États-Unis. De même, l’économie américaine ne tirerait aucun bénéfice d’un accord de Mar-a-Lago consistant à affaiblir le dollar, de nouvelles atteintes à l’État de droit dans le pays et à travers le monde, ou de restrictions plus sévères sur les talents étrangers – scientifiques et étudiants – accueillis aux États-Unis.
Je maintiens pour autant (depuis l’hiver dernier) que l’économie américaine continuera de bien se porter – non pas grâce aux politiques de Trump, mais en dépit de celles-ci. Pour commencer, je m’attendais à ce que la discipline de marché, les conseillers plus raisonnables de Trump ainsi que l’indépendance de la Fed l’emportent, et c’est précisément ce qui s’est produit. Trump a systématiquement reculé, et il a préféré conclure des accords commerciaux plutôt que d’appliquer les droits de douane annoncés le Jour de la libération.
Si Trump a pour défaut de toujours s’emporter (« TALO », « Trump Always Lashes Out »), les justiciers obligataires et les marchés financiers l’ont davantage conduit à toujours finir par se dégonfler (« TACO », « Trump Always Chickens Out »). Ses politiques économiques les plus préjudiciables s’assouplissant, l’économie américaine connaîtra certes des difficultés, mais le scénario le plus probable pour la fin de l’année réside davantage dans ce que l’on appelle une récession de croissance (taux inférieur à la croissance potentielle) que dans une récession à proprement parler (généralement définie comme deux trimestres consécutifs de croissance négative).
Deuxièmement, dans la mesure où les effets positifs de la technologie l’emporteront toujours sur les effets négatifs des droits de douane, il est erroné de parler de fin de l’exceptionnalisme économique américain. Les États-Unis demeurent en avance sur tous les pays du monde – Chine incluse – en ce qui concerne la plupart des innovations révolutionnaires qui façonneront l’avenir. La croissance annuelle potentielle des États-Unis devrait par conséquent augmenter à un taux de 2 à 4 % jusqu’à la fin de cette décennie, avant d’afficher un taux bien supérieur dans les années 2030. Supposons que les nouvelles technologies conduisent sa croissance potentielle à augmenter de 200 points de base, et que les politiques commerciales et autres mauvaises décisions la réduisent de 50 points de base ; l’Amérique conserverait pour autant son exceptionnalisme. C’est le secteur privé singulièrement dynamique des États-Unis qui déterminera les futures perspectives de croissance du pays, pas les politiques de Trump.
Troisièmement, si la croissance potentielle s’accélère au fil du temps jusqu’à atteindre 4 %, la dette publique et la dette extérieure des États-Unis en part du PIB demeureront viables, et se stabiliseront puis diminueront progressivement (sauf imprudence budgétaire encore plus conséquente). Si le Bureau du budget du Congrès prévoit une augmentation du ratio dette publique/PIB, c’est parce qu’il présume que la croissance potentielle américaine plafonnera à 1,8 %.
Quatrièmement, tant que l’exceptionnalisme économique américain perdurera, il ne faut pas s’attendre à voir disparaître le « privilège exorbitant » conféré par la primauté mondiale du dollar. Malgré l’augmentation des droits de douane, les déficits extérieurs américains resteront probablement élevés, l’investissement en part du PIB augmentant grâce à un boom technologique prolongé, et le taux d’épargne demeurant relativement stable. Le creusement qui en résultera du côté du déficit de la balance courante sera financé par les flux entrants de capitaux (investissements de portefeuille et investissements directs étrangers).
Dans ce contexte, il est peu probable que le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale soit significativement remis en cause, même en cas de légère diversification des actifs libellés en dollars. De même, ces flux entrants structurels limiteront les risques de baisse des taux de change, et pourraient même renforcer le dollar à moyen terme.
En résumé, il faut s’attendre à ce que les États-Unis se portent bien au cours de cette décennie, pas grâce à Trump, mais malgré lui. Il ne fait aucun doute que bon nombre de ses politiques sont potentiellement stagflationnistes. Pour autant, les États-Unis s’inscrivent au cœur de certaines des innovations technologiques les plus importantes de l’histoire de l’humanité, qui produiront un important choc positif sur l’offre globale, lequel entraînera avec le temps une augmentation de la croissance et une réduction de l’inflation. Cet effet sera certainement sans commune mesure avec les dégâts susceptibles de résulter des politiques stagflationnistes de Trump.
Il ne s’agit pas de se satisfaire de politiques préjudiciables, dont l’impact pourrait être sérieux. Mais tant que les marchés et les acteurs vigilants du marché obligataire feront leur travail, les pires instincts de Trump demeureront sous contrôle.
Nouriel Roubini, conseiller principal chez Hudson Bay Capital Management LP, est professeur émérite à la Stern School of Business de l’Université de New York. Son ouvrage le plus récent s’intitule Megathreats : Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future, and How to Survive Them (Little, Brown and Company, 2022).
Project Syndicate, 2025.
www.project-syndicate.org