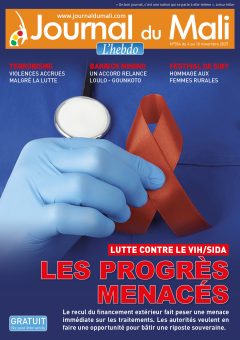Le 15 mai 2025, les Directeurs généraux des Douanes des États de l’AES se sont retrouvés à Bamako autour de l’harmonisation des procédures douanières dans l’espace confédéral. Une étape importante destinée à faire le point sur les recommandations antérieures et à progresser vers un espace douanier unifié.
Les États de la Confédération de l’AES (Burkina Faso, Mali, Niger) sont désormais engagés dans un processus d’unification de leurs procédures et de leurs textes douaniers. Si la construction de cette nouvelle architecture juridique comporte des défis, elle s’inscrit dans la continuité logique du processus enclenché par ces États depuis leur retrait de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Pour les futures négociations avec la CEDEAO, l’AES souhaite adopter une position commune, exprimée de manière collective et coordonnée, affirmant ainsi son unité. Une telle orientation ne suscite pas de blocages particuliers à ce stade. « En théorie, le retrait des États de l’AES de la CEDEAO ne devrait pas empêcher les pays de la sous-région de négocier des accords de partenariat dans des domaines stratégiques tels que la sécurité transfrontalière, les tarifs extérieurs communs, ainsi que la libre circulation des personnes et des capitaux », expliquait le Dr Abdoul Sogodogo, dans une étude intitulée « AES, Défis et Perspectives », publiée en septembre 2024.
La coexistence de plusieurs organisations dans l’espace sous-régional n’est d’ailleurs pas une réalité nouvelle, poursuit-il. Celle de la CEDEAO et de l’UEMOA en est une illustration. L’avènement de la nouvelle entité, l’AES, pourrait même représenter une opportunité pour attribuer à chaque organisation un mandat spécifique : à l’UEMOA, les questions monétaires ; à la CEDEAO, le développement intégré et la démocratisation ; à l’AES, les questions de sécurité, pour combler les lacunes des initiatives précédentes.
Dès sa création, l’AES s’est positionnée non seulement comme un instrument sécuritaire face aux défis communs, mais aussi comme un levier diplomatique et économique au service des trois États qui la composent.
Un espace intégré en construction
Avant la rencontre des Directeurs généraux des Douanes de l’AES à Bamako, plusieurs réunions avaient jeté les bases d’une coopération douanière plus étroite entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger.
À Niamey, en juillet 2024, la rencontre des DG des Douanes de l’AES a permis de créer des groupes de travail sur le transit, le Code des douanes, les tarifs communs et les règles d’origine. L’interconnexion des systèmes douaniers est apparue comme une priorité pour répondre aux difficultés d’approvisionnement et sécuriser les recettes douanières.
Ce processus s’est poursuivi lors de la réunion de Lomé, en septembre 2024, avec une recommandation forte en faveur de l’interconnexion des systèmes douaniers, y compris avec le Togo.
En janvier 2025, à Ouagadougou, les autorités douanières des trois pays ont évalué l’état d’avancement de cette interconnexion, notamment avec l’administration douanière togolaise.
La réunion de Bamako visait donc à dresser un état des lieux de l’évolution des chantiers engagés et des projets de textes. Parmi les dossiers examinés figuraient : l’encadrement du métier de Commissionnaire en douanes, l’adoption d’un Code des douanes unifié, l’établissement de règles d’origine spécifiques à l’AES, le régime de transit communautaire et l’élaboration de tarifs extérieurs communs (TEC) et préférentiels.
À l’issue des travaux, les Directeurs généraux ont validé le chronogramme proposé pour la finalisation du Code confédéral des douanes et des TEC entre le 28 et le 31 juillet 2025. Ils ont également fait le point sur les recommandations de Lomé : 7 sur 16 ont été réalisées, 6 sont en cours, et 3 restent à mettre en œuvre.
L’un des objectifs de cette réunion était de formuler des propositions concrètes à transmettre aux autorités de l’AES en vue des prochaines discussions avec la CEDEAO.
Interdépendance et dialogue
Le 22 mai 2025, les ministres des Affaires étrangères des pays de l’AES ont rencontré à Bamako le Président de la Commission de la CEDEAO. Cette première session de consultations visait à organiser les négociations entre les deux entités, après la formalisation du retrait de l’AES.
Les discussions ont porté sur les aspects politiques, diplomatiques, institutionnels, juridiques et sécuritaires, mais aussi sur le développement économique et social. Les deux parties ont souligné leur volonté de préserver les acquis majeurs de l’intégration régionale, en particulier la libre circulation des personnes et des biens.
La situation sécuritaire, point de friction majeur entre les États du Sahel et la CEDEAO, a également été abordée. Face à la menace persistante du terrorisme, les deux blocs ont réaffirmé leur volonté de coopérer dans ce domaine, essentiel à la stabilité régionale. Un impératif partagé dans un espace où les économies sont étroitement liées.
En 2024, 22,6% des importations du Mali provenaient de la CEDEAO, contre 31,3% pour le Burkina Faso. En 2022, les exportations du Niger vers la France, le Mali et le Burkina Faso représentaient 35,3% de son PIB. Ses importations – évaluées à environ 4 milliards de dollars – provenaient principalement de la France, de la Chine et des États-Unis.
Cadre parallèle avec l’UEMOA
Le Burkina Faso, le Mali et le Niger restent membres de l’UEMOA. Dans son rapport annuel 2024, l’Union mentionne des progrès en matière d’union douanière, notamment avec l’élaboration d’un avant-projet de règlement sur les procédures simplifiées de dédouanement.
La Commission a poursuivi ses efforts pour dématérialiser l’octroi d’agrément de l’origine et a reconnu l’origine communautaire de 111 produits. Elle a aussi renforcé le système d’alerte contre les entraves à la libre circulation et au droit d’établissement. Toutefois, elle admet que la mise en œuvre de ces dispositifs reste incomplète. Des campagnes de plaidoyer, de sensibilisation et de renforcement des capacités ont été menées dans les postes de contrôle pour améliorer la situation sur les corridors commerciaux.
Trois mois après la sortie formelle de la CEDEAO, les autorités de l’AES se sont réunies à Bamako le 28 mars 2025. Dans une logique d’autofinancement, elles ont adopté un prélèvement communautaire de 0,5% sur les importations provenant de pays tiers non membres de l’AES, à l’exception des États de l’UEMOA, de l’aide humanitaire et des biens diplomatiques. Ce prélèvement (PC-AES) concerne uniquement les pays n’ayant pas d’accord douanier avec l’AES. L’issue des négociations en cours avec la CEDEAO permettra de savoir si cette mesure s’y appliquera.
Vers une Banque confédérale
Le 16 janvier 2025, les États de l’AES ont entamé des discussions sur la création d’une Banque d’investissement. Le 23 mai 2025, les ministres des Finances de l’AES ont adopté les documents fondateurs de la Banque Confédérale pour l’Investissement et le Développement (BCID). Doté d’un capital initial de 500 milliards de francs CFA, cet instrument vise à financer des projets structurants dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie, de l’éducation et de l’industrialisation.
Estimée à 6,9% du PIB de la CEDEAO et à 28,4% de celui de l’UEMOA, la production économique de l’AES reste encore modeste, mais ses États membres souhaitent se doter d’un instrument vital pour soutenir leur développement.
Les défis sont immenses pour cette nouvelle institution, pensée pour réduire la dépendance des économies aux financements extérieurs. Elle devra répondre aux nombreuses attentes, notamment en matière de dynamisation des économies locales, de lutte contre le chômage des jeunes, de promotion de l’entrepreneuriat et de modernisation des infrastructures.