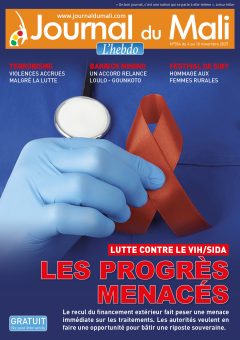L’audit du financement public des partis politiques, lancé en juin 2025 par la Section des Comptes de la Cour suprême du Mali, suit son cours, dans un climat marqué par une faible collaboration des principaux concernés.
Cet exercice inédit, qui couvre un quart de siècle, de juillet 2000 à mai 2025, vise à faire toute la lumière sur l’usage des fonds publics alloués aux formations politiques, dissoutes en mai dernier par décret présidentiel. Jamais auparavant un contrôle d’une telle ampleur n’avait été conduit sur les finances publiques de l’ensemble des partis politiques du pays.
Le 29 octobre 2025, la Cour suprême a invité les anciens responsables des ex-partis à retirer les extraits des rapports provisoires au plus tard le 6 novembre et leur a donné jusqu’au 5 décembre prochain pour déposer leurs observations auprès de son secrétariat.
Cette étape constitue le pivot du principe du contradictoire, garantissant aux ex-dirigeants politiques la possibilité de répondre aux premières conclusions des magistrats financiers et, en théorie, d’apporter des rectifications ou des justificatifs susceptibles d’influer sur les conclusions finales.
Cependant, dans les faits, la démarche avance lentement et difficilement. Quelques anciens responsables politiques joints par nos soins ont refusé de commenter la procédure et les premiers retours indiquent qu’une faible proportion de formations dissoutes a effectivement retiré les documents et fournira peut-être les observations attendues. Pour elles, l’audit serait perçu comme une procédure hostile ou comme une extension de la décision de dissolution qu’elles continuent de contester devant diverses juridictions.
Certains leaders avaient d’ailleurs affiché leur position dès le début du processus. Me Mountaga Tall, Président du parti dissous CNID-Faso Yiriwaton, avait annoncé qu’il ne répondrait pas à la requête de la Cour et qu’il ne fournirait aucun justificatif sur les dépenses de son ancien parti.
De son côté, Konimba Sidibé, de l’ancien parti MODEC (Mouvement pour un destin commun), avait dénoncé un audit « problématique », dépassé de 15 ans, selon lui, au regard du délai légal de conservation obligatoire des documents comptables, fixé à 10 ans au Mali. Ces arguments traduisent une défiance ouverte vis-à-vis de la démarche de la Cour suprême.
Un audit sous contraintes
Cette absence de coopération soulève désormais une question centrale : comment la Cour suprême pourra-t-elle finaliser son audit dans un contexte où le contradictoire ne peut être pleinement assuré ?
Les magistrats de la Section des Comptes disposent de prérogatives étendues en matière de vérification, mais leur travail repose en grande partie sur la disponibilité de documents fiables, complets et authentifiés. L’absence de réponses ou de justificatifs complique donc l’analyse de certaines dépenses.
Selon plusieurs observateurs, le cadre légal impose le principe du contradictoire, mais il n’interdit pas à la Section des Comptes de clore une vérification et de rendre des conclusions définitives si certaines parties restent silencieuses.
La Cour pourrait alors s’appuyer uniquement sur les pièces comptables déjà en sa possession ou sur les rapports précédents produits annuellement sur les partis. En parallèle, elle conserve la possibilité de sanctionner les refus de communication de documents, même si, dans la pratique, ce type de sanctions est peu fréquent et que, dans un contexte où les partis politiques sont déjà dissous, il risque d’être sans effet.
Toutefois, une telle issue n’est pas sans risques. Les anciens responsables pourraient contester les résultats en invoquant un contradictoire incomplet, tandis que la Cour, de son côté, assumerait un choix de fermeté visant à mener l’exercice jusqu’à son terme.
L’audit, qui est une recommandation issue des consultations des Forces vives de la Nation des 28 et 29 avril 2025, très attendu par une partie de l’opinion, pourrait alors se retrouver au cœur d’un bras de fer politico-judiciaire autour de la question de la transparence et de la reddition des comptes. Mais, à mesure que s’approche l’échéance du 5 décembre, il semble se diriger vers sa finalisation, même en l’absence de participation active des responsables des ex-partis.
Mohamed Kenouvi