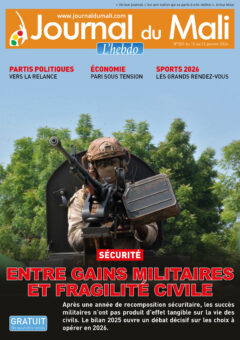Publié ce lundi 1er septembre 2025, un rapport de l’IRENA souligne les impacts concrets de l’électrification solaire des centres de santé. Dans des localités comme Bozola, Niaréla et Bagadadji, des installations photovoltaïques rurales améliorent les soins et la conservation des vaccins.
Dans les quartiers populaires de Bamako — Bozola, Niaréla — ainsi qu’à Bagadadji, des Centres de Santé Communautaires (CSCOM) sont désormais équipés de panneaux solaires, offrant une fourniture électrique permanente. Cette alimentation fiable permet des accouchements nocturnes sécurisés, une conservation optimale des vaccins, et une meilleure continuité des soins.
Ces installations solaires réduisent la dépendance aux groupes électrogènes coûteux et sujets aux pannes. Dans un contexte de coupures électriques fréquentes et de crise financière d’Énergie du Mali, ces solutions garantissent une sécurité énergétique essentielle pour les services de santé de base.
Selon le rapport IRENA publié le 1er septembre 2025, l’électrification solaire transforme le quotidien des centres de santé dans tout le pays. Elle facilite un éclairage permanent pour les soins d’urgence, la conservation des vaccins et le fonctionnement des appareils de diagnostic. Le rapport indique qu’il s’agit de solutions durables, rendues possibles grâce à des partenariats entre communautés locales, techniciens formés et acteurs internationaux.
Ce déploiement s’inscrit dans un mouvement plus vaste : selon les données les plus récentes, le Mali compte déjà plus de 130 000 kits solaires installés dans les foyers, écoles, centres de santé, ainsi que 700 installations d’éclairage hors réseau et 400 mini‑réseaux pour les télécommunications et les hôpitaux. Ces chiffres témoignent d’une stratégie nationale ambitieuse en faveur des énergies renouvelables, en complément des projets solaires à grande échelle — comme la centrale photovoltaïque de Ségou (33 MW) et la centrale de Kita (50 MW), déjà opérationnelle depuis avril 2020.