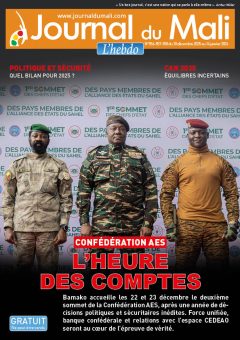À l’instar des Allemands durant la période d’hyperinflation survenue dans la République de Weimar il y a un siècle, les Syriens d’aujourd’hui sortent rarement de chez eux sans une épaisse liasse de billets. Longtemps réprimées dans un pays dirigé jusqu’à récemment par la minorité alaouite, les tensions sectaires continuent d’alimenter l’instabilité, et les distributeurs automatiques de billets plafonnent actuellement les retraits à 40 $ par semaine, lorsqu’ils fonctionnent.
Six mois après l’éviction du président Bachar el-Assad, bouleversement qui a mis fin à 13 années de guerre civile brutale, les Syriens peinent encore à survivre au quotidien. En dépit de difficultés considérables, beaucoup s’agrippent à l’espoir du retour prochain d’une certaine normalité. Chaque semaine apporte malheureusement son lot d’épreuves, qui contrarient cet optimisme. Tout récemment, en utilisant l’espace aérien syrien pour frapper l’Iran, Israël a plongé les Syriens dans un embarras dont ils se seraient bien passés.
Dans une culture au sein de laquelle l’hospitalité est sacrée, la plupart des Syriens ne peuvent plus se permettre de proposer ne serait-ce qu’une tasse de café à leurs invités. Le pays souffre d’une grave sécheresse – pire encore que la sécheresse souvent associée au soulèvement de 2011 – qui menace aujourd’hui 75 % des récoltes de blé, compromettant l’accès au pain, et accentuant l’insécurité alimentaire.
Peu de Syriens souhaitent le retour d’Assad, mais beaucoup sont sceptiques quant à son successeur, Ahmed al-Charaa. Ancien commandant d’Al-Qaïda, Charaa a dirigé pendant plusieurs années la province rurale d’Idlib, au sein de laquelle il appliquait un code islamiste sunnite strict. Bien qu’il ait depuis modéré ses positions, il demeure aussi énigmatique qu’un Bachar el-Assad diplômé en Occident et en apparence calme, qui avait promis des réformes, pour ensuite devenir l’un des pires criminels de guerre depuis la Seconde Guerre mondiale.
À l’instar de son prédécesseur, Charaa gouverne par décret, et fait preuve d’un manque de transparence préoccupant, ce qui conduit de nombreux Syriens à craindre d’avoir remplacé un autocrate par un autre, une dictature laïque par une dictature islamiste. Par ailleurs, les orientations idéologiques et les priorités économiques de Charaa demeurent peu évidentes. Ses détracteurs tournent en dérision son passé chez Al-Qaïda, tandis que ceux qui ont combattu à ses côtés en Irak mettent en doute son attachement au djihad.
Quels que soient les objectifs de Charaa, les divisions sectaires continuent de compromettre toute action gouvernementale significative en Syrie, dans la mesure où les Druzes, dans le sud, et les Alaouites, dans le bastion de longue date d’Assad le long de la côte, refusent d’accepter le nouveau gouvernement. « Ce sont des hypocrites », m’a expliqué le chef spirituel druze Hikmat al-Hijri, décrivant Charaa et ses alliés en employant un terme religieux lourd de sens, désignant ceux qui font obstacle au message du prophète Mahomet. Interrogé sur son soutien ou non à un État fédéral, al-Hijri répond qu’il est opposé au centralisme. En réalité, ce que lui et ses coreligionnaires souhaitent, c’est un gouvernement central faible, incapable d’exercer un contrôle sur leur province reculée.
Les Alaouites sont confrontés à un problème différent. En tant qu’ancienne minorité au pouvoir en Syrie, ils partagent peu de choses avec l’élite sunnite renversée par les États-Unis dans l’Irak voisin. Les sunnites étant prédominants dans le monde arabe et islamique, la minorité sunnite d’Irak s’est considérée en droit de régner sur la majorité chiite du pays, et a réclamé que soit rétabli son statut légitime.
Les Alaouites de Syrie ne peuvent pas cultiver des aspirations similaires, ce qui ne les a toutefois pas empêchés de tenter une insurrection, à l’instar des sunnites d’Irak après l’invasion américaine de 2003. Seulement voilà, la minorité alaouite est non seulement beaucoup moins nombreuse que la minorité sunnite en Irak, mais également historiquement trop fragmentée pour espérer constituer un front uni.
Les récents affrontements entre le gouvernement et ces groupes minoritaires ébranlent la Syrie, ce qui met à mal la confiance de la population dans le nouveau régime. Pour autant, malgré ce conflit sectaire, Charaa bénéficie du soutien de la plupart des sunnites arabes. Si les musulmans pieux l’approuvent, c’est parce que l’effondrement du parti laïque Baas a permis le retour de la religion dans la vie publique. D’autres lui attribuent le crédit d’une baisse des prix, bien qu’il reste à prouver que Charaa puisse exercer sur les marchés autant d’influence qu’un Donald Trump, par exemple.
L’antiaméricanisme et l’hostilité féroce vis-à-vis d’Israël constituaient les piliers du credo baasiste de la dynastie Assad. Bachar et son père avaient adopté ce dogme pour détourner l’attention de leurs échecs nationaux et de leur régime minoritaire. Sous les Assad, la Syrie aurait été la première à dénoncer les frappes israéliennes contre l’Iran, ainsi qu’à proposer son soutien – verbal et matériel – à tout protagoniste désireux d’en découdre avec les Israéliens. Par opposition, les Syriens sont aujourd’hui devenus insulaires, plus préoccupés par la guérison nationale que par les événements régionaux. De nombreux Syriens sont heureux d’entretenir désormais des relations de voisinage normales, alors même qu’Israël empiète de plus en plus sur leur territoire depuis la chute d’Assad.
Dans une société en proie aux pénuries, la seule chose dont les Syriens ne manquent pas est l’espoir – un bien gratuit qui, contrairement à la plupart des autres, n’est ni coûteux ni soumis à des sanctions internationales. « Sans espoir, nous ne pourrions pas vivre », m’a confié un Syrien qui se demandait s’il allait dépenser ses maigres économies dans l’achat de nouvelles chaussures de sport pour ses enfants ou dans la réparation de l’installation électrique défectueuse de son appartement.
Les Syriens sont confrontés à une multitude de choix de ce type. Ce qui leur manque, ce sont les coups de chance soudains, tels que la décision inattendue de Trump d’assouplir les sanctions américaines contre leur pays, une démarche qui conduit de nombreux Syriens à espérer d’autres surprises positives. « C’est Allah qui a planté la graine de la Syrie dans le cœur de Trump », m’a soufflé un Syrien confiant, qui tenait dans ses mains calleuses un sac de tomates à la limite du pourrissement, achetées au rabais.
D’après l’envoyé spécial américain pour la Syrie, Tom Barrack, la décision de l’administration Trump de lever certaines sanctions visait à « inonder la zone d’espoir ». Ce que les Syriens espèrent, c’est que les Américains inonderont leur pays de capitaux et d’investissements, leur évitant ainsi d’avoir à choisir entre besoins existentiels et confort de base, et leur permettant à tout le moins d’acheter des fruits encore pleins de vie.
Barak Barfi a été chercheur chez New America, et chercheur invité à la Brookings Institution.
Project Syndicate, 2025.
www.project-syndicate.org