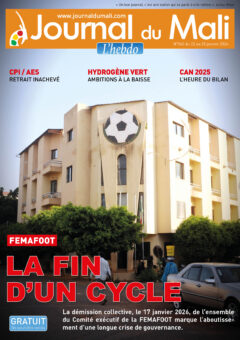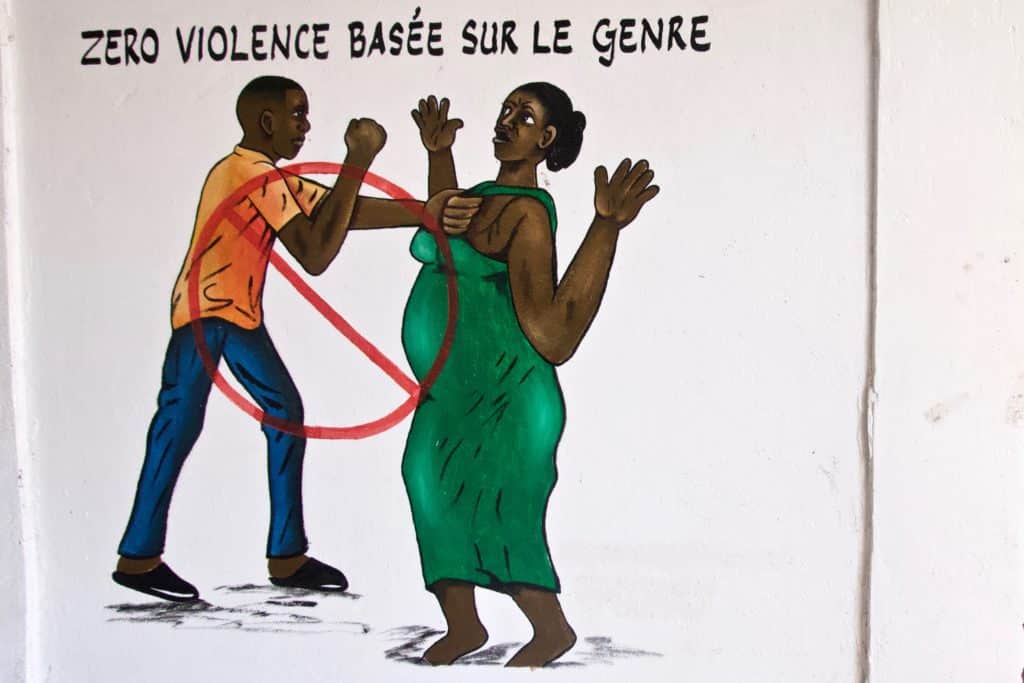Dans son rapport trimestriel publié le 2 septembre, l’UNFPA à travers le mécanisme GBVIMS rend compte de la situation des violences basées sur le genre pour la période d’avril à juin 2025. L’étude indique une baisse par rapport au trimestre précédent mais souligne des chiffres qui demeurent préoccupants.
Au total, 901 cas de violences basées sur le genre ont été documentés contre 1 237 au premier trimestre, soit une diminution de 27 %. Les femmes constituent 97 % des survivantes, dont 77 % sont des adultes et 20 % des filles mineures. Les violences physiques et psychologiques représentent plus de la moitié des cas, suivies des violences sexuelles qui comptent pour 20 %, dont 8 % de viols et 12 % d’agressions sexuelles. Les mariages forcés représentent également une part importante, dont 60 % sont des mariages précoces.
Le rapport note que 63 % des viols concernent des filles de moins de 18 ans, confirmant la forte exposition des adolescentes aux violences sexuelles. Les femmes adultes âgées de 18 à 59 ans comptabilisent 2 186 cas de violations toutes catégories confondues, soit deux fois plus que les hommes, tandis que les adolescentes représentent 583 cas. Les personnes déplacées internes constituent 8 % des survivantes et 2 % sont des réfugiées, des chiffres probablement sous-estimés en raison du faible signalement.
Concernant les auteurs, 87 % sont des hommes et plus de la moitié sont des partenaires intimes ou d’anciens conjoints. Les porteurs d’armes, qu’il s’agisse de groupes armés non étatiques ou d’individus armés non identifiés, sont responsables de 95 % des violations signalées et 6 % des cas de viols leur sont attribués.
Le rapport insiste aussi sur les limites dans la prise en charge. 22 % des survivantes qui avaient besoin de soins médicaux n’y ont pas eu accès. L’absence est encore plus marquée pour l’assistance sécuritaire, non fournie dans 76 % des cas et pour le soutien juridique, inaccessible dans 80 % des cas. Enfin, 69 % des survivantes nécessitant une aide pour la réinsertion socio-économique n’ont pas reçu d’appui. Dans certaines régions comme Tombouctou et Diré, les centres de prise en charge spécialisés sont restés fermés tout au long du trimestre faute de financement.
Ces données confirment que les violences basées sur le genre demeurent une réalité alarmante, malgré une baisse apparente des cas signalés. L’UNFPA rappelle que l’accès à des services de qualité reste essentiel pour accompagner les survivantes et répondre à une situation qui continue de fragiliser des milliers de femmes et de filles.
Massiré Diop