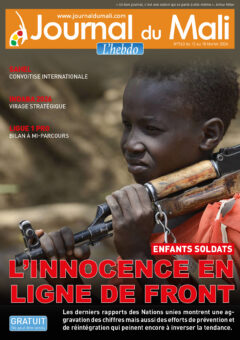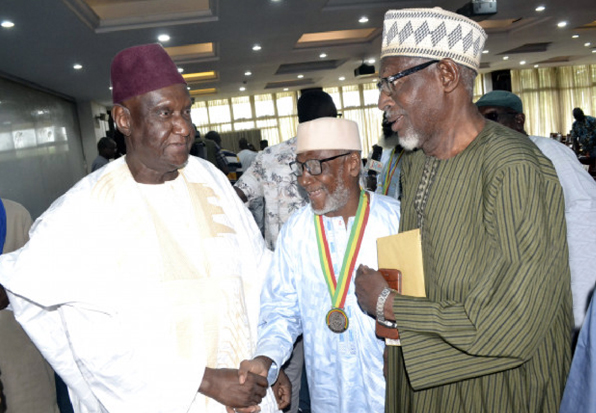Dans cet entretien, l’analyste politique Moustapha Siby livre son regard sur la révision de la Charte de la Transition et la crise sécuritaire persistante. Propos recueillis par Massiré Diop
Pourquoi jugez-vous que la nouvelle loi autorisant les membres de la Transition à se présenter est une rupture avec « le moindre bon sens » ?
Une période de transition repose sur un principe cardinal : celui de la neutralité institutionnelle. Elle constitue une étape exceptionnelle, destinée à restaurer l’ordre constitutionnel et à garantir l’organisation d’élections libres, transparentes et inclusives. Dès lors, l’adoption d’une loi autorisant les membres de la Transition à se porter candidats aux scrutins à venir constitue une entorse grave à l’éthique démocratique. Une telle disposition crée en effet un conflit d’intérêts manifeste. Les autorités de la Transition, en position de contrôle des leviers de l’État, disposent d’un pouvoir disproportionné leur permettant d’orienter le processus électoral à leur avantage – que ce soit à travers l’accès privilégié aux médias publics, l’usage détourné des ressources administratives ou la manipulation potentielle des règles électorales.
Pensez-vous qu’une solution durable à la crise sécuritaire peut exister sans passer par le dialogue avec certains groupes armés ?
Il serait illusoire de croire qu’une solution durable à la crise sécuritaire peut être trouvée en excluant systématiquement le dialogue avec certains groupes armés, qui sont en majorité nos compatriotes, dans un conflit d’une complexité asymétrique rarement égalée. L’histoire mondiale montre que ces conflits ne sont jamais gagnés uniquement par la force militaire, même par les armées les plus puissantes. Souvent, ces groupes s’enracinent dans des revendications locales, un sentiment d’abandon ou des fractures communautaires non résolues, recrutant au sein de populations marginalisées victimes d’injustices socio-économiques. Le dialogue peut alors permettre de désamorcer les tensions, d’instaurer des cessez-le-feu locaux et de favoriser la réintégration progressive dans le tissu social.
Quelle responsabilité les élites communautaires peules devraient-elles concrètement assumer face au discours djihadiste ?
Les élites communautaires peules occupent une position centrale dans la lutte contre le discours djihadiste. Elles ont la responsabilité d’être à la fois des relais de prévention et des agents de cohésion sociale. Elles doivent, en des termes sans équivoque, condamner fermement les idéologies extrémistes qui menacent la paix et la stabilité de leurs – nos – communautés. Leur parole, écoutée et respectée localement, peut contribuer à affaiblir la propagande djihadiste et à promouvoir des valeurs de tolérance, de dialogue et de vivre-ensemble.
À vos yeux, quel serait le seuil minimal de progrès économique permettant de légitimer la prolongation du pouvoir actuel ?
À mes yeux, aucun progrès économique, aussi significatif soit-il, ne peut justifier la prolongation d’un pouvoir qui suspend les partis politiques, interdit tout débat contradictoire et emprisonne des citoyens pour leurs opinions. La légitimité d’un pouvoir repose d’abord sur le respect des libertés fondamentales et le rétablissement d’un cadre démocratique. Il ne s’agit pas seulement d’améliorer les indicateurs économiques, mais aussi de garantir l’expression libre des citoyens, la pluralité politique et la transparence des institutions.