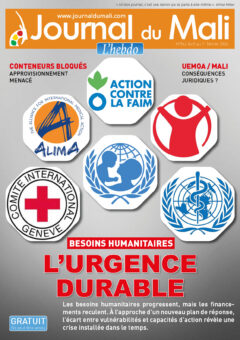La prolongation du mandat du Président de la Transition à cinq ans renouvelables marque un tournant institutionnel inédit depuis 2020. Entre justifications sécuritaires, incertitudes électorales et critiques sur la gouvernance, la question de la permanence du provisoire s’impose au cœur du débat politique national.
Le 11 juin 2025, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi révisant la Charte de la Transition. Il ouvre la voie à un mandat de cinq ans renouvelable pour le chef de l’État, le Général Assimi Goïta. Cette décision, qui devrait encore être entérinée par le Conseil national de transition (CNT), modifie de manière substantielle le cadre temporaire en vigueur depuis septembre 2020. Rappelons que le Conseil national de transition (CNT), mis en place par ordonnance en décembre 2020, fait toujours office d’organe législatif intérimaire. Il regroupe 147 membres désignés par le Président de la Transition, représentant les forces de défense, la société civile, les syndicats et les partis politiques d’alors. Il détient le pouvoir de valider les projets de loi et de contrôler l’action du gouvernement.
Ainsi, la Charte initiale, adoptée en octobre 2020, avait fixé une durée de transition de 18 mois. Une première prolongation en février 2022 l’étendra à 24 mois, jusqu’en février 2024. La nouvelle révision de juin 2025 prolongerait cette durée à cinq ans, avec possibilité de renouvellement. Cette orientation s’inscrit dans un contexte où les consultations nationales et les difficultés sécuritaires ont fortement influencé les choix de gouvernance.
L’élément déclencheur de la suspension du processus électoral remonte à septembre 2023. La présidentielle, prévue pour février 2024, est reportée en raison du blocage des données biométriques par la société française IDEMIA, qui réclame environ 5 milliards de francs CFA. Le fichier est finalement récupéré en février 2024 par des informaticiens maliens, sans que les contours de cette affaire ne soient entièrement connus. Malgré la récupération de ces données, aucune date de scrutin n’est annoncée. Cette absence de calendrier n’est pas sans rappeler la crise de 2022, lorsque la CEDEAO avait imposé de lourdes sanctions au Mali après l’annonce d’une transition prolongée à 5 ans d’après certaines sources. À l’époque, la levée des sanctions avait été conditionnée à la remise d’un chronogramme électoral crédible, ce qui fut obtenu à la suite de négociations en juillet 2022.
Pourtant, les promesses initiales de renforcement de la décentralisation formulées en 2021 pour permettre l’organisation de ces élections dans de bonnes conditions sont restées sans traduction concrète dans les politiques territoriales.
Engagements électoraux non tenus
Pourtant, dans sa lettre de cadrage de novembre 2024, le Premier ministre Abdoulaye Maïga, également ministre de l’Administration territoriale, avait placé l’organisation des élections parmi ses priorités. Une enveloppe de 80 milliards de francs CFA figure même dans le projet de Loi de finances 2025, mais sans détails ni chronogramme précis, alimentant les incertitudes sur la volonté effective de tenir des scrutins.
Entre-temps, plusieurs signaux institutionnels se sont superposés. On se souvient que le 31 décembre 2024, dans son discours à la Nation, le Président de la Transition n’avait fait aucune référence au processus électoral. En avril 2024, les activités des partis politiques avaient été suspendues, puis une dissolution générale décidée par décret le 13 mai 2025. Ces mesures sont justifiées par le gouvernement comme nécessaires à la refondation du système politique. Le 3 mai 2025, plusieurs centaines de citoyens ont manifesté à Bamako contre la dissolution des partis politiques et l’absence de perspectives électorales. Il s’agit de la première mobilisation d’ampleur enregistrée dans la capitale depuis la suspension des activités politiques en avril 2024. Les organisateurs dénonçaient une « confiscation du débat public » et appelaient à la restauration des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’organisation d’élections pour sortir de la Transition.
Les consultations nationales menées à Bamako du 20 au 29 avril 2025, dites « Rencontres des forces vives », avaient recommandé explicitement la prolongation de la Transition pour cinq ans renouvelables, en harmonie avec le Burkina Faso et le Niger. Ces pays, membres avec le Mali de la Confédération des États du Sahel (AES), ont également fixé leurs transitions à cinq ans (Niger, mars 2025 ; Burkina Faso, mai 2024). Rappelons aussi que le 29 janvier 2024, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont officialisé leur retrait de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Cette décision, assortie d’un délai d’un an selon les traités, a été justifiée par les autorités comme une affirmation de leur « souveraineté stratégique ». Elle renforce le positionnement des trois États autour de la Confédération des États du Sahel (AES), mise en place en juillet 2024, où prévaut un modèle de transition militaire prolongée.
En privé, certains partenaires étrangers avaient déjà exprimé leurs doutes quant à la faisabilité d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel avec cette nouvelle organisation regroupant les trois pays.
Coopérations internationales suspendues
Ce positionnement trouve également un ancrage antérieur dans les Assises nationales de la refondation, tenues en décembre 2021, où certaines recommandations évoquaient déjà une transition longue, pouvant aller jusqu’à cinq ans. L’argument sécuritaire est central dans les justifications avancées par les autorités. Les données disponibles indiquent une persistance de l’insécurité dans le centre et le nord du pays, avec plusieurs incidents meurtriers recensés au premier semestre 2025. On se rappelle que le 7 février 2025, une embuscade dans la région de Gao, attribuée à des éléments de l’État islamique en Afrique de l’Ouest, a causé la mort de 34 civils et blessé 20 militaires maliens. Quelques mois plus tôt, le 17 septembre 2024, une attaque simultanée contre des installations sécuritaires à Bamako avait fait des dizaines de morts. De plus, selon le Global Terrorism Index 2025, le Sahel concentre plus de 50% des décès liés au terrorisme dans le monde, avec 4 800 morts enregistrées en 2024. Le Mali à lui seul a comptabilisé environ 1 532 décès liés à des violences armées cette même année, notamment dans les régions du centre et du nord.
Sur le plan juridique, la Constitution adoptée par référendum le 23 juillet 2023 prévoit, dans son article 45, que le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. Le prolongement actuel, décidé sans élection, repose donc sur un cadre transitoire qui s’écarte du droit constitutionnel en vigueur.
Sonnette d’alarme
Par ailleurs, plusieurs personnalités politiques ont exprimé publiquement leurs inquiétudes. Le 15 juin 2025, Mountaga Tall a alerté sur les risques d’une confiscation du pouvoir et a proposé douze mesures pour restaurer la confiance, dont la fixation d’une date de fin de transition et la réhabilitation des partis. Le 16 juin, Yaya Sangaré a dénoncé une « violation répétée » des textes, avant d’appeler à une mobilisation citoyenne. Oumar Ibrahim Touré avait rappelé que le Mali était le seul pays de l’AES à disposer d’une Constitution en vigueur, insistant sur la responsabilité à respecter l’État de droit. Le politologue Cheick Oumar Doumbia avait lui aussi tiré la sonnette d’alarme sur les risques de démocratie sous pression liés à une gouvernance trop fortement militarisée.
L’histoire politique récente du Mali est marquée par deux précédentes transitions. En 1991, le régime militaire issu de la chute de Moussa Traoré a organisé en un an une Conférence nationale souveraine, suivie d’élections pluralistes en 1992. En 2012, après un coup d’État intervenu en pleine crise sécuritaire au Nord, une transition de moins de 15 mois a permis d’organiser des élections sous supervision internationale. Ces précédents tranchent avec la transition actuelle, dont la durée cumulée et l’évolution institutionnelle sont sans précédent.
Dans l’attente d’une validation du texte par le CNT, aucun calendrier électoral n’est actuellement publié. Le cadre transitoire demeure en vigueur, sans perspective claire de sortie. La consolidation institutionnelle du Mali s’inscrit ainsi dans une temporalité prolongée qui pose la question de la permanence du provisoire.