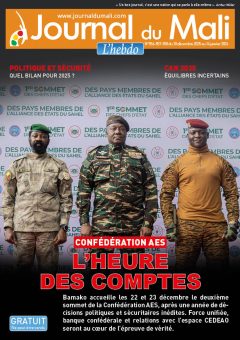Le fleuve Niger, principale source d’eau potable de Bamako, est menacé par les rejets massifs d’eaux usées, les déchets plastiques et les activités de dragage. Cette pollution croissante fragilise la santé publique et ruine la pêche et l’agriculture, au-delà de la problématique de gestion collective d’une ressource vitale qui irrigue tout le bassin ouest-africain.
Environ 611 548 m³ d’eaux usées, soit plus de 600 millions de litres, sont déversés chaque jour dans le fleuve à Bamako, selon une étude du projet Cart’Eau. À ces rejets s’ajoutent l’invasion des sachets plastiques et les activités de dragage, en violation du Code minier, qui menacent la faune aquatique et la santé des populations.
Long de 1 700 kilomètres au Mali, le fleuve traverse la capitale mais perd sa vitalité. Sa couleur jaunâtre témoigne de la contamination causée par le déversement anarchique de déchets domestiques et industriels. Sur les berges, les plastiques s’accumulent et des tonnes de détritus s’entassent dans ses fonds, augmentant le risque de débordement pendant l’hivernage. La fermeture du site de Noumoubougou, seul espace d’enfouissement final des ordures, aggrave encore la situation.
L’absence de station de traitement des boues de vidange contribue au problème. Les eaux usées sont déversées à ciel ouvert avant de rejoindre le Niger par ruissellement. La ville compte 94 collecteurs d’eau, dont plus de la moitié se jettent directement dans le fleuve. Conçus pour évacuer les pluies, ils servent désormais d’égouts et de dépotoirs, provoquant une raréfaction des poissons et menaçant le revenu de centaines de pêcheurs.
Les conséquences sanitaires sont lourdes. Une étude de 2023 souligne que l’eau non traitée favorise choléra, bilharziose, typhoïde et diarrhées, tandis que le paludisme est aggravé par la stagnation des eaux polluées. Le fleuve, censé être une source de vie, devient un vecteur de maladies.
Sur le plan économique, la riziculture irriguée et le maraîchage autour de Bamako sont affectés par la baisse de qualité de l’eau. La pêche décline, privant des familles de leur revenu principal, tandis que le traitement de l’eau potable devient plus coûteux.
Ressource transfrontalière, le Niger traverse six pays. Sa dégradation à Bamako a des répercussions en aval. L’Autorité du Bassin du Niger (ABN), basée à Niamey, appelle régulièrement à une gestion concertée, mais ses recommandations peinent à s’imposer.
Adopté en août 2023, le nouveau Code minier interdit le dragage aurifère, mais son application reste difficile. L’Agence du Bassin du Fleuve Niger (ABFN), qui sensibilise et alerte, n’a aucun pouvoir de sanction. Son Directeur général adjoint, Moussa Diamoye, plaide pour une taxe « pollueur-payeur » et un plan d’aménagement des berges, rappelant que malgré son interdiction le dragage continue de menacer la ressource.
Joseph Amara Dembélé