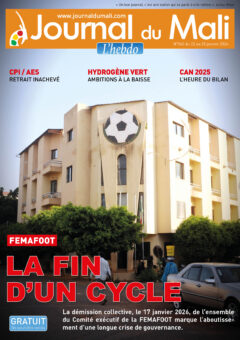Le 28 février 2024, dans le cadre du renouvellement des instances du Bureau de coordination de l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM), de violents affrontements opposent des camps rivaux. Un étudiant trouve la mort et de nombreux autres sont blessés. Une énième scène de violence dans l’espace scolaire qui aboutit à la suspension des activités de l’organisation, puis à sa dissolution le 13 mars 2024 par les autorités. Salutaire pour les uns, liberticide pour les autres, la décision doit permettre une réinvention du mouvement scolaire, qui s’est détourné de ses objectifs depuis trop longtemps.
« Après la suspension, je m’attendais plutôt à des réformes au sein de l’association, qui a beaucoup contribué à l’avènement de la démocratie au Mali. Elle fait partie des acquis », regrette Moussa Niangaly, Secrétaire général de l’AEEM de 2018 à 2021. Sans nier les actes de violence qui caractérisent « actuellement » l’association, il estime que les réformes effectuées par le passé ont « contribué à diminuer le phénomène ». Il fallait donc continuer dans ce sens. D’ailleurs, plusieurs anciens de l’AEEM avaient salué la suspension, espérant que cela serait « l’occasion de penser un cadre de réflexion », poursuit-il. Un espace pour réorganiser l’association et éviter les violences en milieu scolaire. Au-delà de la « surprise » qu’elle a créée, selon M. Niangaly, « la dissolution n’est pas la solution », car elle pourrait permettre, comme par le passé, à l’organisation de renaître. C’est après la dissolution de l’Union nationale des élèves et étudiants du Mali (UNEEM) que l’AEEM est née. Il vaut mieux donc « réparer et réorganiser ce que nous avons » et assurer un suivi afin d’éviter toute dérive.
Dépolitiser l’école
C’est la question cruciale qui préoccupe à présent les acteurs de l’école. Comment remettre dans son rôle une organisation de défense des intérêts des élèves et étudiants qui, depuis sa création, a été associée à la gestion du pouvoir, jusqu’au plus haut niveau ? Un instrument politique et « un électorat » ménagé par les pouvoirs successifs, car « personne n’avait intérêt à avoir une école bouillante », nous confiait un analyste en 2020.
À cette gestion du pouvoir s’est ajoutée la gestion des œuvres universitaires lors de la création de l’université en 1993 et en l’absence du Centre national des œuvres universitaires (CENOU), qui ne verra le jour qu’en 1996. Après la création de cette structure, des conventions instituant une collaboration entre cet établissement public et l’AEEM ont été instaurées. Jusqu’en 2020, où le 12 octobre un autre incident, toujours dans le contexte du renouvellement des instances de l’organisation, a causé la mort d’un étudiant et fait de nombreux blessés. Une mort de trop, qui a indigné le monde scolaire et les parents d’élèves, singulièrement les femmes, qui ont alors interpellé fortement les autorités.
Dans une déclaration signée le 20 novembre 2020 et remise aux autorités, les femmes du Mali, réunies au sein d’un Collectif, ont d’abord demandé la « suspension immédiate de l’AEEM » et la fin de toutes les conventions et engagements qui liaient l’État à l’association. Avant de souhaiter la mise en place d’une Commission de suivi pour la mise en œuvre de ces mesures. À l’issue d’une journée de concertations organisée par le Premier ministre de l’époque, des recommandations ont été formulées et un début de mise en œuvre s’est concrétisé avec l’assèchement des sources de financement de l’AEEM.
Mais le renouvellement des instances a continué d’être le théâtre de scènes de violences et « d’affrontements toujours soldés par des morts d’hommes », regrette Mme Gakou Salamata Fofana, membre du Collectif. Les différentes commissions ont donc été déployées pour accompagner les processus de renouvellement. Malgré le climat délétère et le danger auquel ils étaient exposés, les membres ont, avec l’appui des forces de l’ordre dans bien des cas, suivi les renouvellements, qui se sont bien déroulés. Elle se réjouit donc, « en tant que mère de famille de cette dissolution, car « les enfants ne sont pas envoyés à l’école pour se faire tuer ».
Comment réorganiser l’AEEM ?
« Pour le moment, il faut faire table rase » et trouver une solution à la violence et aux étudiants qui refusent de quitter l’université pour ne pas quitter leurs postes au Bureau de l’AEEM, estime Mme Gakou. Une attitude qui ne doit rien au hasard, puisque l’AEEM est une source de pouvoir « économique et politique » dont les responsables ont appris à jouir « sans jamais avoir travaillé », déplore Elhadj Seydou Patrice Dembélé, Secrétaire général de l’Amicale des Anciens et sympathisants de l’UNEEM (AMSUNEEM).
Pourtant, les sources de financement de l’organisation avaient été coupées suite aux concertations de 2021. Malheureusement cela n’a pas arrêté la violence, relève l’ancien Secrétaire général. « Il faut sécuriser le milieu universitaire », suggère-t-il, et c’est l’État qui doit y veiller. « Souvent, les violences n’émanent même pas des militants de l’AEEM. Certains ont fini leur formation universitaire mais sont encore sur la colline », ajoute-t-il.
Mais « sans moyens », comment les étudiants se procurent-ils toutes ces armes ? Une question qui mérité d’être posée et à laquelle il y a désormais un début de réponse. « Pour avoir de l’argent, ils vont voir les écoles privées et font du chantage ». Ils ont ainsi « eu des sous sans l’État, qui est resté silencieux », note M. Dembélé.
Ayant déjà soutenu la suspension, l’AMSUNEEM s’est prononcée majoritairement en faveur de la dissolution. Parce que l’espace universitaire ne doit pas être « criminogène ». L’État doit « continuer à nettoyer les écuries dans l’espace universitaire », préconise le Secrétaire général de l’AMSUNEEM. Il faut que les acteurs du 26 mars acceptent de se remettre en cause. « Tout n’a pas été mauvais, mais ayons le courage de faire notre mea culpa ». L’État doit mettre à profit ce temps pour restructurer l’AEEM et si une autre association doit voir le jour elle sera mise en place sous les regards vigilants de l’État, des partenaires de l’école et des étudiants.
Au-delà de la dissolution
Pour Mahamane Mariko, ancien membre de l’AEEM (1998 – 2000), la dissolution de l’organisation, qui s’était éloignée de ses objectifs, n’est pas une surprise. Elle s’était retrouvée dans une situation qui « n’honore point l’espace scolaire ». Mais il faut « pousser les investigations » et aller au-delà des « acteurs apparents » qu’étaient devenus les élèves et étudiants. Il faut chercher à « savoir qui manipulait les enfants » afin que l’espace scolaire et universitaire soit troublé. Il s’agit pour lui d’une question de justice, afin de donner le temps à la jeunesse de trouver la meilleure voie ».
Pour réformer l’association estudiantine, le Dr Almamy Ismaïla Koïta, ancien Secrétaire général de la Faculté de médecine (201 – 2013), propose de s’inspirer de la « spécificité » des comités de cette école, considérés comme des modèles. Il faut une nouvelle entité qui sera financée par les élèves et dont les organes seront élus sous l’égide d’autorités reconnues pour ce faire. Mais tout cela dépendra des étudiants, qui doivent prendre leur responsabilité, soutient-il.
Guère surpris par la dissolution, vu la tendance adoptée par l’association, Seydou Cissé, enseignant du Supérieur, préconise que la future organisation tire les leçons du passé et soit dirigée à l’issue d’une sélection rigoureuse et d’un choix démocratique pour éviter les dérives « qui ont fait plonger l’AEEM ».
Farouchement opposés à la dissolution de l’AEEM, les anciens de l’organisation « rejettent cette annonce et accompagneront les cadets pour faire annuler sans violence cette décision des autorités de la Transition », annonce Ibrahima Taméga, leur porte-parole.
Pour Amadou Koïta, ancien ministre et ancien membre de l’AEEM, « rien ne justifie cette dissolution ». Et il se demande si « certains ne veulent pas réécrire l’histoire du 26 mars ».
Création de l’AEEM : 1990
Suspension des activités de l’AEEM : 29 février 2024
Dissolution de l’AEEM : 13 mars 2024