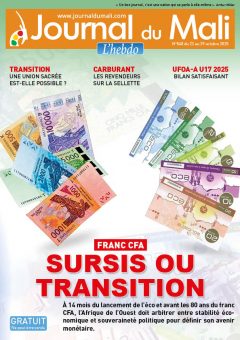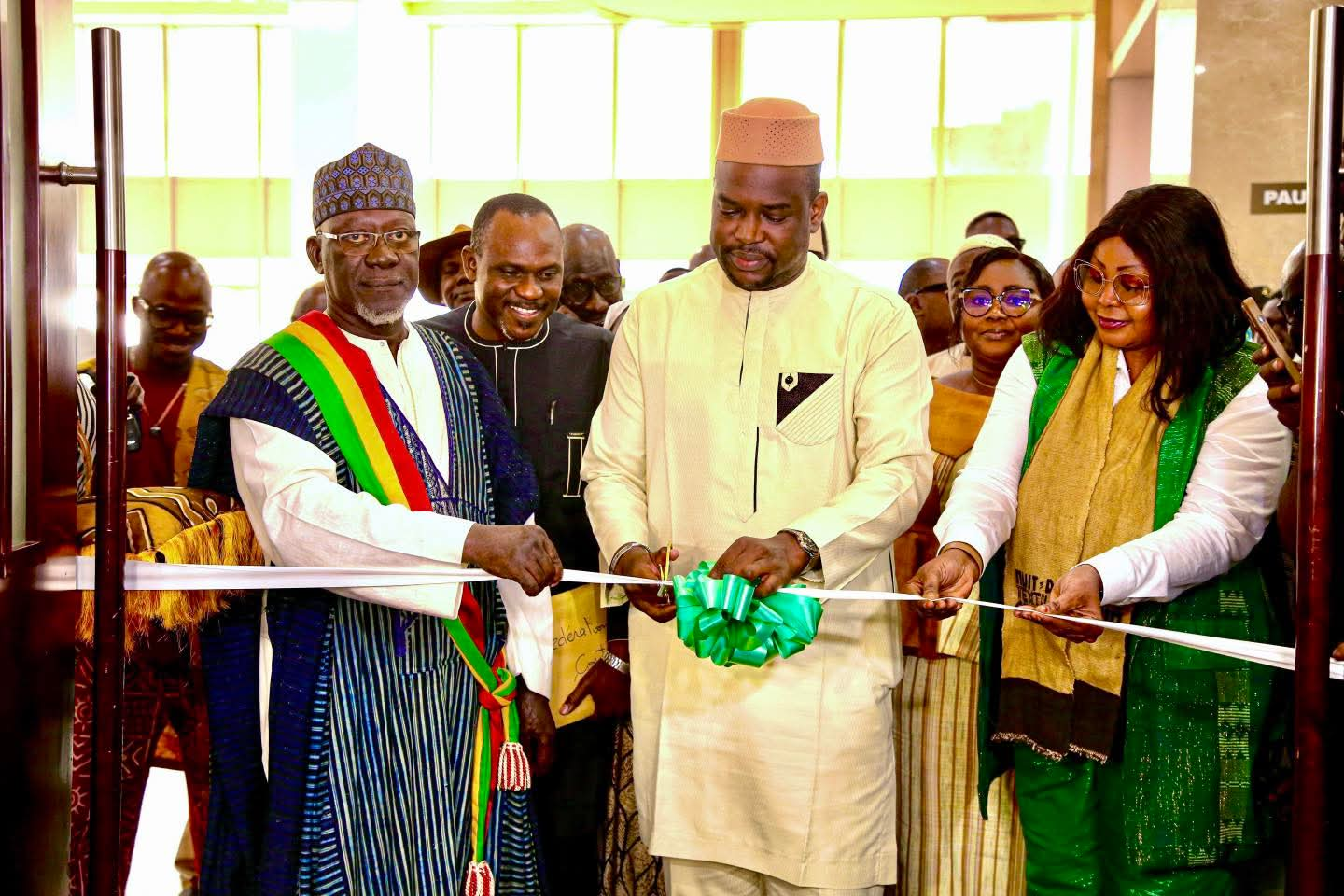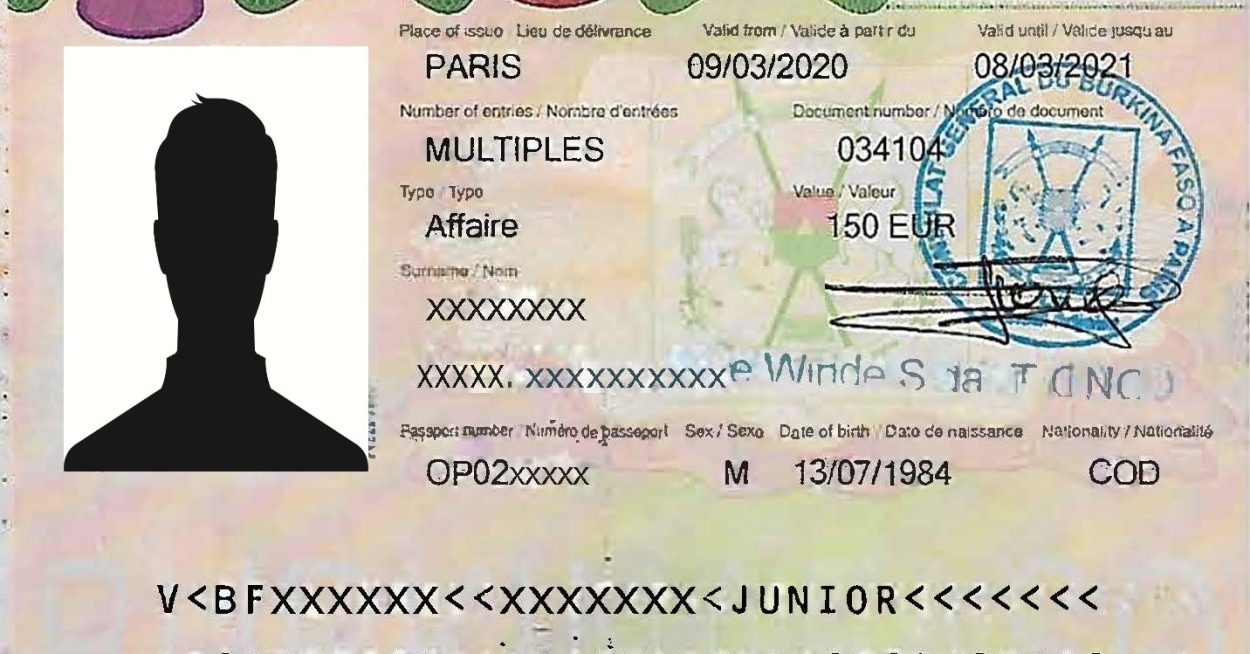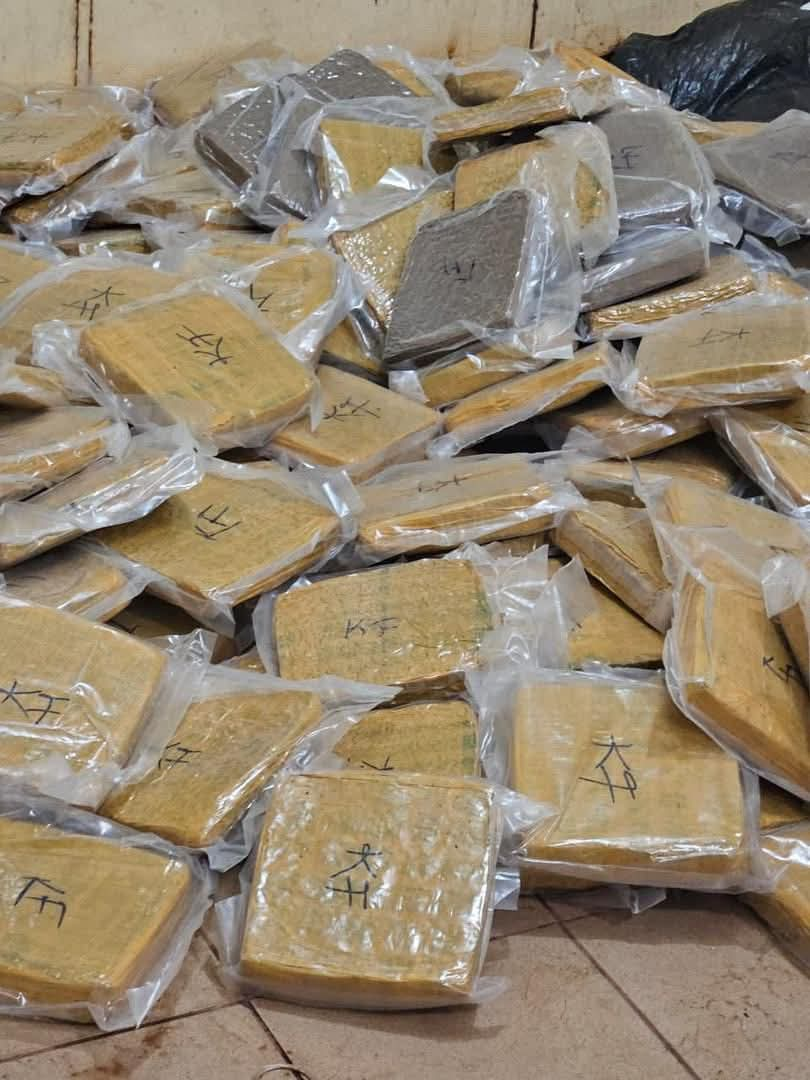Soixante-cinq ans après l’éclatement de la Fédération du Mali et l’indépendance de la République du Mali, l’histoire semble offrir une seconde chance aux pays du Sahel central. Le rêve fédéral de Modibo Keita, brisé par les rivalités politiques et l’absence de compromis, trouve aujourd’hui un écho dans la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES), qui, au-delà des impératifs sécuritaires, incarne une quête renouvelée d’unité et de souveraineté.
Dès l’aube des indépendances, le Mali, alors Soudan français, a cherché à dépasser les frontières héritées de la colonisation. En janvier 1959, la Fédération du Mali a vu le jour, regroupant le Soudan français et le Sénégal, avec l’ambition d’incarner une Afrique unie, forte et souveraine.
Portée par deux figures charismatiques, le Malien Modibo Keita et le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, cette fédération représentait un véritable élan panafricain. Le projet impliquait initialement la Haute-Volta (actuel Burkina Faso) et le Dahomey (actuel Bénin), avant leur retrait. La Fédération fut rapidement reconnue par la France et par les Nations unies, ce qui constituait une première tentative concrète d’intégration politique en Afrique de l’Ouest francophone.
En juin 1960, elle proclama son indépendance fédérale, mais ses fragilités apparurent vite. Le 20 août 1960, à peine deux mois plus tard, le Sénégal se retira brusquement, entraînant l’éclatement de l’union et laissant le Soudan français poursuivre seul sa marche sous le nom de République du Mali.
Les causes profondes de l’échec de 1960
Très vite, des divergences politiques et idéologiques se sont manifestées. Senghor défendait une coopération étroite avec l’ancienne puissance coloniale et un modèle libéral, tandis que Keita privilégiait une orientation plus radicale, fondée sur la souveraineté économique et une planification socialiste.
Ces différences s’accompagnaient de disparités économiques et sociales, que les leaders utilisaient davantage pour diviser que pour unir. Les clivages linguistiques, les écarts de développement entre les régions et les rivalités institutionnelles fragilisaient la cohésion fédérale. La précipitation institutionnelle a aussi joué un rôle fatal, dans la mesure où la fédération a été proclamée sans que ses structures aient eu le temps de se consolider.
Cet échec reste une marque profonde dans l’histoire politique africaine, en rappelant qu’aucun projet fédéral ne peut prospérer sans compromis durables entre dirigeants nationaux.
L’émergence de la Confédération AES
Six décennies plus tard, l’idée fédéraliste refait surface, dans un contexte radicalement différent. En effet, le 16 septembre 2023, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé la Charte du Liptako Gourma, instituant l’Alliance des États du Sahel (AES), un pacte de défense mutuelle. Le 6 juillet 2024, les trois pays ont franchi une étape supplémentaire avec le traité instituant la Confédération des États du Sahel, en vue d’évoluer vers une fédération.
Contrairement au projet panafricain de 1959, l’AES naît d’une nécessité stratégique puisque, face à l’insécurité chronique, aux pressions économiques et aux sanctions internationales, les trois États ont choisi de mutualiser leurs efforts. En 2025, ils ont annoncé la création d’une force unifiée de 5 000 hommes, dotée de moyens terrestres, aériens et de renseignement, pour incarner cette intégration sécuritaire.
Parallèlement, les discussions portent sur une monnaie commune, la libre circulation et l’interconnexion énergétique, ce qui traduit une volonté d’aller au-delà du tout militaire. À ces initiatives s’ajoute l’annonce de la mise en place d’une Banque Confédérale pour l’Investissement et le Développement (BCID-AES). Ces projets, encore à l’état embryonnaire, visent à donner à la Confédération une dimension économique et sociale durable.
Les principes de la Confédération
Le traité fondateur de l’AES fixe, à travers ses articles 3 et 4, les principes et compétences partagées. L’article 3 insiste sur la souveraineté, l’intégrité territoriale, la solidarité confédérale et la défense des intérêts des populations. L’article 4 précise que chaque État conserve son indépendance, sauf dans les domaines délégués à la Confédération, tels que la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement. Un protocole additionnel prévoit d’élargir ces compétences si nécessaire, afin d’éviter les erreurs de précipitation institutionnelle du passé.
Similitudes et différences
Si l’on compare la Fédération du Mali et la Confédération AES, des similitudes apparaissent, mais les différences sont tout aussi instructives. Dans les deux cas, il s’agit de dépasser les frontières coloniales afin de renforcer la solidarité et la capacité d’action collective.
Cependant, alors que la Fédération reposait sur l’enthousiasme idéologique des indépendances, l’AES procède d’un calcul pragmatique face à l’urgence sécuritaire et à l’isolement diplomatique. La première avait été fragilisée par le face-à-face entre deux dirigeants aux visions opposées, tandis que la seconde réunit trois régimes de transition animés par des orientations convergentes et un rejet commun des pressions extérieures. Enfin, là où la Fédération avait voulu aller trop vite en proclamant un État sans institutions solides, l’AES adopte une démarche progressive, en commençant par une confédération pour envisager ensuite une fédération.
Le poids du contexte diplomatique
L’AES s’inscrit aussi dans un contexte géopolitique marqué par le retrait des trois pays de la CEDEAO et du G5 Sahel, au profit d’un cadre inédit de coopération. Isolés par les sanctions, Bamako, Ouagadougou et Niamey ont resserré leurs liens, notamment avec Conakry, qui soutient leur démarche souverainiste. Cette réorientation diplomatique, accompagnée d’un rapprochement avec de nouveaux partenaires comme la Russie, la Turquie et la Chine, illustre l’ambition de bâtir une alternative régionale face aux pressions extérieures.
Les conditions d’une réussite durable
La consolidation de l’AES pourrait, à terme, passer par une évolution vers une véritable fédération. Plusieurs éléments créent aujourd’hui un terrain propice. La convergence politique des régimes de transition à Bamako, Ouagadougou et Niamey limite le risque de divergences idéologiques. L’existence d’un ennemi commun, le terrorisme, contribue à renforcer la cohésion stratégique entre les trois États. S’y ajoute un appui populaire confirmé par des enquêtes comme Afrobarometer, qui révèlent qu’une majorité de Maliens soutient l’AES et approuvent la sortie de leur pays de la CEDEAO.
Mais des défis, demeurent dont la faiblesse structurelle des économies, la dépendance extérieure, la difficulté d’abandonner une partie des souverainetés nationales, les pressions internationales et la nécessité de bâtir des institutions stables et inclusives.
Selon Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur et Vice-doyen de la Faculté des Sciences administratives et politiques de l’Université Kurukanfuga de Bamako, « le passage à la fédération implique nécessairement la perte de la souveraineté des États unitaires pour son éclosion ». « En même temps, cela réduit la menace de retrait d’un État membre de l’Alliance, puisque le retrait de tout État fédéré nécessiterait dès lors un référendum dans l’État concerné », ajoute-t-il.
Il estime toutefois que la construction d’une fédération rencontrerait « des réticences et résistances de certains acteurs politiques et des entrepreneurs de la violence armée ». Ces résistances ne se limiteraient pas aux groupes armés, mais concerneraient aussi des acteurs politiques et économiques qui tirent profit des souverainetés nationales.
Mais l’universitaire insiste également sur les avantages stratégiques : « la fédération a l’avantage d’unifier les terroirs des trois entités, leurs forces armées et leurs économies. L’unification des territoires priverait les groupes terroristes et sécessionnistes de bases arrières et fera de la zone des trois frontières un espace géographique continu, sans rupture induite par des frontières ».
Une aspiration ravivée
À l’heure où le Mali s’apprête à commémorer le 65ème anniversaire de son indépendance, ce 22 septembre 2025, l’aspiration profonde du pays à un État fédéral sahélien, voire africain, qu’incarnait Modibo Keita, semble retrouver vie. Un peu plus d’un an après la création de la Confédération AES, les avancées en matière d’intégration sont réelles. L’enjeu est désormais de transformer cette flamme ravivée en réalité, en bâtissant une fédération sahélienne capable de résister aux vents contraires et de donner à l’Afrique un exemple durable d’intégration politique réussie.
Mohamed Kenouvi