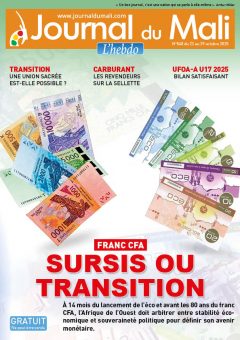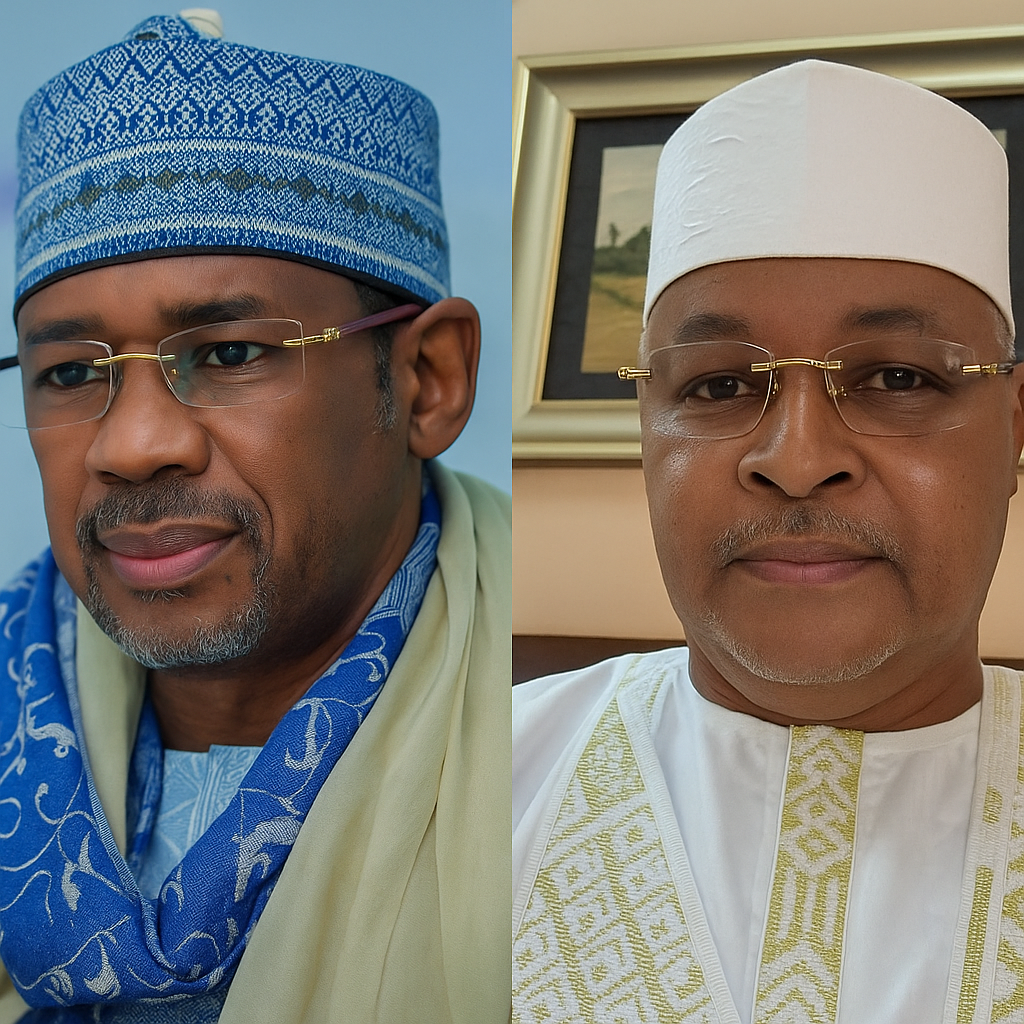Depuis plusieurs semaines, les stations-service maliennes tournent à vide. Dans la capitale comme à l’intérieur du pays, les files s’allongent, les prix flambent et la colère gronde. Entre perturbations sécuritaires et faibles capacités de stockage, la crise du carburant met à genoux une économie déjà fragilisée.
Plusieurs localités du pays sont confrontées depuis quelques semaines à une pénurie de carburant. Des difficultés d’approvisionnement perturbent fortement la distribution de l’essence et du gasoil. L’insuffisance de ces produits, indispensables à la vie économique et sociale, conduit à une flambée des prix et à une forte affluence dans les points de vente. En attendant une sécurisation de l’approvisionnement, les populations craignent une nouvelle crise.
Selon les chiffres de l’Office malien des produits pétroliers (OMAP), la consommation quotidienne moyenne du pays est estimée à 3,5 millions de litres, dont près de 60% destinés à la seule capitale. Cette dépendance logistique accrue explique la rapidité avec laquelle la moindre rupture d’approvisionnement se répercute sur l’ensemble du territoire.
Le 7 octobre 2025, plusieurs stations-service et points informels de vente de carburant sont pris d’assaut par des centaines de citoyens. L’attente est interminable et certains s’impatientent. Écoliers, commerçants ou conducteurs de moto-taxis, ils ont besoin de carburant pour se rendre à l’école, au travail ou pour exercer leur activité. Pendant ce temps, le circuit parallèle fonctionne à plein régime : ceux qui ont flairé une opportunité achètent du carburant pour le revendre plus cher à des usagers sans alternative. Dans certains quartiers de Bamako, notamment à Faladié et à Magnambougou, des revendeurs clandestins exposent désormais leurs bidons à la vue de tous. Les ventes se font à la sauvette, parfois à proximité immédiate des stations-service, sans contrôle ni mesures de sécurité.
Médecin au centre de santé de référence de Kalaban Coro, le Dr Assitan Sidibé observe avec inquiétude le tableau de bord de son véhicule. « la quantité de carburant que j’ai peut m’amener au service. Au retour, si je n’ai pas de carburant, je prendrai si possible un transport en commun », se résigne-t-elle. Comme elle, des dizaines de travailleurs ne savent pas s’ils auront le lendemain de quoi se déplacer. Certains étaient déjà en panne sèche faute d’avoir pu s’approvisionner.
Les hôpitaux et les centres de santé sont parmi les premiers touchés par cette pénurie. Certains établissements ont dû réduire les services de nuit ou recourir à des générateurs alimentés par des réserves limitées.
« Il n’y a plus d’essence », c’est la réponse la plus courante que l’on entend dans les quelques stations encore ouvertes. « Nous attendons du carburant d’ici ce soir », espère un pompiste. Dans celles qui disposent encore de carburant, les files d’attente s’allongent, créant une certaine tension et obligeant les gérants à faire appel aux forces de l’ordre pour éviter les débordements.
Des affrontements ont d’ailleurs été signalés dans plusieurs stations de la rive droite, où des automobilistes, excédés par les longues files, ont exprimé leur colère. Les forces de sécurité ont dû intervenir à plusieurs reprises pour disperser des attroupements.
Cette situation, qui risque de durer encore quelques semaines, impacte fortement la vie des citoyens, déjà éprouvés par la cherté de la vie. Par un effet domino, le prix de certains produits a grimpé en flèche, à l’image du gaz butane, dont la bouteille de 6 kilos revient désormais à 10 000 francs CFA contre 6 000 auparavant. Selon certaines sources, cette flambée pourrait se prolonger si les flux d’importation ne reprennent pas rapidement.
Tension palpable
« C’est seulement ces derniers jours que les citoyens ont touché du doigt le manque. Nous, nous le vivons depuis des semaines » estime un acteur du secteur des hydrocarbures. Depuis les attaques de camions-citernes sur l’axe Kayes – Bamako en septembre 2025, l’approvisionnement du pays est gravement perturbé. Des centaines de camions, bloqués aux frontières, n’entrent plus qu’au compte-goutte et sous escorte. La faiblesse du stock, qui ne couvre qu’une courte période de consommation, met le marché sous pression.
Pour remédier à la situation, les autorités ont annoncé leur volonté de tout mettre en œuvre pour éviter la rupture. Mais, malgré les assurances, la pénurie redoutée a gagné la capitale. Lors d’un point de presse, le 7 octobre, la Direction générale du Commerce et de la Concurrence a dénoncé les acteurs ne respectant pas les prix plafonds et promis des sanctions. Sur le terrain, cependant, les spéculations persistent. Selon les zones, le bidon d’un litre et demi se négocie entre 2 000 et 4 000 francs CFA.
Conséquence immédiate, les transports en commun – notamment les moto-taxis, très sollicités à Bamako – ont révisé leurs tarifs. Des trajets habituellement facturés 1 000 francs CFA coûtent désormais entre 1 500 et 2 000 francs. « L’essence coûte cher », ses justifient les conducteurs.
Environ 300 camions-citernes sont arrivés en fin de journée le 7 octobre, selon la télévision nationale. Une arrivée qui n’a pas mis fin aux longues files d’attente, visibles dès le lendemain matin dans les stations approvisionnées.
Effets redoutés
Les attaques de citernes ont occasionné des pertes considérables en carburant et en matériel, estimées à plusieurs centaines de millions de francs CFA. À cela s’ajoutent les frais liés aux escortes sécurisées, qui alourdissent encore les coûts de distribution et risquent de provoquer une hausse générale des prix.
Pour l’heure, les tarifs officiels restent fixés à 775 francs CFA le litre de super et 725 francs CFA pour le gasoil, mais le marché informel fait déjà grimper le litre d’essence à plus de 1 300 francs CFA à Bamako. Une nouvelle pression sur le pouvoir d’achat d’une population déjà éprouvée.
Rationnement nécessaire
Dans ce contexte de pénurie, chaque litre de carburant est devenu vital. Le fonctionnement de plusieurs services essentiels, notamment la santé et l’énergie, dépend directement de sa disponibilité. En 2024, les besoins du Mali en carburant avaient été estimés à 500 millions de litres, soit 309 milliards de francs CFA.
Depuis plusieurs semaines, les clients d’Énergie du Mali (EDM) subissent une chute brutale de la fourniture d’électricité : de 12 heures quotidiennes, la moyenne est passée à 6, voire 4 heures, rappelant les lourds délestages du début d’année. Cette absence d’énergie pénalise directement les entreprises et l’économie urbaine.
Pour répartir équitablement les quantités disponibles, les distributeurs s’efforcent de servir d’abord les secteurs prioritaires comme la santé, l’énergie ou les administrations publiques. Une rationalisation rendue difficile par la spéculation. « Le pire, c’est le comportement de certains spéculateurs », déplore un distributeur. « Ils achètent un bidon de 20 litres 15 000 francs CFA en station et le revendent aussitôt 30 000 francs ».
Renforcer le stockage
Avec une consommation annuelle estimée à 1,3 million de m³, le Mali ne dispose que d’une capacité de stockage de 53 853 m³, soit à peine l’équivalent d’un mois de consommation. Cette insuffisance structurelle et les perturbations logistiques expliquent la tension actuelle.
Pour pallier ces difficultés, les autorités envisagent de créer un stock national de sécurité, projet déjà à l’étude depuis plusieurs années. Son objectif : garantir une autonomie minimale de deux à trois mois en cas de crise régionale. Parmi les mesures prioritaires figurent l’élargissement des dépôts de stockage dans les zones stratégiques et la diversification des corridors d’importation, notamment via la Mauritanie.
L’axe Kayes – Bamako, qui représente plus de 50% du trafic national de carburant, reste le principal cordon d’approvisionnement du pays. De sa vitalité dépend la stabilité de toute l’économie.
Fatoumata Maguiraga