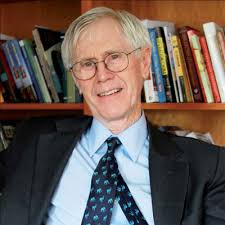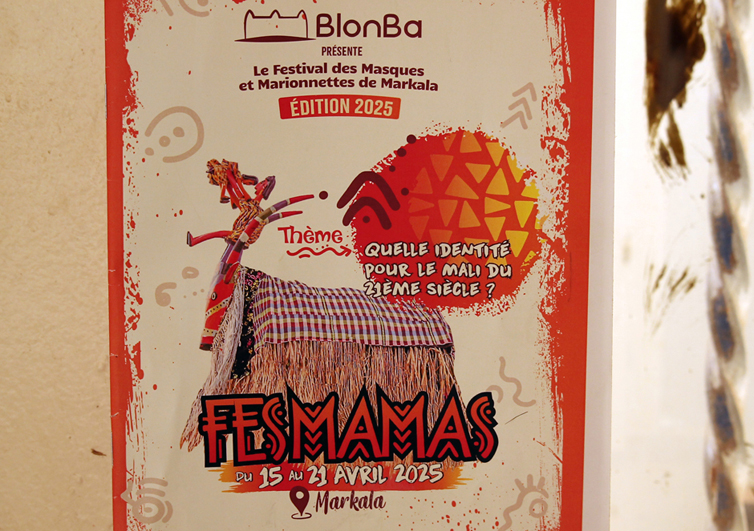La crise multidimensionnelle que vit le Mali depuis 2012 a gravement exacerbé les violations des droits des femmes. Cela s’est manifesté par une augmentation des violences à l’égard des femmes et une dégradation de leur situation socio-économique. Pour se reconstruire, les femmes ont endossé de nouvelles responsabilités et réclamé une participation effective aux processus de paix, condition essentielle à un retour à la stabilité.
« Il ressort que, depuis 2019, la situation des droits des femmes et des filles au Mali a connu une détérioration flagrante, principalement due à la dégradation du contexte sécuritaire et aux défis liés au genre, aggravant de surcroît les violences basées sur le genre (VBG) ». Selon le plan d’action du projet HYDROMET – Mali, la situation des VBG au Mali présente un tableau peu reluisant. Selon les statistiques, plus de 45% des femmes maliennes sont victimes de violences sexuelles au moins une fois dans leur vie et l’accès à une prise en charge holistique demeure problématique pour un grand nombre de survivantes. D’après le Système de Gestion des Informations sur les Violences Basées sur le Genre (GBVIMS), l’augmentation des VBG prend des proportions inquiétantes. En effet, 36% de ces cas sont des violences sexuelles, 19% des agressions physiques, 16% des dénis de ressources, 21% des violences psychologiques et 8% des mariages précoces. En outre, 97% de ces cas ont été signalés par des femmes, parmi lesquelles 48% sont des filles de moins de 18 ans. Ces données ne sont pas exhaustives et cachent une réalité alarmante : près de 70% des femmes ayant subi des violences n’en ont guère parlé, par crainte de représailles ou de stigmatisation.
La crise a favorisé le déplacement massif des femmes et des enfants, les exposant à divers dangers, y compris les VBG. Parmi ces femmes, plusieurs, devenues veuves, sont contraintes de chercher un peu de réconfort en ville. En plus de l’obligation de s’occuper de leurs enfants, elles sont souvent marginalisées et considérées comme des « porteuses de malheur », explique Mariam Sidibé, Conseillère technique en Genre au Conseil régional de Mopti.
Difficile reconstruction
Ces crises ont également entraîné la perte d’infrastructures sociales de base, ce qui accentue la vulnérabilité des femmes et des enfants, compromettant gravement leur santé et leur éducation.
Pour la prise en charge de ces femmes et de leurs enfants, les collectivités, faute de moyens, se contentent de mener des plaidoyers auprès des ONG afin d’améliorer les secours de tous ordres à ces victimes. Ces déplacés, ayant des besoins variés, sont secourus en fonction des capacités des partenaires, que le Conseil régional appuie pour assurer une synergie d’actions. Il intervient également pour faciliter la réinsertion socio-professionnelle de ces personnes.
Pour aider les personnes déplacées à se reconstruire, plusieurs mécanismes et dispositions ont été mis en place, notamment des séances de sensibilisation généralement menées en milieu urbain. En milieu rural, où il est plus difficile d’accéder à ces femmes, les communautés sont formées pour assurer le relais et sensibiliser les femmes à leur rôle pendant et après le conflit, afin d’apaiser le climat social. C’est un travail de longue haleine, dont les résultats ne sont pas immédiatement visibles, ajoute Mme Sidibé.
La reconstruction est également l’objectif de Hadeye Maïga, Présidente de l’IGDa, qui signifie « ça suffit », et membre du Comité de suivi de l’Accord issu du processus d’Alger, dénoncé par les autorités il y a un an. « Dans un pays en guerre, ce sont les femmes qui souffrent », déplore-t-elle. Épouses et mères, elles sont généralement sans formation et « lorsqu’elles perdent leurs maris, c’est le désespoir ». Grâce à des organisations locales comme Wildaf, ces femmes veuves et déplacées sont formées à des métiers tels que la savonnerie ou la tapisserie. Actuellement, l’organisation soutient une centaine de femmes, des victimes ayant fui Ménaka. En raison de la persistance de la crise, même si certains y retournent, plusieurs habitants des cercles de Ménaka se retrouvent à Bamako et d’autres continuent de quitter cette ville. Les activités de soutien, menées tant dans la capitale que dans la région de Ménaka, sont gravement entravées par l’insécurité et la cherté de la vie.
Faible participation aux processus de paix
L’État a lancé un nouveau processus de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR) dans un contexte sécuritaire marqué par une circulation massive des armes dépassant les frontières nationales. Cette situation impacte tous les secteurs de la vie, notamment la santé, l’éducation et le développement. Déjà critiqué pour son manque d’inclusivité, le processus affecte directement et indirectement les femmes, qui espèrent une meilleure intégration.
La crise a provoqué un bouleversement social dans lequel les femmes, perdant leurs soutiens de familles, se retrouvent dans un rôle qui n’est pas le leur, ce qui pose de nouvelles problématiques et influence l’éducation des enfants ainsi que le bien-être familial.
Sur le plan économique, généralement commerçantes et vivant de la petite agriculture, les femmes sont affectées par les difficultés de déplacement. Les menaces constantes, telles que les attaques armées et les engins explosifs, compromettent leur vie et leurs activités, explique Fatoumata Maïga, Présidente de l’Association des Femmes pour les Initiatives de Paix (AFIP). À cela s’ajoute le manque d’accès aux centres de santé, même pour les véhicules médicaux.
Pour réussir leur intégration dans le processus de paix, les femmes doivent s’unir et dialoguer avec les groupes locaux, suggère Madame Maïga. Les groupes armés s’appuient souvent sur les chefs locaux. Avec la crise internationale et la disparition de certains financements extérieurs, le soutien aux personnes vulnérables se complique, mais les acteurs locaux continuent d’œuvrer pour répondre aux urgences. La constitution de banques de céréales et la facilitation de l’accès à l’eau figurent parmi les priorités, car les « conflits ouverts autour de l’eau » sont une facette de la crise multidimensionnelle.
Malgré un cadre institutionnel et des mécanismes sociaux garantissant la participation des femmes aux processus de paix, ceux-ci restent peu appliqués. « Les femmes ont un rôle clé à jouer dans la paix et la reconstruction du pays, mais elles sont encore trop souvent exclues des prises de décision », estime Aminatou Walet Azarock, Présidente de l’ONG ADSPM.
À commencer par la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité de l’ONU, que le Mali a ratifiée et qui reconnaît leur rôle, demandant qu’elles soient pleinement impliquées dans les processus de paix et de sécurité. Sur le plan national, la Loi 052 instaure un quota d’au moins 30% de représentativité du genre sur les listes électorales et nominatives. Ces outils sont importants pour garantir une meilleure participation des femmes à la gouvernance. Toutefois, au-delà des textes, la Présidente de l’ONG ADSPM souhaite voir des actions concrètes pour former les femmes aux négociations, leur donner des opportunités d’accéder aux instances décisionnelles et soutenir les initiatives qu’elles portent sur le terrain, car une paix durable ne peut se construire sans elles.
Fatoumata Maguiraga