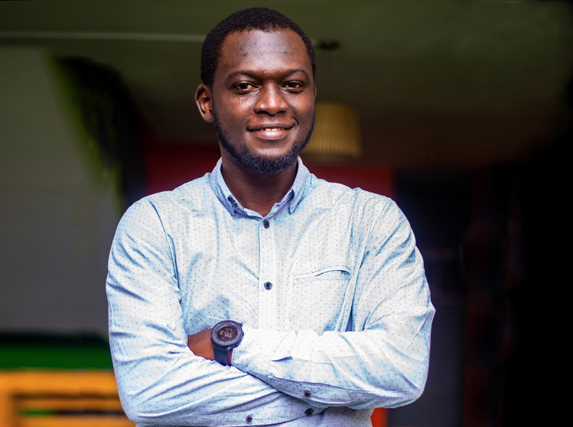Depuis plusieurs années, le Mali, pays historiquement connu pour sa tolérance interreligieuse, est confronté à une recrudescence de discours religieux polémiques. Ces prêches, souvent amplifiés par les réseaux sociaux, exaspèrent les tensions et fragilisent la cohésion sociale.
Des figures influentes telles que Mahi Ouattara, Abdoulaye Koïta ou le Révérend Michel Samaké ont récemment été convoquées par les juridictions, accusées d’incitation à la haine ou d’avoir tenu des propos offensants envers certaines confessions. Ces affaires reflètent les défis auxquels fait face le pays pour préserver l’harmonie entre ses différentes communautés religieuses.
Selon un document de l’ambassade des États-Unis au Mali publié en 2021, avec une population de plus de 22 millions d’habitants composée à 95% de Musulmans, majoritairement sunnites de rite malékite, et à 5% de Chrétiens (deux tiers catholiques, un tiers protestants), le Mali a toujours misé sur le dialogue interreligieux pour maintenir son unité. Cependant, les récentes dynamiques sociales et politiques, combinées à une utilisation intense des technologies numériques, amplifient les fractures et exacerbent les tensions.
Pourtant, le pays dispose d’un cadre légal robuste pour assurer la coexistence des confessions. La Constitution de 2023 consacre la laïcité de l’État tout en respectant les croyances religieuses. L’article 32 précise que la laïcité « ne s’oppose pas à la religion et aux croyances », mais vise à promouvoir le vivre-ensemble. En parallèle, l’article 1er interdit toute discrimination religieuse, tandis que l’article 14 garantit la liberté de pensée, de conscience et de culte.
Le Code pénal renforce ces principes à travers des dispositions spécifiques. L’article 242-1 punit tout propos ou acte portant atteinte à la liberté de conscience ou incitant à une discrimination religieuse d’un emprisonnement de sept ans et d’une interdiction de séjour de dix ans. L’article 255-1, quant à lui, condamne l’apologie du terrorisme, particulièrement lorsqu’elle attise les tensions interconfessionnelles.
Des références internationales pour renforcer la tolérance
Le Mali est également signataire de plusieurs conventions internationales protégeant la liberté religieuse. Parmi celles-ci figurent entre autres la Déclaration universelle des droits de l’Homme (1948), qui consacre la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 18), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), qui réaffirme ce droit en insistant sur la liberté de manifester sa religion individuellement ou collectivement, la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion (1981) et la Convention relative aux droits de l’enfant (1989), dont l’article 14 garantit aux enfants la liberté religieuse tout en respectant le rôle des parents.
Ces instruments renforcent les engagements du Mali en faveur d’un climat de tolérance et d’égalité entre toutes les confessions.
Les médersas : un pilier éducatif sous pression
Les médersas, ou écoles coraniques, jouent un rôle central dans l’éducation religieuse au Mali. Elles représentent environ 16% des établissements scolaires, avec plus de 3 000 écoles accueillant environ 400 000 élèves. Ces institutions, bien qu’essentielles pour la transmission des valeurs islamiques, font face à des défis importants. Dans certaines régions, le manque de supervision permet la propagation de discours radicaux ou l’enseignement d’idéologies extrémistes.
Pour y remédier, le ministère des Affaires religieuses a lancé des initiatives visant à mieux encadrer ces écoles. Des formations pour les maîtres coraniques axées sur la tolérance et la coexistence pacifique ont été mises en place. De plus, des modules éducatifs sur la paix et le respect des diversités ont été introduits dans certains programmes scolaires. Ces efforts cherchent à renforcer le rôle positif des médersas dans la société.
Les conséquences de la radicalisation sur les communautés
Entre 2021 et 2024, les activités des groupes armés dans les régions du nord et du centre ont eu des conséquences dramatiques sur l’éducation. Selon le rapport du Cluster Éducation Mali publié fin 2024, l’insécurité persistante a entraîné la fermeture de 1 792 écoles, affectant environ 537 600 élèves et 10 752 enseignants. Cette crise éducative est alimentée par des discours religieux polémiques qui, en déshumanisant ou en diabolisant « l’autre », justifient le recours à la violence contre des groupes perçus comme des menaces. Le rapport « La Fabrique de l’islamisme » et les travaux d’Open Edition Books confirment que ce type de rhétorique, combiné aux tensions sociales et politiques, facilite la montée de l’extrémisme violent. Cette dynamique offre aux groupes radicaux un terreau fertile pour recruter des partisans, exacerbant davantage les tensions et l’instabilité dans le pays.
Selon le Rapport 2021 de l’Aide à l’Église en Détresse (AED), la liberté religieuse est menacée dans un pays sur trois, avec des violations notoires dans 62 pays parmi les 196 étudiés. Le Mali fait partie de ces nations où la liberté religieuse est compromise, principalement en raison de l’expansion du terrorisme et des tensions intercommunautaires. Cette situation illustre les défis auxquels le pays est confronté pour garantir la coexistence pacifique entre les différentes communautés religieuses
Des lieux de culte chrétiens, bien que minoritaires, ont également été pris pour cible. De plus, plusieurs attaques et enlèvements de religieux, Musulmans et Chrétiens, ont été signalés, alimentant un climat de peur et de méfiance entre les communautés. Ces tensions soulignent l’impact direct des discours polarisants sur la cohésion sociale.
Discours de haine en ligne : une menace amplifiée par le numérique
Avec 7,82 millions d’internautes en 2024, soit un taux de pénétration de 33,1%, et 2,15 millions d’utilisateurs de réseaux sociaux, selon DaraReportal, le Mali fait face à une utilisation grandissante des technologies numériques. Cependant, ces plateformes deviennent également des espaces privilégiés pour la diffusion de discours clivants et haineux. Les algorithmes des réseaux sociaux favorisent souvent les contenus polémiques, créant des « chambres d’écho » qui renforcent les croyances extrémistes.
Par ailleurs, le Pôle national de lutte contre la cybercriminalité s’efforce de réguler ces discours en ligne, mais il manque de moyens techniques et financiers. De plus, des campagnes de sensibilisation, souvent menées par des ONG locales, visent à éduquer les utilisateurs sur les dangers des contenus extrémistes et à promouvoir un usage responsable des plateformes numériques.
Des exemples régionaux pour inspirer le Mali
Certains pays africains offrent des modèles réussis pour encadrer les discours religieux. Au Maroc, le Haut Conseil des Oulémas supervise les prêches et veille à ce qu’ils respectent les principes d’un Islam modéré. Depuis 2005, plus de 12 000 Imams y ont été formés pour diffuser des messages de tolérance. Le Sénégal, quant à lui, dispose du Conseil National des Imams et Oulémas, qui joue un rôle similaire en encourageant des sermons prônant la paix et la coexistence pacifique. À l’international, l’ambassade des États-Unis au Mali soutient des initiatives de dialogue interreligieux et des formations en médiation ayant bénéficié à plus de 500 participants en 2021 pour renforcer la cohésion sociale et contrer l’extrémisme violent. Ces exemples montrent qu’un encadrement institutionnel rigoureux peut prévenir la radicalisation et renforcer la cohésion sociale.
Les initiatives nationales pour promouvoir la paix
Pour contrer les discours haineux et prévenir l’extrémisme, le gouvernement a mis en place plusieurs initiatives. Le Plan d’action national pour la prévention de l’extrémisme violent (2021 – 2025) constitue une réponse stratégique aux causes profondes de la radicalisation. Ce plan s’appuie sur l’éducation, le dialogue interreligieux et le renforcement des institutions locales. Malgré l’énorme travail abattu, cette initiative fait face à plusieurs limites objectives. Le Plan d’action national pour la prévention de l’extrémisme violent au Mali présente plusieurs failles, notamment une coordination insuffisante entre les acteurs impliqués, des ressources financières et humaines limitées et un contexte sécuritaire instable marqué par des violences persistantes. De plus, bien que l’engagement communautaire soit essentiel, la mobilisation effective des populations locales reste un défi. Ces facteurs limitent l’efficacité et la portée du plan dans la lutte contre l’extrémisme violent.
Parallèlement à cette initiative, le Projet Alternatif Redevable pour Lutter contre l’Extrémisme Radical (PARLER), lancé en 2022, forme les leaders religieux à diffuser des prêches modérés. De plus, le Cadre de concertation interreligieux, actif depuis 2021, organise des forums pour désamorcer les tensions et encourager la compréhension mutuelle entre les confessions.
Le Mali dispose d’un cadre juridique solide et de nombreuses initiatives pour faire face aux défis posés par les discours religieux polémiques. Cependant, leur mise en œuvre nécessite une meilleure coordination entre l’État, les institutions religieuses et la société civile. En s’inspirant de modèles régionaux et en mobilisant tous les acteurs, le pays peut renforcer sa résilience et préserver son identité de nation tolérante et inclusive.
Massiré Diop