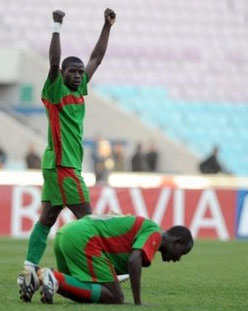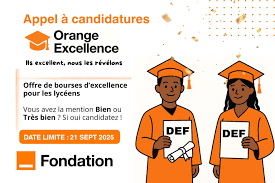Onze ressortissants d’Afrique de l’Ouest expulsés des États-Unis ont été transférés début septembre vers le Ghana, avant qu’au moins six d’entre eux ne soient envoyés vers le Togo, selon leurs avocats. Parmi eux figurent deux Maliens dont la situation demeure incertaine, aucune confirmation officielle n’ayant été donnée sur leur lieu de détention actuel ou leur statut.
Ces personnes, originaires notamment du Mali, du Nigeria, du Libéria, de la Gambie et du Togo, ont été rapatriées par les autorités américaines dans le cadre d’une opération d’expulsion coordonnée avec plusieurs États africains. À leur arrivée au Ghana, elles ont été placées dans des installations sous contrôle militaire, selon leur avocat Oliver Barker-Vormawor, qui dénonce une détention sans base légale claire. Il affirme que ses clients n’ont reçu aucune information sur les procédures en cours et que plusieurs d’entre eux ont signalé des conditions de détention difficiles, incluant des problèmes de santé et un accès limité aux soins.
Toujours selon la défense, au moins six des migrants ont été transférés vers le Togo sans notification préalable ni décision judiciaire apparente. Les autorités ghanéennes ont de leur côté indiqué que les personnes concernées avaient « quitté le pays pour rejoindre leurs États d’origine », sans fournir de précisions sur les conditions de ce départ ni sur les pays vers lesquels elles ont été envoyées. L’avocat affirme par ailleurs avoir perdu le contact avec plusieurs d’entre elles, ce qui renforce l’incertitude sur leur sort.
La présence de deux ressortissants maliens parmi ce groupe confère à cette affaire une portée particulière au niveau national. Aucune réaction officielle n’a pour l’heure été enregistrée à Bamako concernant leur prise en charge ou d’éventuelles démarches consulaires. Leur situation s’inscrit dans un contexte plus large de renvois de migrants d’origine africaine depuis les États-Unis, souvent effectués dans des conditions dénoncées par les organisations de défense des droits humains, qui appellent à davantage de transparence et de garanties juridiques dans les procédures de retour.
À ce jour, la localisation précise des deux Maliens n’a pas été confirmée. Les procédures judiciaires engagées au Ghana devraient permettre d’apporter des éléments supplémentaires sur leur situation dans les prochaines semaines.