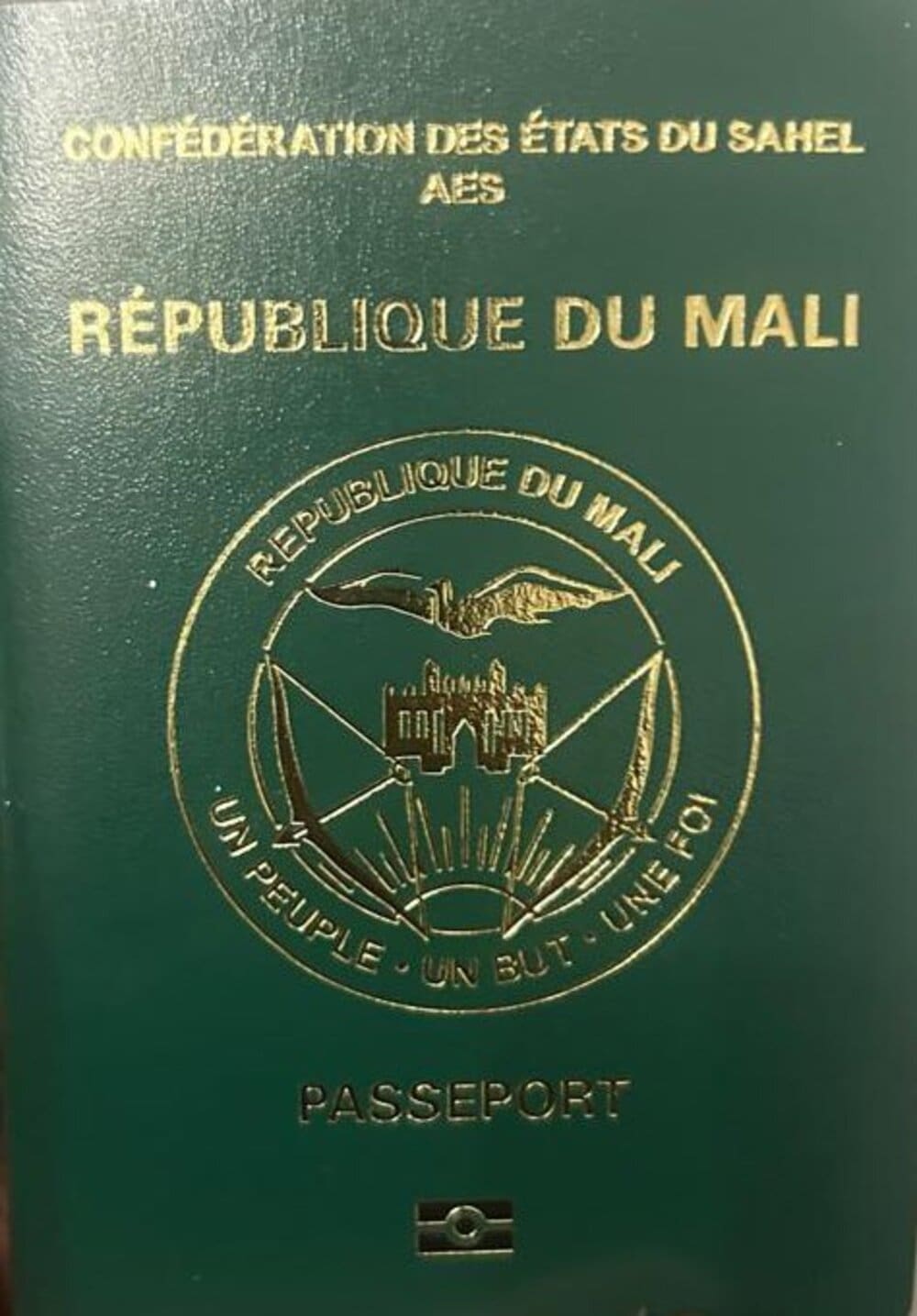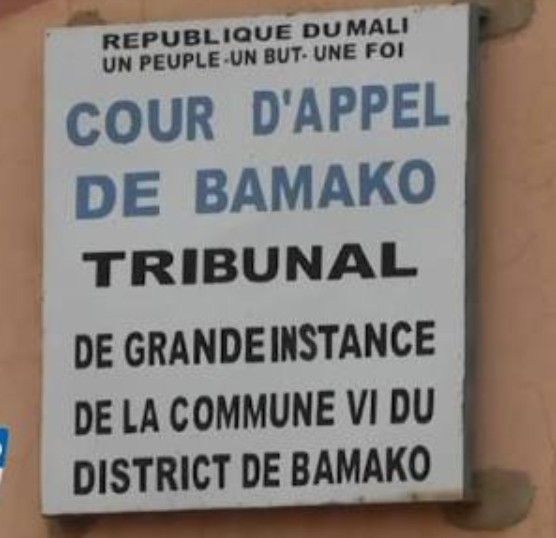Dans un contexte marqué par la baisse des financements institutionnels et l’insécurité, Médecins Sans Frontières intensifie ses interventions dans plusieurs régions pour garantir l’accès aux soins dans les zones les plus vulnérables. L’organisation appuie désormais davantage de centres de santé communautaires afin de combler les vides laissés par le retrait d’autres acteurs.
La crise humanitaire s’aggrave alors que les besoins explosent et que les ressources se tarissent. Selon la Coordination des affaires humanitaires (OCHA), 6,4 millions de personnes nécessitent une assistance multisectorielle en 2025. Pour y répondre, le gouvernement et ses partenaires avaient sollicité 771,3 millions de dollars afin d’apporter une aide à 4,7 millions de personnes vulnérables. Mais à la fin août, seulement 13,5 % de ce montant avait été mobilisé, dont 21,7 % pour la santé et 9,3 % pour la nutrition. L’arrêt brutal de l’aide américaine et la suspension de nombreux financements institutionnels ont encore aggravé la situation.
Cette chute des ressources a conduit plusieurs organisations à réduire ou à suspendre leurs activités. Dans les régions d’Ansongo, Kidal, Tombouctou, Douentza, Ténenkou ou Nampala, « certaines organisations humanitaires n’ont pas eu d’autres choix que de restreindre leurs soutiens et leurs interventions à cause de l’insécurité permanente et de récentes réductions budgétaires », explique Désiré Kimanuka, chef de mission de MSF au Mali. Les conséquences sont lourdes pour les communautés, privées d’une assistance vitale, alors que les déplacements de populations s’intensifient. Début septembre, dans le cercle de Niono, les habitants de Farabougou ont fui vers Dogofry et Sokolo, accentuant la pression sur les structures sanitaires.
Face à cette situation, MSF, dont plus de 90 % du financement provient de donateurs privés, intensifie sa présence pour combler les vides laissés par d’autres acteurs. « Face à la réduction de la réponse humanitaire dans certaines localités, nous avons décidé de renforcer notre intervention dans les structures communautaires afin de garantir la continuité de l’accès aux soins », précise Désiré Kimanuka. L’organisation soutient désormais plusieurs CSCOM dans les cercles d’Ansongo, Niafounké, Ténenkou, Niono et Douentza, en fournissant des soins de santé maternelle, des services nutritionnels, des soins pédiatriques, des activités de santé mentale, la prise en charge des victimes de violences ainsi que des références de cas graves.
Cet appui a permis d’augmenter considérablement la capacité de prise en charge des structures locales. « Avant notre partenariat, nous effectuions entre 200 et 300 consultations par semaine. Aujourd’hui, nous dépassons les 1 000 », témoigne Kadia Coulibaly, directrice technique du centre de santé communautaire central de Ténenkou. Entre janvier et juillet 2025, les neuf CSCOM soutenus par MSF ont réalisé 18 094 consultations générales, traité 14 392 enfants atteints de paludisme, soigné 11 849 cas de malnutrition, supervisé 262 accouchements et assuré 286 références vers des structures de santé de référence.
Dans un contexte d’insécurité persistante, de pressions financières accrues et d’effondrement de l’aide internationale, ces efforts permettent de maintenir un accès minimal aux soins dans des zones reculées et délaissées. Mais les besoins continuent d’augmenter, et la dépendance vis-à-vis d’organisations comme MSF ne cesse de croître, révélant la fragilité structurelle du système de santé face aux crises cumulées.