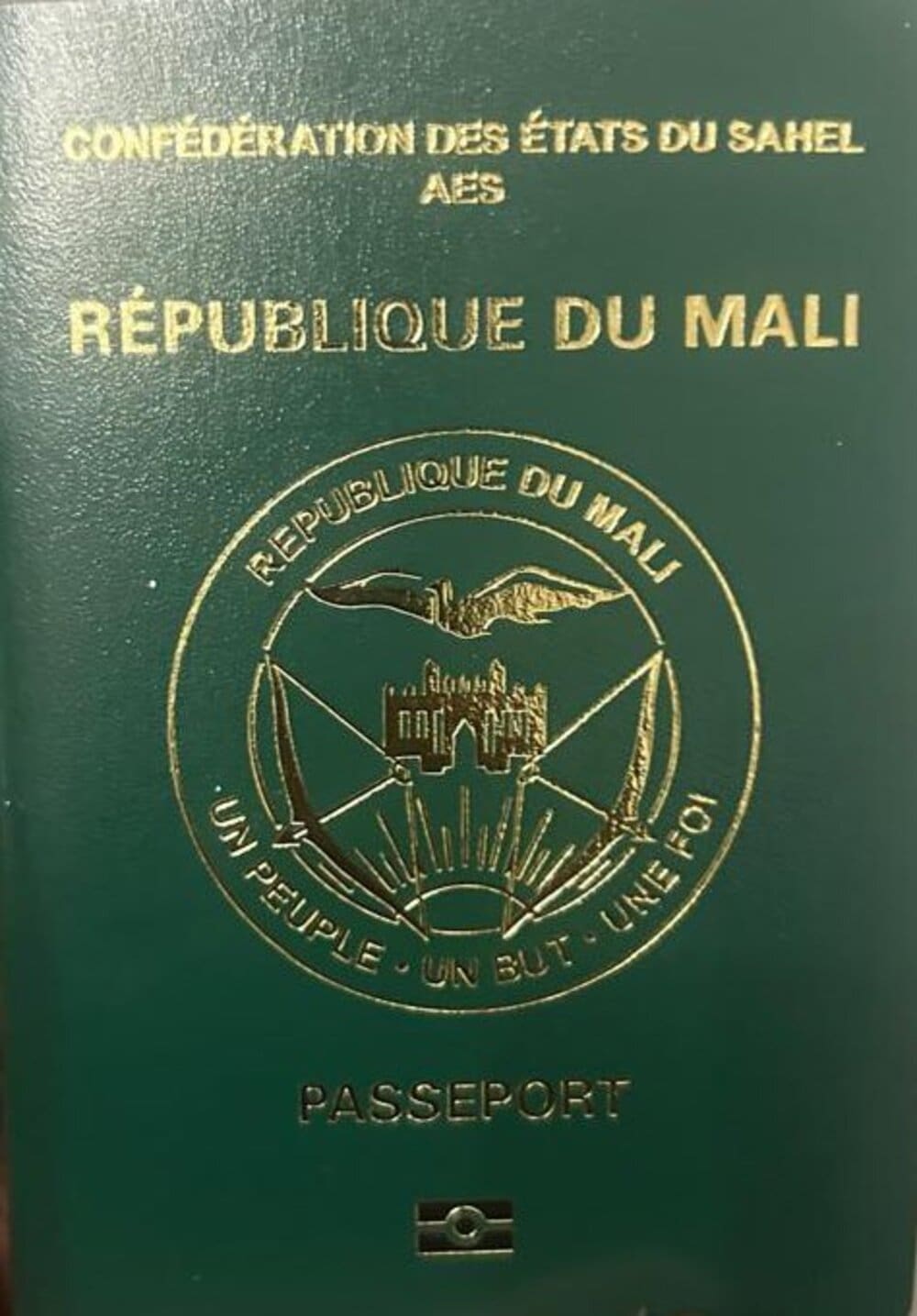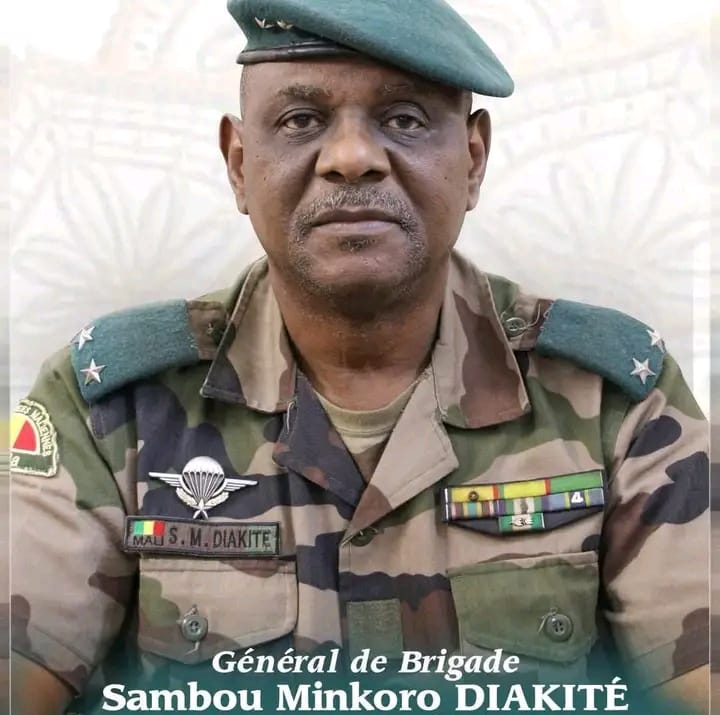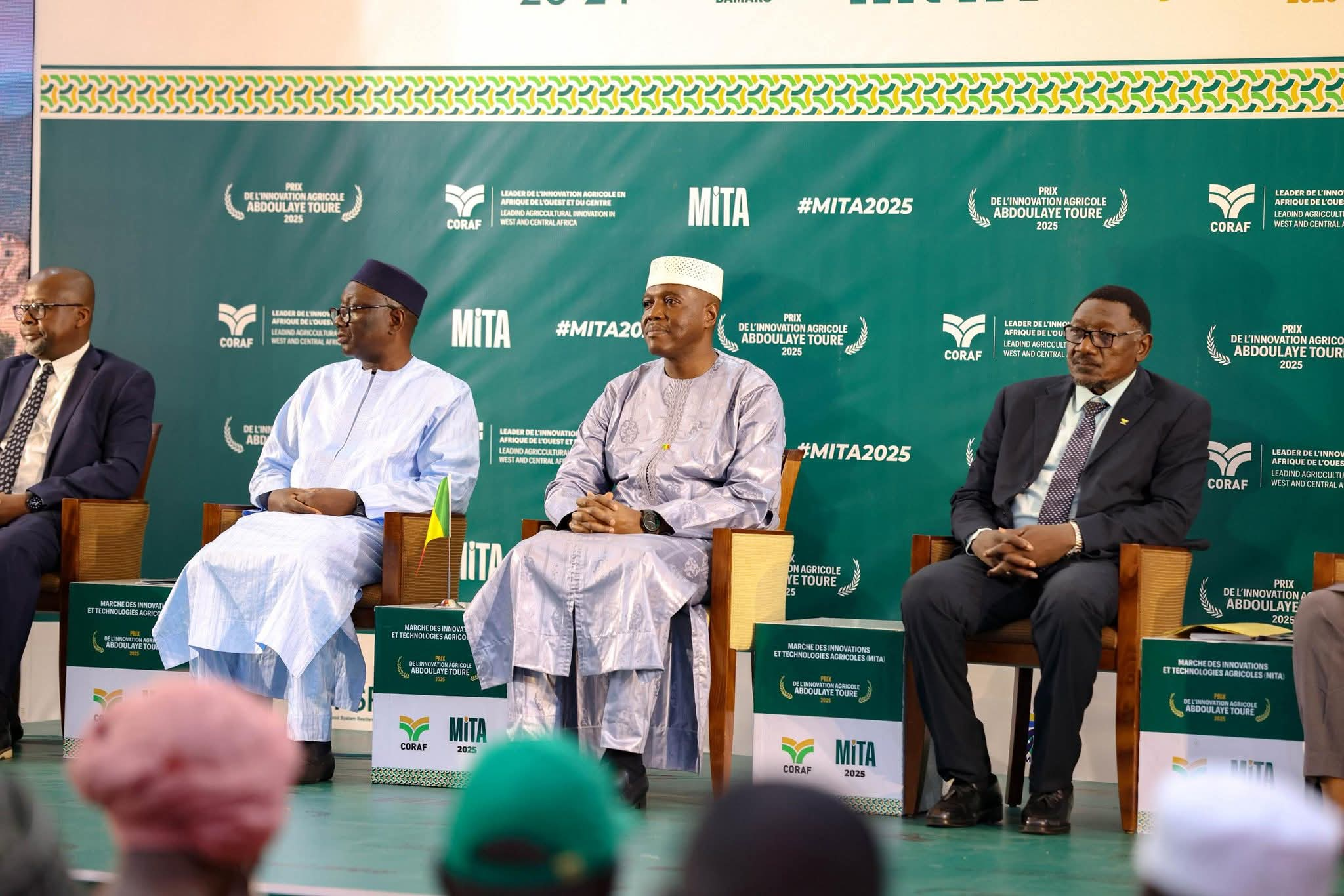Depuis le début de la Transition, plusieurs personnalités politiques et figures publiques font face à la justice. Arrestations, mandats d’arrêt internationaux et condamnations se succèdent, dans un climat de méfiance et de crispation politique.
L’ancien Premier ministre Moussa Mara a écopé le 27 octobre 2025 de deux ans de prison, dont un ferme, pour des faits qualifiés « d’atteinte au crédit de l’État », liés à des propos diffusés sur les réseaux sociaux en juillet dernier.
Quelques semaines plus tôt, le 19 août, Choguel Kokalla Maïga, lui aussi ancien Premier ministre, avait été placé sous mandat de dépôt dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons « d’atteinte aux biens publics, faux et usage de faux ».
En parallèle, plusieurs anciens ministres sont visés par des mandats d’arrêt internationaux. Tiéman Hubert Coulibaly, ancien ministre de la Défense, fait l’objet depuis juillet 2022 d’un mandat international pour « crime de faux, usage de faux et atteinte aux biens publics », dans une affaire d’achats d’équipements militaires datant de 2015. Les mêmes accusations concernent l’ancien Premier ministre Boubou Cissé et Mamadou Igor Diarra, ex-ministre de l’Économie et des Finances.
Des affaires successives
D’autres personnalités notables alimentent également ce panorama judiciaire. Mohamed Youssouf Bathily, dit Ras Bath, est détenu depuis le 13 mars 2023 pour des propos jugés diffamatoires. Condamné en appel à 18 mois de prison, dont 9 avec sursis, il reste détenu dans le cadre d’autres procédures en cours.
L’activiste et ancien membre du Conseil national de Transition Adama Diarra, alias Ben le Cerveau, a été reconnu coupable en septembre 2023 « d’atteinte au crédit de l’État » et purge une peine de deux ans, dont un an ferme. Sa demande de libération provisoire a été rejetée en février dernier.
Issa Kaou N’Djim, également ancien membre du Parlement de la Transition, a pour sa part été condamné le 30 décembre 2024 à deux ans de prison, dont un ferme, pour offense publique et injures via les systèmes d’information.
Le Président du parti dissous Alternative pour le Mali Mamadou Traoré, surnommé Le Roi, a été condamné le 19 juin 2025 à un an de prison ferme pour « atteinte au crédit de l’État » et « diffusion de fausses nouvelles ».
En juin 2024, onze responsables politiques avaient été interpellés à Bamako après avoir tenu une réunion jugée illégale par les autorités. Parmi eux figuraient trois anciens ministres – Mohamed Aly Bathily, Yaya Sangaré et Moustapha Dicko – ainsi que plusieurs Présidents de partis dissous. Ils ont été poursuivis pour « atteinte à la sûreté de l’État » et « troubles à l’ordre public » avant d’être libérés le 5 décembre 2024.
Le dossier de Clément Dembélé, figure connue de la lutte contre la corruption, s’ajoute à cette longue liste. Interpellé en novembre 2023 alors qu’il devait animer une conférence de presse sur la gouvernance et la crise énergétique, il a été accusé d’avoir proféré des menaces contre le Président de la Transition et son entourage.
Appels à la libération
La multiplication de ces procédures inquiète les organisations de défense des droits humains. Amnesty International, Human Rights Watch et d’autres organisations internationales ont appelé à la libération des détenus politiques et au respect des droits de la défense.
L’Union européenne a de son côté insisté sur la nécessité d’une transparence totale dans le traitement des affaires judiciaires, ainsi que sur le respect des standards internationaux relatifs à la liberté d’expression et à la détention.
« La condamnation et la peine prononcées à l’encontre de Moussa Mara illustrent le mépris persistant des autorités pour les obligations du Mali en matière de droits humains, conformément à la Constitution et aux traités internationaux ratifiés par le pays », a déclaré Marceau Sivieude, Directeur régional d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale. Selon lui, « au lieu de museler les voix critiques, les autorités doivent mettre fin à la répression croissante de l’opposition pacifique et libérer immédiatement les personnes détenues pour le simple fait d’avoir exprimé leur opinion ».
Un analyste politique malien ayant requis l’anonymat abonde dans le même sens : « ces détentions répétées de responsables politiques, d’activistes et de figures publiques envoient un signal inquiétant. Elles restreignent la liberté d’expression et créent un climat de peur dans l’espace public ».
Mohamed Kenouvi