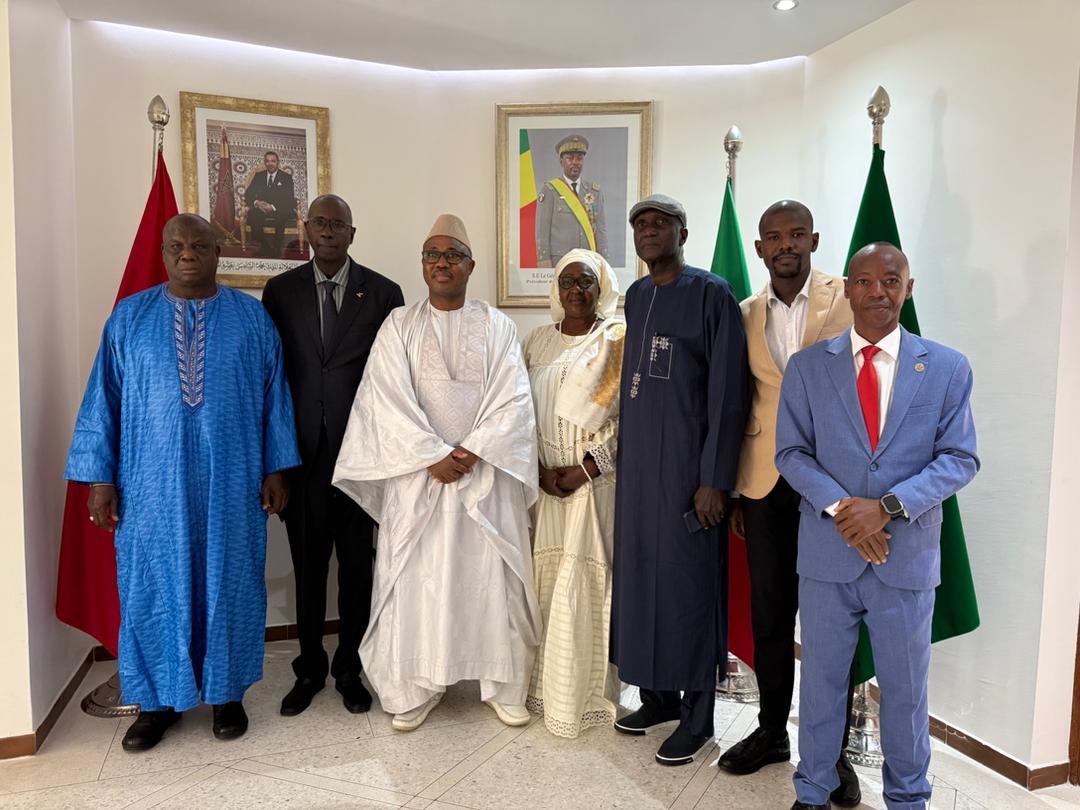Après quelques mois d’amélioration dans la fourniture d’électricité, les coupures intempestives reviennent en force à Bamako et dans les régions, paralysant l’économie du pays.
Depuis le début du mois de septembre, la fourniture d’électricité au Mali s’est brutalement dégradée. Les longues heures d’obscurité, qui rappellent les pires moments de 2023 et 2024, sont de retour.
À Bamako, les habitants n’ont désormais droit qu’à quelques heures d’électricité par jour. Dans le quartier de Niamakoro, en Commune VI du District de Bamako, les foyers passent la plupart de leurs soirées à la lueur de lampes rechargeables.
Fatoumata Keïta raconte : « depuis septembre, on dirait qu’on est revenu en arrière. Avant, on avait au moins douze heures de courant par jour. Aujourd’hui, c’est seulement six. Quand l’électricité revient, c’est un ouf de soulagement, mais elle ne dure pas ».
Même scénario dans la plupart des quartiers de la capitale, avec des coupures continues d’environ douze heures désormais devenues la norme.
Les régions à l’agonie
Dans les régions, la situation est encore plus dramatique. « Avant le mois de septembre, on avait seize heures d’électricité par jour. Aujourd’hui, c’est quatre heures tout au plus. Et, depuis deux semaines, les groupes de la centrale sont éteints, faute de carburant. Nous vivons dans le noir total », témoigne un habitant de Douentza.
À Ansongo, où les habitants bénéficiaient encore de seize heures d’électricité quotidiennes jusqu’à fin octobre, la ville est de nouveau plongée dans l’obscurité depuis début novembre, en raison d’un manque de gasoil dans la centrale locale d’Énergie du Mali (EDM-SA).
Dans d’autres localités, comme Mopti, les délestages atteignent parfois vingt heures d’affilée. Ségou, pour sa part, s’en sort un peu mieux. Selon des informations recueillies sur place, la ville continue de bénéficier d’environ six heures d’électricité par jour, tout comme Bamako.
Le système électrique malien repose encore en grande partie sur des centrales thermiques alimentées en gasoil et en fuel, ce qui rend l’approvisionnement énergétique très dépendant de l’importation d’hydrocarbures et du fonctionnement continu des corridors routiers.
À Kayes, la situation diffère légèrement de celle observée dans d’autres régions. Plusieurs habitants et transporteurs interrogés indiquent que la ville connaît moins de ruptures d’approvisionnement en carburant et des coupures d’électricité moins fréquentes que Bamako ou Mopti. Cette situation serait liée au fait que Kayes constitue le premier grand point de stockage sur le corridor Dakar – Bamako et que certains convois hésitent désormais à poursuivre leur route au-delà, en raison des risques d’attaques sur l’axe menant vers l’intérieur du pays.
Sans confirmation officielle à ce stade, cette perception locale illustre néanmoins l’impact direct de l’insécurité sur la circulation des produits énergétiques.
Le choc pour les « petits » métiers
À Bamako, la crise énergétique a profondément transformé le quotidien des artisans et des petites entreprises. Les ateliers tournent au ralenti, les machines restent muettes et les pertes économiques s’accumulent.
Chez les boulangers, la situation est critique. « Avant, on faisait trois fournées par jour, aujourd’hui à peine une seule », se désole Abdoulaye Keïta, propriétaire d’une petite boulangerie à Faso Kanu. « On a un groupe, mais il ne tourne plus régulièrement, parce que se procurer du gasoil est devenu très difficile », poursuit-il, désabusé.
Même impasse du côté des soudeurs. À Sogoniko, dans un atelier poussiéreux, les travailleurs sont assis devant leurs postes éteints. Moussa Diarra, la quarantaine, confie : « depuis près de deux semaines, on ne travaille presque plus. La soudure dépend du courant et le groupe est en panne. Avant, je pouvais gagner 10 000 à 15 000 francs CFA par jour. Aujourd’hui, c’est à peine la moitié. »
Le constat est identique chez les tailleurs. Issa Samaké, couturier aux Halles de Bamako, peste contre la situation : « les clients viennent avec des habits à confectionner, mais sans courant comment faire ? Les machines à coudre électriques sont à l’arrêt pendant des heures. On fait ce qu’on peut à la main, mais ce n’est pas rentable. »
Dans le secteur du froid, les pertes sont tout aussi considérables. Adama Coulibaly, vendeur de poissons et de poulets congelés à Faladié, montre ses congélateurs dégivrés. « Mes produits pourrissent sans électricité. J’ai perdu beaucoup d’argent ces derniers temps. Même alimenter le groupe électrogène est devenu difficile », se plaint-il.
Mariam Doumbia, propriétaire d’une crèmerie à Sogoniko, vit pratiquement la même situation : « mes congélateurs tournent au ralenti et une grande partie des glaces fond. Les clients se plaignent, certains vont ailleurs. »
Un impact économique dévastateur
En plus des petits métiers du secteur informel, les PME et PMI sont les premières à encaisser le choc. Selon des économistes, les coupures actuelles entraînent d’importantes pertes.
« La crise énergétique a un impact direct sur les revenus des PME-PMI et cela va se prolonger sur l’employabilité au Mali. Des études récentes ont montré que nombre d’entreprises sont à la porte de la fermeture ou ont mis une partie de leurs employés en chômage technique », souligne Dr Abdoulaye N’Tigui Konaré, économiste.
Il explique que même les entreprises ayant investi dans des groupes électrogènes ou des panneaux solaires ne sont plus aussi rentables qu’avant, le coût du thermique étant devenu exorbitant.
Des organisations professionnelles, dont la CNPM et la CCIM, alertent sur les délestages prolongés qui fragilisent fortement les petites et moyennes entreprises, entraînant pertes financières, ralentissement de la production et risque accru de fermeture ou de chômage technique.
Restructuration et diversification énergétique
Depuis le déclenchement de la crise énergétique, en 2022, le gouvernement a multiplié les mesures pour tenter de stabiliser l’approvisionnement en électricité. En décembre 2023, une décision importante a été prise : la réduction du nombre de fournisseurs de carburant d’EDM-SA, jugé trop élevé et source de retards dans les livraisons. Cette rationalisation visait à sécuriser davantage l’approvisionnement en fuel, à réduire les coûts et à limiter les interruptions dans les centrales thermiques.
En mars 2024, une convention a été signée entre la Société nigérienne du pétrole (SONIDEP) et l’Office malien des Produits Pétroliers (OMAP) pour la livraison de gasoil en provenance du Niger, ouvrant une nouvelle route d’approvisionnement. Parallèlement, la Russie a livré environ 20 millions de litres de gasoil, un appui ponctuel destiné à atténuer la pression sur les stocks.
Dans le même temps, la viabilité financière d’EDM-SA est restée un défi central. Le 7 mars 2024, une convention de restructuration de la dette bancaire de l’entreprise, évaluée à près de 300 milliards de francs CFA, a été conclue avec plusieurs banques. Elle prévoyait un étalement des remboursements sur dix ans, dont une année de différé, afin de renforcer la trésorerie de la société et de lui permettre de maintenir un minimum d’exploitation. Cette mesure s’inscrivait dans un plan de redressement plus global visant la maîtrise des coûts, l’amélioration du recouvrement et l’optimisation de la gouvernance.
Le pari du solaire et les mesures d’urgence
Sur le plan structurel, le gouvernement a lancé, entre fin mai et début juin 2024, la construction de centrales solaires à Safo (100 MW), Sanankoroba (200 MW) et Tiakadougou – Dialakoro (100 MW). L’objectif affiché est de réduire la dépendance au thermique et d’augmenter progressivement la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national.
En parallèle, en juin 2024, le Président de la Transition a remis 25 groupes électrogènes à EDM-SA pour atténuer les délestages et assurer un soutien temporaire aux réseaux urbains et régionaux, en attendant la mise en service des installations solaires.
En février 2025, le gouvernement a instauré un Fonds d’appui aux infrastructures de base et au développement social. Le 14 juillet, 24 milliards de francs CFA sur les 34 milliards mobilisés ont été alloués à EDM-SA pour garantir l’achat de carburant et stabiliser l’exploitation des centrales. Il était également prévu dans les mois suivants la livraison de 160 000 à 200 000 tonnes d’hydrocarbures importés de Russie afin de sécuriser l’approvisionnement.
Ces efforts témoignent d’une volonté de rompre avec la dépendance au fuel importé, mais la crise actuelle montre les limites du système. Entre centrales thermiques à l’arrêt faute de carburant et projets solaires encore en phase de construction, le pays est confronté à une équation énergétique qui pèse sur l’ensemble de l’économie.
Mohamed Kenouvi