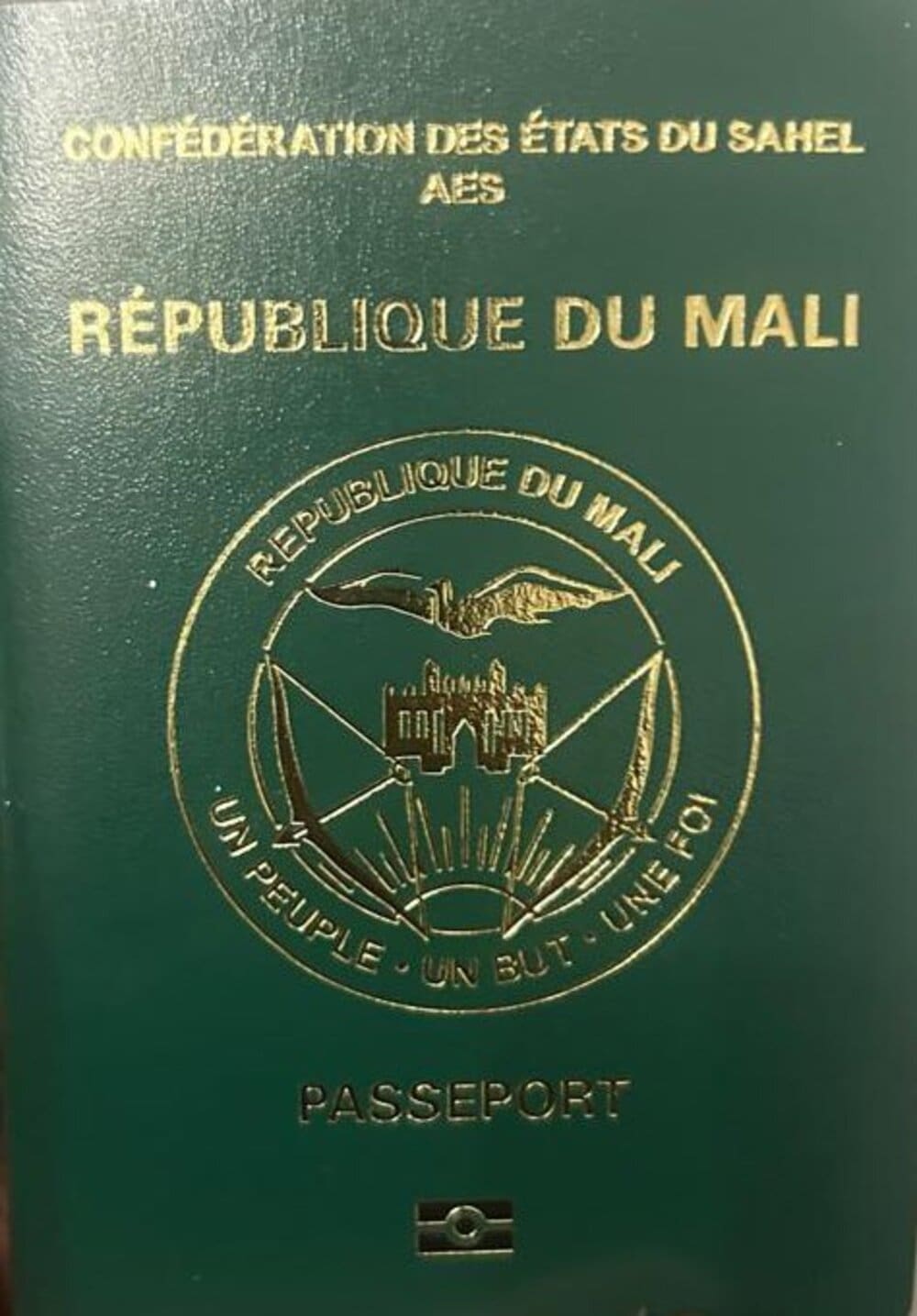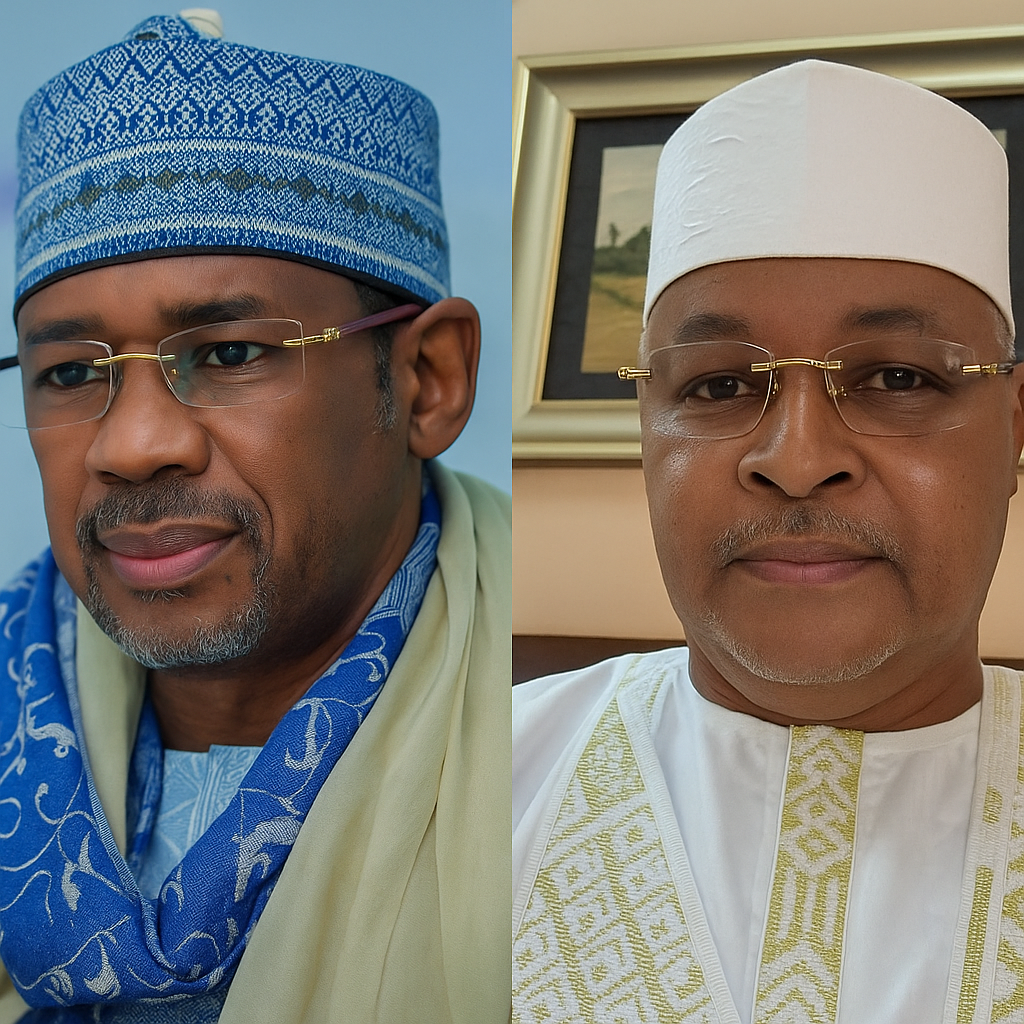En ce mois d’Octobre Rose, le Mali dresse un état des lieux contrasté de la lutte contre les cancers féminins. Malgré des progrès notables en matière de sensibilisation, de dépistage et de traitement, le pays reste confronté à d’importantes limites structurelles et socio-économiques.
Les cancers du sein et du col de l’utérus demeurent les deux formes de cancer les plus répandues chez les femmes au Mali. En 2020, le pays a recensé plus de 14 000 nouveaux cas de cancers, dont près de 4 400 cas de cancers du sein et du col de l’utérus.
En 2022, ces chiffres ont encore grimpé, avec 2 278 nouveaux cas de cancer du sein et 2 436 cas de cancer du col, selon les données officielles du ministère de la Santé. Cette progression, bien qu’inquiétante, s’explique en partie par l’amélioration du dépistage et une plus grande visibilité des campagnes de prévention menées à l’échelle nationale.
Ces deux cancers, longtemps restés silencieux dans l’espace public, sont désormais au cœur des politiques de santé et des programmes de lutte contre les maladies non transmissibles.
Sensibilisation en hausse
Selon le Dr Madani Ly, cancérologue au Centre international d’oncologie de Bamako et Président de l’association Onco-Mali, les dix dernières années ont marqué un tournant dans la sensibilisation.
« Il y a une avancée énorme sur le plan de la sensibilisation. De plus en plus de femmes ont l’information. Dans presque toutes les structures sanitaires, à Bamako ou à l’intérieur du pays, elles sortent en grand nombre pour se faire dépister. Cela a fait baisser, par exemple, le nombre de cas du cancer du col de l’utérus, parce que beaucoup de lésions précancéreuses ont été dépistées et traitées », affirme-t-il.
Les statistiques confirment cette tendance. En 2024, plus de 91 000 femmes ont été dépistées dans le pays, dont 43 236 pour le cancer du sein et 47 791 pour celui du col de l’utérus.
Parmi elles, 384 cas suspects de cancer du sein ont été enregistrés, dont 134 référés pour un suivi spécialisé. Concernant le col de l’utérus, 751 cas suspects ont été identifiés, aboutissant à 284 biopsies, 394 lésions précancéreuses détectées et 22 cas traités.
« Octobre Rose », une initiative impactante
Cette progression est aussi le fruit des campagnes annuelles « Octobre Rose », initiées par le ministère de la Santé et du Développement social, en partenariat avec l’Office national de la santé de la reproduction (ONASR) et diverses associations de femmes.
Depuis sa première édition, cette campagne vise à informer, dépister et accompagner les femmes à travers des actions concrètes de proximité. Placée sous le thème « Inclusion et engagement pour atteindre les groupes vulnérables », l’édition 2025, organisée du 1er au 31 octobre, ambitionne de toucher un million de femmes, en mettant l’accent sur celles vivant dans des conditions précaires : femmes déplacées, handicapées ou issues de zones enclavées.
Cette campagne s’inscrit dans le thème mondial choisi cette année par l’OMS : « Closing the Care Gap » (Réduire les inégalités d’accès aux soins).
Prise en charge renforcée
Outre les hausses de la sensibilisation et du dépistage, le Mali a aussi accompli des avancées considérables dans la prise en charge. « Il faut noter l’apport du gouvernement du Mali, qui a subventionné en partie depuis des années la chimiothérapie, facilitant ainsi l’accès au traitement, même si cela reste encore largement insuffisant », explique le Dr Madani Ly. Un autre acquis majeur est la création du centre de radiothérapie à l’Hôpital du Mali, offrant des traitements pour les cancers du sein et du col. « Il y a parfois quelques difficultés techniques, mais cela reste une avancée majeure », souligne-t-il.
La formation du personnel médical s’est également renforcée. Selon notre interlocuteur, le Mali compte de nos jours huit oncologues médicaux, qui exercent à Bamako, et de plus en plus de chirurgiens cancérologues et de radiothérapeutes sont formés, tandis que d’autres sont en cours de formation, suscitant un grand espoir de délocalisation du traitement des cancers vers les régions dans les prochaines années.
L’introduction du vaccin contre le papillomavirus humain (HPV) en novembre 2024, soutenue par l’OMS et l’Alliance GAVI, constitue elle aussi un jalon important. Elle vise à réduire à long terme les nouveaux cas de cancer du col de l’utérus, particulièrement chez les jeunes filles âgées de 9 à 14 ans.
MSF en appui
À ces efforts s’ajoute l’appui déterminant de Médecins Sans Frontières (MSF), qui depuis 2018 intervient dans le domaine de la lutte contre les cancers féminins. L’organisation a mis en place des programmes de dépistage et de traitement gratuits du cancer du col de l’utérus et du cancer du sein à Bamako, notamment au Centre de santé de référence de la Commune I.
Grâce à MSF et à son centre d’oncologie pilote, plusieurs femmes ont pu bénéficier d’un dépistage précoce et de soins adaptés. L’organisation contribue également à la formation du personnel soignant, à la fourniture d’équipements de diagnostic et à la mise à disposition de médicaments essentiels.
Ces actions ont permis, selon les données de MSF, de doubler le nombre de diagnostics précoces entre 2019 et 2022 et de réduire sensiblement la part des patientes arrivant à un stade terminal de la maladie.
Des obstacles structurels et sociaux encore tenaces
Malgré ces progrès, les défis restent considérables. Le taux de survie à trois ans du cancer du sein demeure extrêmement faible, estimé à seulement 12,69% selon une étude menée en 2015.
Cette situation s’explique par un diagnostic souvent tardif et par le fait que la majorité des patientes arrivent en soins à un stade avancé de la maladie. Les formes agressives, notamment les cancers triples négatifs, compliquent encore la prise en charge.
Les contraintes logistiques et financières aggravent la situation. « L’une des principales difficultés est d’ordre financier. La chimiothérapie coûte excessivement cher, même si le gouvernement en subventionne une partie », souligne le Dr Ly. Par ailleurs, le Mali ne dispose que d’un seul appareil de radiothérapie et l’accès aux analyses histochimiques et aux laboratoires d’anatomopathologie est très limité.
Les barrières socioculturelles jouent aussi un rôle majeur. « Souvent, les femmes ont peur de se rendre à l’hôpital parce qu’elles craignent la biopsie du sein. D’autres, en raison de la pudeur ou de convictions religieuses, évitent le dépistage du col de l’utérus. Nous devons faire des efforts de sensibilisation pour que ces tabous ne soient plus un frein », insiste le cancérologue.
Ces freins, combinés à la pauvreté et au manque de structures de proximité, expliquent le faible recours au dépistage préventif dans les zones rurales.
Renforcer le financement et décentraliser les soins
Pour améliorer la situation, les experts s’accordent sur plusieurs leviers d’action. D’abord, renforcer le diagnostic précoce et promouvoir une prise en charge multidisciplinaire afin d’assurer un meilleur suivi des patientes. Ensuite, développer l’offre de radiothérapie dans les régions et améliorer l’accès aux analyses histochimiques.
Le Dr Madani Ly plaide également pour un meilleur financement public. « Concernant l’accessibilité au traitement, l’idéal serait d’inclure dans la liste de l’Assurance Maladie Obligatoire les médicaments spécifiques du cancer, qui coûtent très cher. Nous ne gagnerons jamais la bataille contre les cancers sans ce mécanisme », déclare-t-il.
Au-delà de la question des ressources, le renforcement de la formation continue du personnel de santé et la sensibilisation communautaire est indispensable. Car, comme le rappelle le cancérologue, « les avancées sont encourageantes, mais la bataille est loin d’être terminée ».
Mohamed Kenouvi