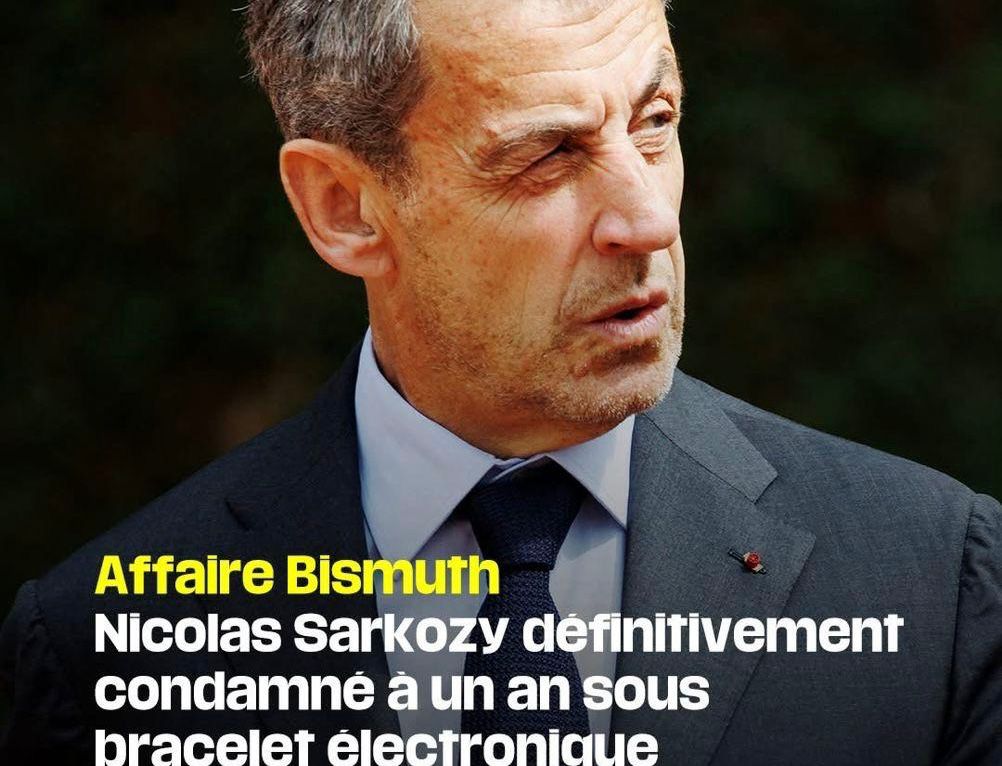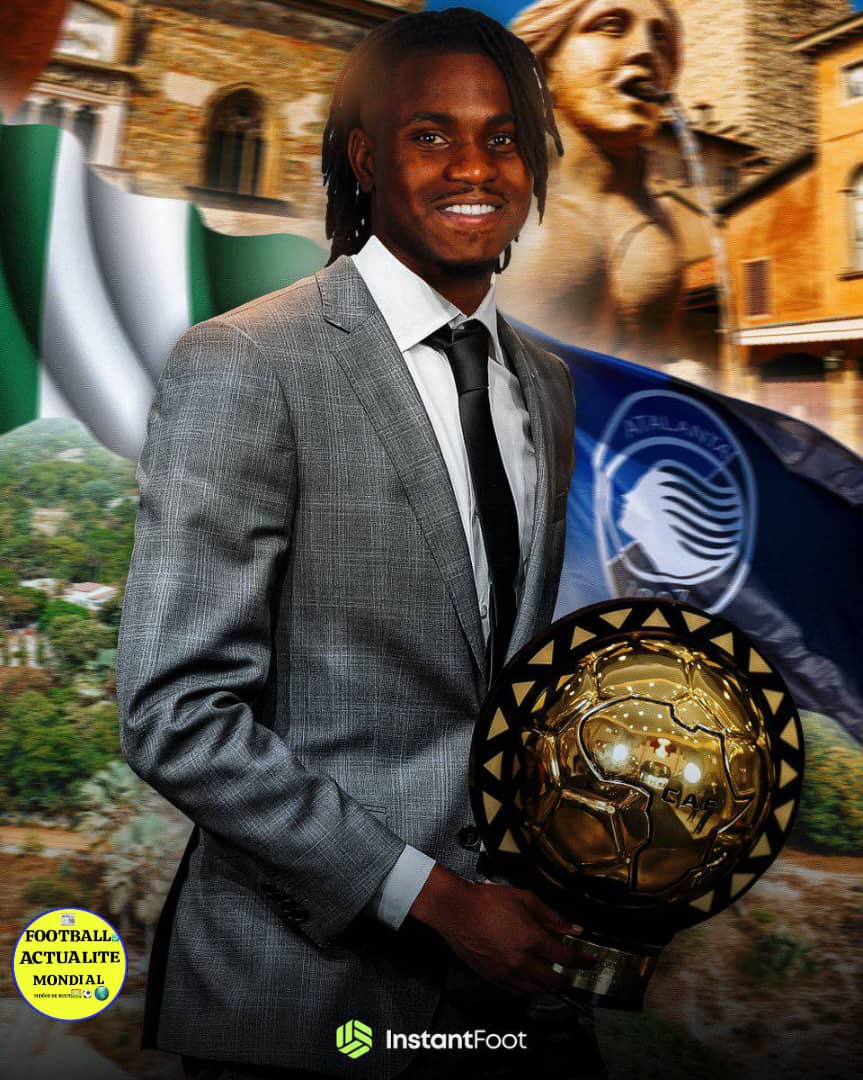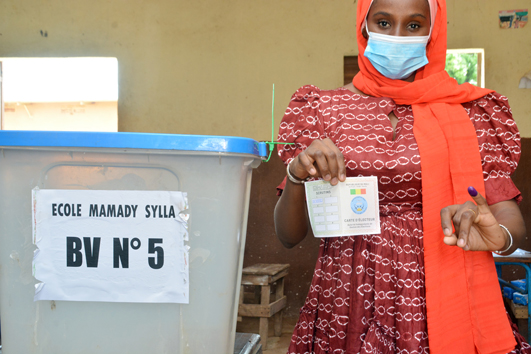La crise énergétique que traverse le Mali depuis plus d’une année perdure, malgré les différentes mesures prises par les autorités pour la juguler. À la tête du gouvernement depuis le 21 novembre dernier, le Général de division Abdoulaye Maïga s’active pour trouver de nouvelles pistes de solutions, avec pour objectif une stabilisation de l’approvisionnement énergétique dans le pays d’ici mars 2025.
Le Premier ministre Abdoulaye Maïga semble résolu à trouver une issue favorable à la grave crise énergétique que vit le Mali depuis plusieurs mois. Dans la foulée de sa nomination, le nouveau Chef du gouvernement a réservé le 28 novembre dernier sa première visite de terrain à Énergie du Mali (EDM-SA).
Porteur d’un message d’encouragement et de reconnaissance de la part du Président de la Transition, il a invité la direction et le personnel d’EDM-SA à soumettre des propositions de solutions pour mettre fin à la crise énergétique.
Une semaine plus tard, le 5 décembre 2024, le Général de division Abdoulaye Maïga était de nouveau au siège de la société pour s’enquérir des différentes propositions faites par l’ensemble des travailleurs d’EDM-SA.
Mobiliser des ressources financières
Au total, 2 300 propositions ont été recueillies auprès de 607 collaborateurs de la société Énergie du Mali. Elles tournent autour de six axes : renforcer la production énergétique, tirer avantage de l’offre énergétique régionale, assurer la viabilité financière de l’EDM-SA, améliorer la gouvernance et la communication, élaborer des stratégies à long terme et mettre en place des actions immédiates pour améliorer la fourniture.
Parmi les actions immédiates à entreprendre pour l’amélioration de la fourniture de l’électricité, selon les employés d’EDM-SA, figurent la mobilisation des ressources financières pour approvisionner régulièrement et suffisamment les centrales thermiques existantes en fioul et gas-oil, ainsi que le paiement des factures impayées de l’administration publique et des sociétés d’État.
Concernant le premier axe, le renforcement de la production énergétique, les travailleurs proposent, entre autres, de construire de nouvelles centrales solaires, de développer une centrale thermique moderne pour assurer une production stable pendant la nuit et de promouvoir les énergies renouvelables par des subventions à l’installation de panneaux solaires individuels.
Ils suggèrent aussi au gouvernement d’investir dans l’augmentation de la capacité des centrales électriques actuelles pour renforcer l’offre énergétique et d’étendre le réseau interconnecté afin d’atteindre les centrales thermiques des centres isolés.
Apurement de la dette
En ce qui concerne le deuxième axe, les travailleurs d’EDM-SA proposent de rétablir le partenariat avec la Compagnie ivoirienne d’Électricité (CIE) afin d’importer toute la capacité d’électricité disponible, d’accélérer la réalisation des ouvrages d’interconnexion, notamment entre le Mali et la Guinée, et d’encourager la diversification des sources d’énergie dans la formation du mix énergétique, avec une part d’importation permettant de diminuer les coûts d’exploitation.
Pour assurer la viabilité financière d’EDM-SA, ses employés optent non seulement pour un ajustement et une régulation des tarifs de l’électricité et l’optimisation de la collecte des revenus, mais aussi pour un apurement de la dette de la société et le recouvrement de ses créances, notamment auprès de la SOMAGEP et des entreprises publiques, afin d’améliorer la situation financière de l’entreprise.
En février dernier, les factures impayées d’électricité des services publics du Mali se chiffraient à plus de 90 milliards de francs CFA. En juin, EDM-SA avait tenté en vain d’amorcer une campagne de recouvrement en coupant l’alimentation en électricité dans certaines agences de la SOMAGEP, en raison d’arriérés de factures de cette société sœur qui s’élevaient à plus de 33 milliards de francs CFA.
Faire le tri
Dans l’axe « Gouvernance et communication », les employés d’EDM-SA proposent de mettre en place une campagne d’information pour sensibiliser aux économies d’énergie ainsi que des mécanismes pour lutter efficacement contre la fraude et les comportements déviants.
Ils suggèrent également la simplification des procédures administratives pour l’installation des producteurs solaires privés, la mise en place d’un suivi régulier des projets et programmes pour l’atteinte des objectifs de la société et le maintien d’une certaine stabilité dans sa gouvernance.
À long terme, les employés d’EDM-SA préconisent la mise en place d’un plan pour développer les énergies renouvelables au Mali, des investissements dans la modernisation du réseau de transport pour réduire les pertes et la formation du personnel pour mieux répondre aux crises énergétiques.
Pour l’analyste économique Hamadoun Haïdara, « il revient au Premier ministre de faire le tri parmi les multiples propositions faites et de mettre en place un plan d’actions pour la mise en œuvre, dans un délai raisonnable, des mesures qui seront retenues ». « Mais déjà la démarche du Chef du gouvernement démontre sa volonté de trouver rapidement une issue à cette crise qui n’a que trop duré », souligne-t-il.
Nouvelle feuille de route
Dans la foulée des propositions des employés d’EDM-SA le 5 décembre, le Premier ministre a tenu le même jour une séance de travail avec les ministres de l’Énergie, de l’Économie et de l’Industrie, élargie à la direction d’EDM ainsi qu’aux acteurs sociaux, dont les représentants des secteurs pétrolier, bancaire et minier. Selon la Cellule de Communication de la Primature, les échanges lors de cette rencontre ont permis de dégager des pistes concrètes.
« Une feuille de route détaillée est en cours d’élaboration pour aboutir à un plan d’actions visant à stabiliser l’approvisionnement énergétique entre décembre 2024 et mars 2025 », précise-t-elle.
En outre, le ministre de l’Énergie et de l’Eau, le Directeur général d’EDM et les représentants des ministères de l’Économie et de l’Industrie rencontreront dans les prochains jours les fournisseurs d’EDM-SA pour définir de nouvelles modalités d’approvisionnement.
Cette rencontre sera suivie, selon la Primature, d’une grande réunion entre toutes les parties prenantes pour valider le plan d’actions final.
Allègement en vue ?
Depuis le début de la crise, de nombreux efforts ont été déployés par les autorités de la Transition, sans pour autant parvenir à mettre fin aux délestages intempestifs dans le pays. Parmi les mesures prises en mars dernier, un protocole d’accord de gestion de la dette bancaire d’EDM avait été signé entre le ministère de l’Économie et des Finances et l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali (APBEF-Mali).
Il consistait à étaler la période de remboursement de ladite dette (plus de 300 milliards de francs CFA) sur une période de 10 ans à un taux voisin du taux du guichet marginal de la BCEAO, avec un différé de paiement d’une période d’un an.
Après avoir lancé la construction de trois centrales solaires (200 MW sur 314 hectares à Sanankoroba, 100 MW sur 228 hectares à Safo et 100 MW sur 120 hectares à Tikadougou-Dialakoro), le Président de la Transition avait également remis en juin 2024 un lot de 25 groupes électrogènes à EDM pour renforcer son parc de production.
La nouvelle dynamique de recherche de solutions à la crise énergétique enclenchée par le Premier ministre suscite de l’espoir pour une amélioration prochaine de la fourniture en électricité dans l’ensemble du pays. Mais le bout du tunnel dans cette crise que traverse le Mali depuis plusieurs mois est-il pour autant proche ?
« C’est vrai que le Premier ministre a pris à bras le corps la résolution de la crise énergétique, mais je pense qu’il faudra attendre des mesures concrètes pour une diminution significative des délestages avant de se réjouir », estime un acteur politique qui a requis l’anonymat.
Selon ce dernier, toutes les propositions recensées au niveau du personnel d’EDM-SA ne sont pas nouvelles et les plus susceptibles d’apporter une certaine amélioration immédiate de la situation, à l’instar de la reprise du partenariat avec la CIE, ne seront probablement pas exploitées.
Toutefois, de l’avis de certains observateurs, la mise en œuvre du plan d’actions qui sera établi à l’issue des différentes rencontres initiées par le Premier ministre pourrait aboutir à un allègement de la crise énergétique dans les prochaines semaines.
Mohamed Kenouvi